Les « pouvoirs » du théâtre – sur trois tragédies de Shakespeare
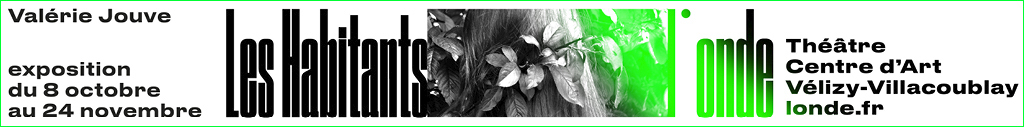
Lear : […] Allez, parle !
Cordélia : Rien, mon lord.
Lear : Rien ?
Cordélia : Rien.
Lear : Rien ? Mais rien ne sortira de rien ! Parle encore !
« Le Roi Lear » (I,1), trad. Olivier Cadiot, P.O.L, 2022
Richard II : […] Parfois je suis roi,
Alors les trahisons me font souhaiter d’être un mendiant,
Et c’est ce que je suis. Alors la misère oppressante
Me persuade que j’étais mieux quand j’étais roi ;
Alors je suis roi de nouveau, et bientôt,
Je pense que je suis détrôné par Bolingbroke,
Et aussitôt je ne suis plus rien. Mais quoi que je puisse être,
Ni moi ni aucun homme qui n’est qu’un homme,
Ne sera satisfait de rien jusqu’à ce qu’il soit soulagé,
De n’être rien.
« Richard II » (V, 5), trad. Jean-Michel Déprats, Gallimard, 1998
Coriolan : […] Ainsi, dédaignant, à cause de vous, ma patrie, je lui tourne le dos. Il y a un monde ailleurs.
« Coriolan » (III,3), trad. François Guizot, Ladvocat, 1821
Que peut le théâtre ? C’est la question que chacune à sa manière soulèvent les trois productions qui cet automne se confrontent aux tragédies de Shakespeare : Richard II aux Amandiers de Nanterre, Coriolan au théâtre de la Bastille et Le Roi Lear à la Comédie Française. Cette question était déjà présente à l’époque élisabéthaine même si elle n’avait pas tout à fait le même sens. En 1601, à la veille d’un complot censé renverser la reine Elisabeth, Richard II (publié en 1597) fut rejoué à la demande des amis du putschiste, le comte d’Essex. La pièce était censée galvaniser les foules contre Elisabeth qui ne manqua pas de se reconnaître en Richard II fuyant l’insurrection de Bolingbroke. Essex fut arrêté et décapité et la pièce fut mentionnée au cours du procès. Que le théâtre puisse influer le cours de la vie de l’État, comme le procureur de la reine – Sir Francis Bacon – le suggéra[1], n’est plus vraiment imaginable aujourd’hui.
Cela n’empêche cependant pas les metteurs en scène de lier les pièces de Shakespeare à l’actualité la plus contemporaine. Christoph Rauck évoque le quinquennat de François Hollande, Thomas Ostermeier ces hommes politiques qui s’accrochent au pouvoir et François Orsoni plus généralement le clivage grandissant entre démocrates et antidémocrates. Disons-le tout de suite, ces références ne sont guère visibles. La chose politique non plus d’ailleurs, excepté dans Richard II où la mise en scène de Christoph Rauck déploie avec une grande clarté les enjeux de pouvoir à l’œuvre dans la première des Histoires shakespearienne – écrite après Richard III, elle lui est chronologiquement antérieure.
Selon toute apparence, la question du pouvoir est au cœur de ces trois pièces : comment le conquérir – Coriolan ; comment le conserver – Richard II ; comment le transmettre – Le Roi Lear. Chacune la pose à sa manière mais toujours selon une même perspective : où passe la limite au-delà de laquelle l’ordre se défait. Coriolan est un homme de guerre valeureux qui pense que la victoire et la gloire suffisent à faire un consul ; Richard II est le roi légitime mais il fait assassiner son oncle qui intrigue contre lui et doit régner sous couvert d’un mensonge qui le perdra ; Lear a unifié le royaume, il entretient des relations cordiales avec ses voisins mais il veut être aimé. La politique de Shakespeare est celle des bords et des conditions, des zones où elle cesse, où le pouvoir devient impuissance. Coriolan croit avoir convaincu le peuple de Rome mais celui-ci se ravise ; Richard II exile ses rivaux et se rend en Irlande pour mater une rébellion locale mais Bolingbroke a levé une armée qui défait ses soldats ; Lear attend de sa fille adorée qu’elle l’aime en retour mais elle se refuse à jouer le jeu de ses sœurs, à dire un amour de cour et d’intérêt.
La question qui paraissait simple change de nature au fur et à mesure que les pièces avancent, que le pouvoir s’éloigne de ses protagonistes avant de se dissoudre dans l’air ambiant. Que ou qui devient-on quand on quitte ce monde, l’ordre politique, la scène réglée où chacun occupe la place qui lui revient ? Rien. Personne. Un vagabond qui erre dans la lande et hurle aux éléments qui se déchainent (Lear) ; un roi qui est un mendiant qui est un roi, soulagé de n’être plus rien, neige qui fond au soleil[2] (Richard II) ; un homme qui se bannit lui-même et devient l’ennemi qu’il a vaincu (Coriolan). De politique, la question devient philosophique : comment être ce rien, un homme nu, sans qualités ? Ou plutôt : qu’est-ce qu’un humain hors du monde qui le qualifie socialement, privé de ses attributs, de ses rôles, de ses masques ? Car, les apparences dissoutes, demeurent celles de la scène, du théâtre, du spectacle. Et le problème philosophique devient alors un problème théâtral. Comment représenter sur une même scène ce rien qui semble avoir quitté toute scène ? Dit autrement : comment une apparence peut-elle en contredire, ou en critiquer, une autre ?
Ce problème a hanté une bonne partie du théâtre du XXe siècle, mais sans doute personne autant que Peter Brook. Puisque le rien est la destination des personnages, il faut qu’il en soit également l’origine. Le rien chez lui prend la forme du vide, du plateau nu d’où les histoires et les décors émergent par les mouvements et par les mots. On ne peut aller au-delà de l’apparence mais on peut l’évider, approcher au plus près de ce rien autour duquel tant de personnages de Shakespeare tournent sans relâche. Le film qu’en 1971 il a consacré à King Lear – avec le hiératique Paul Scofield – n’est que corps et visages se débattant dans aucun lieu définissable.
François Orsoni et Thomas Ostermeier adaptent autant qu’ils mettent en scène. Le premier réduit Coriolan à ses six personnages principaux, déployant le squelette de son intrigue politique : Caius Marcius (qu’on surnomme Coriolan après sa victoire contre les Volsques et la prise de Corioles), sa mère (Volumnia), un patricien (Ménénius), le peuple, un tribun du peuple et le chef des Volsques (Aufidius).
Le second resserre Le Roi Lear autour de son intrigue filiale (et domestique) en retranchant les époux de Goneril et Régane, les deux ainées de Lear. L’effet, d’émancipation politique et tragique, souligne également la symétrie des deux drames, celui de Lear victime de ses filles et celui du comte de Gloucester victime des ruses diaboliques d’Edmund, le fils bâtard dont la folie maléfique rappelle celle de Richard III. Ces trois personnages sont les plus réussis et les mieux incarnés, leur dessin est clair (et Jennifer Decker, Marina Hands et Christophe Montenez des interprètes justes et fins).
Celui de Lear l’est moins. Oscillant entre ironie et bouffonnerie, il n’est jamais vraiment tragique ni fou. La faute peut-être à une mise en scène qui abuse des adresses au public et prend un peu trop de liberté avec le texte de Shakespeare, multipliant références et clins d’œil qu’actrices et acteurs improvisèrent, imagine-t-on, au cours des répétitions.
Le peuple c’est nous, le public-spectateur, alors que la politique et ses frasques sont du côté du théâtre.
On réduit souvent les pièces de Shakespeare. On les dit trop longues, trop peuplées, trop dramatiquement sinueuses. Mais le gain de durée et d’efficacité dramatique se fait souvent au détriment de la complexité relationnelle à l’œuvre. Les rôles secondaires éclairent les principaux et médient leurs actions, introduisent des dérivations et des stases qui étirent mais font respirer les intrigues. L’ensemble, aussi dense et intriqué soit-il, forme un territoire qui se dessine petit à petit et dont il s’avère gratifiant de parcourir toutes les routes, d’explorer tous les reliefs.
Patricien et militaire romain, aristocrate convaincu de sa valeur, accablé par les tribuns du peuple pour son orgueil, conforté par une mère incestueuse, Coriolan part combattre les Volsques, tribu barbare qui menace la République. Il chevauche, il bataille, il dirige les troupes, vainc Aufidius en combat singulier et prend Corioles, la capitale des Volsques. À cour, une percussionniste accompagne ses mouvements, met en sons les cavalcades, les épées qui s’entrechoquent, le boitement d’Aufidius sur la terre dense. Par ce simple contrepoint, sa guerre devient un spectacle et avec lui toute la politique romaine. Coriolan joue le jeu non sans plaisir, mais s’il veut bien être le héros de sa guerre, il refuse d’être celui du peuple. Candidat aux élections consulaires, on attend de lui qu’il montre ses blessures et narre ses exploits, qu’il séduise le peuple avec le même engagement qu’il mit à vaincre ses ennemis. Étrangement, il s’y refuse. Il ne peut faire semblant d’aimer un peuple qu’il méprise, qui n’est pour lui qu’informe « multitude ».
Ce trait idiotique que l’on dirait de caractère n’est pas sans faire penser à celui de Lear, qui tient tant à être aimé de ses filles qu’il bannit celle qui ne l’exprime pas assez clairement. L’idiotie aristocratique de Coriolan n’a rien à envier à l’idiotie filiale de Lear. L’une et l’autre mèneront au désastre. Coriolan se verra refuser le consulat et s’exilera de Rome. Il rejoindra les barbares qu’il mènera aux portes de la ville. Lear démembrera son royaume, abandonnera son pouvoir et finira par errer sur la lande, victime de l’ingratitude de ses filles. Mais ni l’un ni l’autre ne sont idiots et fous encore moins, même si Lear le deviendra.
L’excès des mises en scène d’Ostermeier et d’Orsoni, où Coriolan est un beauf hurlant (il porte ostensiblement un survêtement et une chaîne en or) et Lear un bouffon de comédie, nous empêchent de comprendre ce qui se joue là de singulier. Pourquoi Lear bannit-il sa fille préférée, Cordélia, avec tant de colère ? Pourquoi Coriolan en veut-il tant au peuple-multitude ? Comment peuvent-ils ainsi agir à l’encontre de leurs intérêts les plus manifestes ? De tout ils deviennent rien, passent des cimes du pouvoir au grand dehors, cet « ailleurs » dont parle Coriolan et qui n’est rien d’autre que l’absence de monde. Et cela ne saurait arriver sans qu’ils l’aient secrètement voulu. Il me semble que ce que ces décisions apparemment irrationnelles rendent sensibles sont en réalité les limites de la politique (et du pouvoir).
Chez Lear, cette limite est l’amour. Cordélia ne peut le dire parce qu’il deviendrait immédiatement inauthentique, égal à celui, public et intéressé, de ses sœurs. Lear veut qu’elle dise un amour sincère mais il ne saurait y avoir de sincérité dans l’arène politique, où il a choisi de situer cette parole. Son refus est la limite qu’elle impose à son pouvoir et à la politique en général. On sait que le dessein de Lear, il est mentionné dans les chroniques[3] d’où Shakespeare a tiré l’essentiel de sa pièce, était de transmettre son royaume à Cordélia. Son refus l’en empêche, ce qui explique la violence de sa colère.
Chez Coriolan, la limite est le peuple en tant que multitude autrement dit libre de toute transcendance monarchique ou étatique. Les mots de Coriolan sont « many » – « the mutable, rank-scented many » (III, 1) – et « multitude », jamais « people ». Ce peuple-là, que Shakespeare pressent et que Bertold Brecht rendra manifeste dans sa réécriture de la pièce[4], est le non-gouvernable, celui auquel aucun ordre extérieur ne peut être imposé : « populace qui ne peut commander, et ne voudra jamais obéir » dit-il aux sénateurs assemblés (III,1). Aux yeux de Coriolan, la « multitude » est un ennemi beaucoup plus sérieux que les tribus barbares.
L’espace des deux pièces dit beaucoup de leurs enjeux. Dans la mise en scène de François Orsoni, Coriolan, le Sénat, sa mère et ses guerres occupent le plateau tout entier. Les tribuns et le peuple sont relégués sur ses bords, dans la venelle qui sépare les premiers fauteuils de l’avancée du plateau. Le peuple c’est nous, le public-spectateur, alors que la politique et ses frasques sont du côté du théâtre. Et quand Coriolan descend de scène pour parler à la multitude, il se lance dans une parodie de « L’École des fans » où les citoyens romains sont des enfants aux mains d’un Jacques Martin moqueur et pervers. Ce clivage spatial extrémise les forces en présence, oppose à la vulgarité du spectacle politique l’infantilisme du peuple, double destitution qui n’ouvre qu’à deux avenirs possibles : la guerre ou l’autocratie.
La mise en scène de Thomas Ostermeier prolonge la lande sans fond du plateau d’une passerelle qui traverse la salle. Elle sert d’entrée, de sortie ou d’avancée aux personnages de la pièce. Lieu de quelques grands monologues, ceux notamment d’Edmund et de Lear dans l’acte II, elle projette les comédiens au milieu des spectateurs autant qu’elle les isole les uns des autres. Cette passerelle rappelle les avancées des scènes des concerts de rock qui permettent aux chanteurs de se séparer un moment du groupe afin de se plonger symboliquement dans la fosse. Spectaculaire, en ce qu’elle nous rend témoins au plus près des affres que traversent certains personnages, sa fonction dramaturgique est loin d’être évidente. Elle s’oppose à la lande et semble dessiner un chemin possible vers le monde, mais un chemin qui de toute évidence ne mène nulle part.
À la différence de ces derniers, l’espace conçu par Christoph Rauck pour Richard II n’est pas polarisé. Le plateau est occupé par deux gradins mobiles susceptibles de structurer la scène en fonction des situations. Ses deux frontières visibles sont d’un côté le fond, occupé tout entier par un écran sur lesquels se projettent des vidéos qui sont tout sauf des décors, de l’autre un rideau en tulle transparent sur lequel, à l’avant-scène, les noms des lieux viennent s’inscrire. Ce rideau s’ouvre et se ferme à vue, éloignant et rapprochant à l’envi ce qui se passe sur le plateau. Ce dispositif mouvant est au service d’une mise en scène qui ne réduit pas mais articule, déploie le réseau dense des relations, des revirements et des trahisons, des doutes et des décisions hâtives, la complexité des intrigues et les contradictions des personnages. Richard II est le centre fuyant, littéralement insaisissable, de cette mise en scène.
L’interprétation qu’en propose Micha Lescot est extraordinaire de nuances et de variations subites. Il peut être ironique et froid puis enjoué et flatteur, bondissant ou hiératique, délirant sans bouffonnerie puis mélancolique jusqu’à l’abandon, autoritaire ou obséquieux, à la fois roi et mendiant, tout et rien. Richard II est un de ces personnages indécis que Shakespeare aimait tant. Roi légitime, il parvient à force d’erreurs et de revirements à perdre sa couronne et sa vie. Sa destitution par Bolingbroke scelle le début d’un long cycle de meurtres et de trahisons dont Shakespeare a fait le principal sujet de ses pièces historiques, de Richard II à Henry VI.
Richard II est le personnage des digressions impromptues et des variations métaphysiques. Acculé par Bolingbroke dans le château de Flint au pays de Galles, suspendant tout action, il entreprend sur la mort un long monologue (III, 2) : c’est elle et non le roi qui occupe le creux de sa couronne, elle y tient sa cour, lui souffle ses avis, gouverne à sa place avant, quand elle se lasse, de le tuer d’un coup d’épingle. Disant cela, debout sur un des deux gradins, Micha Lescot gonfle un ballon blanc pris dans une poche de son habit puis le relâche et le regarde virevolter jusqu’au plateau. Ce ballon dit parfaitement la plasticité de ce personnage et du corps de celui qui l’incarne, capable de passer de l’immobilité de la pierre aux accélérations les plus soudaines, d’être glace et neige et eau qui s’épand sur les dalles de sa prison.
Que peut le théâtre ? Rien. C’est-à-dire tout. Feuilleter les apparences, rendre sensible, sur une scène qui peut être n’importe où, les couches dépareillées du réel, en le rejouant sans fin mais non sans durée car ce réel est adressé, il passe un peu dans nos corps, il nous fait un peu neige un peu eau un peu pierre, un peu tout et un peu rien et c’est bien assez pour continuer à vivre.
