Laissez-passer – à propos de Tibi la blanche d’Hadrien Bels
Chaque livre et chaque texte sont des fractures ou des failles. Des failles qui se font parfois géographiques ou sentimentales. Tibi la blanche permet de réunir ces deux rives, ces deux enjeux autour de questions notamment liées à cette fêlure qui sépare l’enfance de l’âge adulte, la frontière symbolique qui isole les quartiers de Dakar ou encore cette frontière poreuse entre une partie de cette ville et la France.
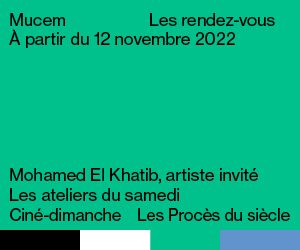
Pour cela, Tibi la blanche nous raconte l’histoire et les aventures de trois jeunes du quartier de Thiaroye à Dakar. Nous les suivons une semaine durant, une semaine qui permet à l’auteur de cristalliser en partie les enjeux propres à la situation et à l’histoire de la ville. La ville, personnifiée au possible, et qui se fait ici protéiforme, Hadrien Bels parle de Dakar avec amour et lucidité, avec sentimentalisme et humour.
Le texte du roman
L’histoire littéraire récente nous permet d’observer, souvent, que le roman n’a jamais commandé un rêve d’une littérature qui serait extérieur au réel. Ainsi, les livres d’Hadrien Bels se construisent bien dans la sécularisation du propos. Des travaux qui évoquent l’effroyablement banal et le quotidien des personnages, tout en mettant en avant les formes de construction de soi et de la vie, par le biais de l’expérience et des rites initiatiques. Cinq dans tes yeux, son premier ouvrage, se construisait (déjà) sur la base de cette charnière entre le temps de la jeunesse et de l’âge adulte et cela à travers un groupe de jeunes marseillais désœuvrés et attachants. Tibi, de son côté, nous raconte le périple des résultats du baccalauréat chez trois jeunes de la classe moyenne, entre espoir et désillusion, entre maladie mentale et colonisation, entre banlieue parisienne et excellence scolaire. C’est dans la négativité et l’innocence du choix des personnages que se construit le roman familial du Sénégal avec ses enfants, avec vieux et ses démons.
Il y a dans Tibi la blanche une volonté de trouver une alternative pour raconter le monde. Le roman est ici percuté en tout point par la littérature et cela depuis la première page où apparaît une citation de l’ouvrage Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, « Tu vois qu’un malheur, c’est parfois un bonheur bien emballé et quand tout s’use, c’est le bonheur qui tombe. » De fait, dans Les Soleils des indépendances comme dans Tibi la Blanche l’œuvre et sa réception sont teintées de pessimisme. En cela, la chute, voire le déshonneur des personnages est symbolique depuis le maintien au pays jusqu’aux conditions du départ.
Les auteurs semblent nous dire que les indépendances, pour la plupart des états africains, n’existent pas plus en 1968 qu’en 2022. Elles ne sont que des concepts dénués de substance. Les indépendances auraient fait plus de mal que de bien, étant donné qu’elles ont ruiné les Malinkés qui à présent vivent dans la mendicité abjecte. Tibi comme ses amis Neurone ou Issa déplorent à leur tour la situation actuelle. Kourouma ne disait pas autre chose dans les Soleils : « La colonisation a banni et tué la guerre mais favorisé le négoce, les Indépendances ont cassé le négoce et la guerre ne venait pas. Et l’espèce Malinké, les tribus, la terre, la civilisation se meurent, percluses, sourdes et aveugles… et stériles. »
Bic marabouté
Il y a quelque chose de très brut dans l’écriture d’Hadrien Bels qui résonne avec le rapport instinctif de son approche. Parmi les premières énigmes de l’ouvrage intervient celle d’un bic marabouté à l’orée des épreuves du bac. Double de l’auteur et de son approche, il y aurait à travers de l’ensorcellement de l’outil ce qui doit permettre une connexion de l’auteur à son sujet. Revenant aux prémices même du roman, il s’écrit ici une légende de l’écriture même dans son lien entretenu avec l’écrivant double à son tour masqué de Tibi la Blanche, « « Un héritage de croyances qu’elle a toujours voulu contenir comme un feu ».
De fait, l’histoire racontée par Hadrien Bels nous permet d’observer l’idée d’une expiation permanente du monde social. Celle-ci s’accompagne le plus souvent chez l’auteur d’une abomination des rapports sociaux extérieurs aux histoires d’amours. Aussi il y a dans les romans d’Hadrien Bels un rejet de la procréation au profit d’une création littéraire, artistique, personnelle et totalement sublimée. Dans Tibi, l’auteur place sur un piédestal l’histoire et la construction coloniale puis celle des indépendances. Son bic marabouté vient remettre sur le devant de la scène et en filigrane une histoire outragée et souvent oublié par ses contemporains.
Le romancier nous raconte avec justesse les années de jeunesse des pères dans les universités parisiennes avec leur lors fastes et les crises de politisation, les engagements des uns et les fuites des autres, les retours difficiles de certaines et, par endroit, les catastrophes personnelles qui s’écrivent dans la rencontre avec ce lointain colon que l’on ne connaissait que de nom. Pour opérer cette écriture et cette célébration de la micro-histoire, il donne justement splendeur et restauration au détail et aux dialogues, à l’image d’une recette du thiep qui se fait métaphore de la colonisation et des constructions sociales à l’orée de l’ouverture d’une discothèque. Ici Hadrien Bels ne dispose de rien d’autre que de mots et de personnages à arranger, pour identifier, et construire cette surprenante histoire du contemporain.
Pour raconter l’histoire de la classe moyenne dakaroise, il œuvre de mots à arranger et l’on y retrouve une pulsion dans la recherche de la bonne tournure qu’il semble sans cesse chercher, creuser, retourner de cent mille façons. Cette phrase maitresse est portée par l’auteur à la manière d’un trophée et il n’est pas étonnant que revienne dans la bouche de ce dernier la fameuse citation « le français est notre butin de guerre » parfois attribuée à Kateb Yacine.
Ce qu’il reste de la folie
Ainsi dans Tibi la blanche, la société sénégalaise apparaît-elle comme diverse, protéiforme, écartelée entre différents modèles culturels et cependant ouverte aux zones de contact. On y retrouve les jeunes classes créatives, la pauvreté extrême, les classes moyennes et privilégiées. Un lieu particulier fait histoire dans ce paysage avec l’hôpital psychiatrique dont les pages s’ouvrent sur une citation de Youssou N’Dourr « Immigré, il faut revenir. » Cette place à part tient aussi par l’écho qui s’entend dans l’ouvrage avec les œuvres de Joris Lachaize comme avec le travail plus ancien de Jean Rouch. Tous deux mettaient déjà en dialogue la psychiatrie et la colonisation. Et cela tient ici pour une part à l’histoire de la psychiatrie au Sénégal et au rôle majeur que joua la spécialisation en neuropsychiatrie, elle qui rompt avec la psychiatrie coloniale en intégrant aux soins la culture des patients. Cette histoire s’écrit notamment avec le quartier de Thiaroye et avec l’histoire de l’École de Dakar, la présence de l’accompagnant, ce proche du patient (ici Tibi) qui vient et demeure avec lui pour un temps à l’hôpital. Le lien avec l’entourage n’est donc pas brisé.
Hadrien Bels à travers le personnage de Jacob, c’est-à-dire celui qui a dû revenir de France, nous montre ce qu’il reste de cette influence tout en interrogeant les maladies mentales dans un pays anciennement colonisé et imprégné de pratiques magiques. Cette écriture, plus près des personnages et de cette transmission nous amène, d’une certaine manière à être happé par eux, l’auteur offre une parole à Jacob qui, dans son rejet de la puissance coloniale raconte et remet en question cette place et le statut social proposé par l’Occident. Cette histoire de la folie semble rejoindre, dans ce roman d’un français sur l’Afrique le recours au service de guérisseurs et des marabouts, les effluves et les cris, un monde qui me tient à distance autant qu’il me fascine.
S’opposent alors dans l’ouvrage deux espaces : celui de l’hôpital, de l’histoire circonscrit par des murs d’une blancheur déjà vieillie et celui, des marabouts, de la ville et des autoroutes qui éventrent la ville. Même si, en étant juxtaposés, les deux espaces ont l’air de s’opposer, Hadrien Bels révèle avec brio une perméabilité entre les mondes venue de l’Occident et les modes de pensée et les pratiques traditionnelles dans une ville de Dakar ultra-contemporaine.
Staline en boubou
« Ce que j’ai voulu raconter c’est une Afrique contemporaine des classes moyennes. C’est pour ça qu’il me paraissait important de faire ressortir l’écart entre un jeune banquier à Antony et celui d’un jeune qui reste au pays. Et le second explique au premier : “je reste pour vendre des bagnoles que tu pourras jamais te payer” C’est une manière de sortir l’Afrique de l’image des blédards et des ONG. »
Au cours d’un échange avec Hadrien Bels ce dernier raconte comment il a pensé la construction du livre mais aussi son propos depuis notre inconscient jusqu’au directement visible, ce qui s’apparente à une culture visuelle de la ville exprimée dans l’ouvrage par un style extrêmement imagé lequel donne au livre ce rythme soutenu. De fait, cette omniprésence offre au roman un caractère cinématographique et il nous semble circuler et regarder le paysage, se composer sous nos yeux en même temps que nous tournons les pages. « C’est un pays avec lequel nous avons un véritable cordon ombilical » nous précise l’auteur, tout en soutenant, pour sa part, qu’il entretient avec l’écriture un rapport instinctif, une volonté de raconter cette possible personnification d’une ville, un rapport à son hypertension comme à l’odeur qui s’en dégage.
C’est dans l’étonnante distance que l’on conserve entre les personnages et la ville que se construit la force du roman. En revanche la proximité s’élabore avec cet âge de la vie et des questions qui l’habitent. « Tibilé a compris. Elle n’allait pas s’envoler vers la France sans que sa mère lui mette une petite bague autour de la cheville. Comme celle autour de la patte des pigeons d’élevage pour ne pas les perdre. » C’est dans les constantes familiale de l’entrée dans la vie d’adulte que l’ouvrage s’adresse à nous, dans l’ouverture depuis un quartier vers la ville puis depuis une ville vers un autre pays. Également dans le ressenti qui existe par la volonté de faire tomber les frontières. « Tu crois que c’est un jeu mais moi je ne joue pas. »
Cette histoire de la ville c’est aussi celle d’une histoire récente qui transparait ici dans sa dimension émancipatrice. Chacun des trois adolescents vit pendant ces quelques jours un rite initiatique, un moment charnière mis en mot et en image. Pour partie il va s’écrire aussi au regard du Mouvement France Dégage qui a secoué le pays en 2021. À cet instant, le fameux pays de la Teranga (hospitalité en wolof) s’est soudainement acteur d’un rejet de la France par une partie de la jeunesse dakaroise.
Nous pouvons en voir quelques signaux faibles poindre dans l’ouvrage. On peut bien évidement regretter que Tibi la Blanche ne se penche pas plus sur ce mouvement, sur ses causes et sur ses conséquences, mais il s’agirait probablement d’un autre livre. De même on s’interroge par moment sur le statut de l’auteur, celui d’un français qui écrit sur l’Afrique. Lorsque j’interroge Hadrien. Bels sur à ce sujet, il me répond, lapidaire : « L’avantage pour moi le marseillais, c’est que j’en ai rien à foutre de la question de l’appropriation. »
Hadrien Bels, Tibi la blanche, Iconoclaste, 256 pages.
