Comme un pied-de-nez – sur Langages de vérité de Salman Rushdie
Langages de vérité a paru cet automne, après l’annonce du Nobel de littérature (que Rushdie n’a pas obtenu, faut-il le rappeler…), dans une traduction (excellente traduction, il faudra y revenir) de Gérard Meudal, et quelques mois avant la parution de Victory City, son prochain roman. Deux ou trois impressions fortes dominent. La première s’apparenterait presque à une forme de berlue : on avait quitté un Rushdie ayant perdu, aux dernières nouvelles, un œil et l’usage de sa main et on le retrouve virevoltant comme jamais et débordant de santé. Le dernier article du recueil, « Pandémie », évoque même son combat victorieux contre la Covid19.
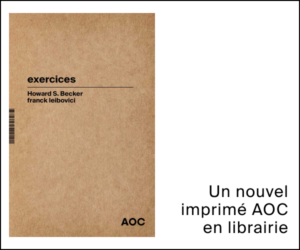
Un instant, on s’interroge. Serait-ce que l’odieux attentat perpétré en août dernier par un fou de Dieu, de Khomeiny et de sa fatwa, n’a jamais eu lieu ? S’était-il donc déroulé dans un univers parallèle, qui n’aurait jamais existé ailleurs que dans la tête dérangée d’islamistes rêvant depuis toujours de lui régler son compte ? Très vite, on déchante : le réalisme magique peut beaucoup, mais il ne peut pas faire qu’un bras armé d’un couteau ne frappe pas sa cible, dans la vraie vie. Mais le timing de cette parution intervenant plus d’un an après la sortie du volume en langue anglaise, fait quand même très bien les choses, en nous donnant l’occasion de (re)penser à Rushdie.
Penser, nous explique en substance Frédéric Worms, c’est sinon toujours, du moins le plus souvent, « penser à quelqu’un »[1]. « Avec » ce quelqu’un qui souffre dans sa chair, et qui souffre parce qu’il écrit, et à qui je pense, le sens du verbe « penser » s’éclaire et s’enrichit. Rushdie le libre penseur, se pique de penser la littérature, de penser la peinture. Penser aux histoires qui existaient déjà avant qu’il y ait des livres, c’est penser à « l’artiste composite », l’anonyme auteur du Hamzanama. La fonction fabulatrice, consistant à « créer des personnages dont nous nous racontons à nous-mêmes l’histoire » (Bergson) n’empêche nullement Rushdie de se faire lecteur, métalecteur même. C’est du reste la troisième fois qu’il rassemble ses écrits non fictionnels, en comptant le volume des Patries imaginaires (1991).
« Pandémie », donc, est à peu près le seul article, sur une quarantaine d’entrées regroupées en quatre parties, à relever de l’égo-histoire. Le seul où il parle de lui et détaille un tant soit peu sa biographie : son passé de gros fumeur, l’épisode de fièvre typhoïde qui marqua son enfance indienne, la double pneumonie contractée à Londres en 1984, dont il réchappe mais qui se transforme en asthme chronique. Et c’est tout, quasiment. Rien en tout cas, ici, qui soit de nature à donner du grain à moudre à une époque dont Rushdie sait décrypter comme personne les travers : l’infatuation pour les people, la manie du gossip, la curiosité « profonde et insatiable pour la vie des auteurs », à laquelle Rushdie, un brin midinette, est le premier à sacrifier—tout en jurant bien de ne pas y donner lui-même prise.
C’est qu’il a payé cher pour savoir ce qu’il en coûte. Tout au plus évoque-t-il, à demi-mots, combien il avait été marqué par la manière dont Philip Roth, l’un de ses maîtres à écrire, avait travaillé « aussi près du taureau », comprenons le taureau de la famille, de l’intimité, fût-elle transposée, introduite dans l’œuvre publique, et qui fait violemment retour. L’autofiction n’est décidément pas la tasse de thé de Rushdie. Elle serait même sa bête noire, tant cette dernière jure avec l’écart, privilégié en toutes circonstances, d’avec la réalité triste et nue.
Deuxième impression : Rushdie qu’on croyait à tort narcissique nous livre un portrait de groupe, une ample fresque au sein de laquelle, pour un peu, il se fondrait. Non pour y disparaître tout à fait, ce serait pousser loin le sacrifice, mais pour mieux affirmer la force insubmersible d’un puissant collectif uni et animé par les mêmes valeurs, d’humanités et de culture, adossées à la liberté de pensée et de création. Protégé par le « charme », au sens antique du terme, d’un totem d’immunité, il avance groupé, comme la forêt touffue et mobile de Birnam, tel une force qui va, innombrable et invaincue.
Tactiquement, la démarche vient de loin. Au temps des batailles chroniquées par Shakespeare, le roi dépêchait à plusieurs endroits du front autant de leurres vêtus à son image et lui ressemblant, afin de donner le change. Ainsi l’ennemi se donnait-il le sentiment d’un monarque insaisissable, présent nulle part et partout à la fois. Rushdie est tel Malcolm montant à l’assaut de Macbeth, le tyran sanguinaire. Les écrivains et artistes d’hier et d’aujourd’hui, il les mobilise, sur la foi d’un pacte, d’un contrat en partage : « Dans un monde aussi instable que celui-ci, donnez-moi toujours une littérature de l’instabilité ou au moins qui reconnaisse celle-ci, qui admette que le monde puisse être secoué par des tremblements de terre, la guerre ou le hasard, où l’on ne se trompe jamais sur la réalité, où l’on accepte de regarder en face la nature de la bête. » Et Rushdie d’enrôler les figures de Héraclite et de Protée, le héros des métamorphoses et autres mutations, au service d’un combat rappelant celui du Quichotte de Cervantès contre les moulins à vent.
En un peu moins de 26 lettres et une petite dizaine d’images, Rushdie fait humblement le tour de ses admirations, littéraires mais également iconographiques. Les (presque) quatre cents pages du recueil y suffisent du reste à peine, tant ses dilections sont légion. À l’image du poète Walt Whitman, l’auteur des Feuilles d’herbe, Rushdie est « immense », il a « contenance de foules » en lui. De la corne d’abondance métaphoriquement fixée au frontispice de son recueil, coulent mille et un bienfaits. Hans Christian Andersen, Samuel Beckett, Cassius Clay… la liste (non alphabétique) court sur la page, déroulant en un chatoyant désordre ses copieuses entrées.
La plasticienne Kara Walker, « artiste de l’Histoire », ferme la marche, avec ses ombres dangereuses dansant sur l’espace blanc des papiers, des murs et des tissus. Avec elle, grâce à ses pairs, en réalité ses constantes sources d’inspiration, Rushdie poursuit sa vie et la recommence à chaque instant. Par le pouvoir d’un mot, d’une seule image, le cas échéant (Taryn Simon). Une fois, seulement une fois, il évoque « l’armée du bien », « une armée de la paix et de la justice, unie contre la haine, prête à se dresser contre les forces déchaînées contre elle ». Mais Rushdie est trop polymorphe pour rester prisonnier de ce genre de simplifications binaires. Et pour le coup, absolument contraires au langage de complexité et de contradictions dont il aime à se réclamer.
La leçon ou Master class de Rushdie, qui n’aime rien tant que faire œuvre de pédagogie, qu’il s’adresse à des étudiants ou à ses chers lecteurs, jette à la face de la mort « le rire et l’intelligence ».
Troisième impression, de loin la plus forte. Le pacte évoqué plus haut, il est temps de le requalifier. Appelons-le crédo, vibrant d’insolence et de fantaisie. Le crédo d’un incroyant, d’un athée, d’un mécréant, qui ne fête Noël que pour la joie de se retrouver en famille. Un crédo fracassé, mais renaissant de ses cendres :
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
il la reconnaît, il la nomme : Liberté. Paul Eluard ne figure pas dans le Panthéon imaginaire de Salman Rushdie. Pas physiquement en tout cas. Mais en filigrane, le poème « Liberté » en constitue la raison d’être privilégiée, la trame tout à la fois secrète et spectaculaire entre toutes. Elle ne fonctionne jamais mieux qu’en couple(s). Liberté et Vérité, laquelle réside, paradoxalement, dans le mentir-vrai de la fiction – « La magie des langages de vérité est la seule en laquelle je crois. » – ; dans l’aptitude, par exemple de l’artiste Francesco Clemente, à bondir de part et d’autre de la frontière imaginaire qui sépare et confond l’Italie et l’Inde, les Indiens d’Europe et les Italiens de l’Asie. Liberté et Traduction, aussi : il n’y a pas que les gens du Sud (Gabriel Garcia Marquez, Sebastiao Salgado, etc.) qui parlent la même langue.
L’« inné » des écrivains se transporte sans coup férir « de l’autre côté », sautant allégrement d’un méridien ou d’un hémisphère à un autre, tant qu’ils demeurent les adaptateurs d’eux-mêmes. C’est même l’adaptation, de soi à soi, de soi aux autres, que Rushdie érige en principe actif et ô combien dynamique d’un patrimoine cosmopolite appelé à (se) « survivre », le mot revient constamment sous sa plume. De cela, Gérard Meudal se fait le scribe impeccable, le transporteur fidèle : chapeau à lui ! Vérité et Voracité, en dernière analyse. Au festin de Salman, Rushdie invite et régale. C’est que, pour être romancier, il faut être « vorace. » Son travail consiste à plonger les mains aussi profondément que possible dans la matière de la vie, de s’y enfoncer jusqu’aux coudes, jusqu’aux aisselles et d’en ressortir avec cette matière. « Laissez-vous aller », lance-t-il aux lecteurs des romans de Beckett qu’il préface, de manière un peu improbable. Rushdie a la gourmandise toujours en éveil, et il faudrait avoir le palais singulièrement émoussé pour ne pas vouloir partager sa table et goûter son plantureux banquet de mots et d’images.
Son crédo, enfin, résonne comme un pied-de-nez, adressé à qui vous savez. Jamais amer, plus espiègle que revanchard, Rushdie hésite toutefois entre le sourire carnassier d’« Harold » (Pinter), la tristesse comique d’un Beckett qui la porte comme une « chemise favorite jamais lavée » et le KO administré par le jeune Cassius Clay. Et si les foudroyants crochets décochés par ce dernier, au foie et à la face de ses adversaires, ne sont pas loin d’avoir sa préférence, c’est qu’ils se doublent de paroles, tout aussi explosives : « Ravalez vos mots ! Ravalez vos mots ! » Ali avait-il coutume de hurler aux journalistes sportifs qui l’avaient donné perdant. La leçon ou Master class de Rushdie, qui n’aime rien tant que faire œuvre de pédagogie, qu’il s’adresse à des étudiants ou à ses chers lecteurs, jette à la face de la mort « le rire et l’intelligence ». Par endroits, son propos prend même des allures de discours de Stockholm d’un Nobélisable à ce jour jamais nobélisé.
Mais la doxa rushdienne ne ronronne jamais très longtemps : « Et puis un jour, l’image du monde se brise. Vous vous éveillez un matin et vous découvrez que vous avez été bel et bien transformé en scarabée géant. Ou bien Hitler envahit la Pologne [transposons : Poutine envahit l’Ukraine]. (…) Ou des terroristes lancent des avions contre les tours jumelles et votre innocence meurt en même temps que votre sentiment de sécurité, en même temps que des milliers de morts. C’est curieux ce que l’on considère comme normal jusqu’à ce qu’on n’y croie plus. »
En août dernier, alors qu’il se croyait enfin revenu à une forme de normalité, Rushdie a vu mourir pour la deuxième fois cette innocence, quand a bondi sur la scène où il s’apprêtait à prendre la parole un jeune terroriste fanatisé. Nous « verrons bien », pour le citer encore une fois, si elle trouve le moyen et la force de se requinquer. On l’espère de tout cœur, en tout cas, car penser à Rushdie, c’est aussi penser à nous.
Langages de vérité, Salman Rushdie, Actes Sud, 2022, 400 pages.
