Portrait de l’acteur en tirailleur sénégalais – sur Tirailleurs de Mathieu Vadepied
Le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied, co-produit par Omar Sy et dans lequel il joue l’un des deux rôles principaux, est en train de provoquer, suite à ses propos, une véritable affaire politico-médiatique. Le film est honorable, une sorte de remake d’Indigènes de Rachid Bouchareb, mais pour la partie subsaharienne « noire » de l’Afrique. Mais, c’est aussi d’une certaine façon un décalque de Frères d’âme de David Diop, livre multi-primé auquel Omar Sy a consacré une lecture au Festival d’Avignon en 2021[1].
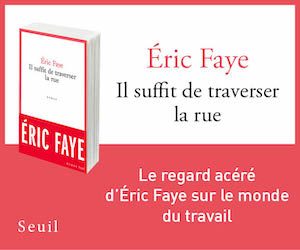
Le pitch est en effet en gros le même : l’opposition entre le beau Bakary Diallo (Omar Sy) et le chétif Thierno Diallo (Alassane Diong) à ceci près que dans Tirailleurs, l’un est le père, l’autre le fils. Le film est par ailleurs construit sur l’opposition entre un humanisme africain et une déshumanisation européenne, occidentale ou bien encore entre la préservation de l’authenticité africaine et la volonté d’assimilation aux valeurs patriotiques pratiquée par les officiers français envers les soldats africains. Bakary fait tout pour préserver son fils de cet endoctrinement, pour le protéger, le sauver de la mort et pour finalement se sacrifier pour lui.
À l’inverse le lieutenant français « blanc » est victime du désamour de son père le général qui commande les troupes et qui ne souhaite que de voir son fils périr au combat. Le lieutenant parvient à gagner à sa cause Thierno qui se prend au jeu de la bravoure et devient ainsi un parfait instrument de la hiérarchie militaire.
Comme dans le roman Frères d’âme de David Diop, on assiste à une ethnicisation du récit puisque tous les dialogues sont en pulaar, langue des Al-Pulaaren (autrefois nommés « Toucouleurs » par les Français) qui vivent sur les rives du fleuve Sénégal, région dont est originaire la famille d’Omar Sy[2].
Dans le film, Bakari et Thierno ne s’expriment qu’en pulaar et ont le plus grand mal à communiquer avec les autres tirailleurs même si on leur répond parfois en bambara, langue que Bakary a l’air de comprendre. Compartimentage ethnique, encore, puisque le soldat qui se propose d’exfiltrer Bakary et Thierno est présenté comme Sérère, une autre ethnie du Sénégal. On peut estimer toutefois que l’enfermement ethnique et linguistique dans lequel est censé être pris Bakary, et qui fonde la présence dans le film des dialogues en pulaar, est sans doute exagéré puisque l’on sait que le multilinguisme caractérise les populations de cette région[3].
Par ailleurs, ces Al-Pulaaren font eux-mêmes l’objet au début du film d’une présentation ethnologique, teintée de romantisme, puisqu’ils sont décrits comme des éleveurs poussant leurs troupeaux devant eux et vivant dans des villages reculés. Là encore, une culture sahélienne essentialisée, idéalisée et à l’abri de l’histoire est opposée de façon un peu schématique à l’horreur de la colonisation[4]. Celle-ci est symbolisée par les supplétifs sénégalais qui pourchassent et recrutent de force Thierno – ce qui pousse son père à s’enrôler lui-même dans l’armée française – et plus encore par la boucherie de la Première guerre mondiale.
Omar Sy a-t-il fendu l’armure en coproduisant Tirailleurs et en incarnant le personnage héroïque de Bakary Diallo ? A-t-il voulu rompre avec le rôle un peu mièvre qu’il joue aux côtés de François Cluzet dans le blockbuster Intouchables et qui a fait de lui le troisième personnage préféré des Français ? Sans doute pas. De fait, Omar Sy s’est engagé de longue date dans la défense des migrants et il a pris parti publiquement contre les violences policières exercées à l’encontre d’Adama Traoré, mais également de façon indirecte contre Éric Zemmour. En cela, et au-delà du personnage souriant et de la figure du gendre-surprise incarné Sydney Poitier dans Devine qui vient dîner auquel il fait penser, il faut son doute voir une authentique conviction et un véritable engagement politique.
Rendre justice à ce que l’on nomme injustement les « tirailleurs sénégalais » (puisqu’ils venaient de toutes les colonies d’Afrique occidentale française) était sans doute la motivation essentielle d’Omar Sy. Et de ce point de vue, on ne saurait qu’approuver sa démarche même si la contribution majeure des « troupes noires » au funeste carnage de 14-18 et le rôle de « chair à canon » à laquelle elles auraient servi est analysée depuis longtemps par les historiens[5].
Le film et les propos d’Omar Sy, ainsi que les réactions qu’ils suscitent, ont donc débouché sur une controverse politique qui révèle un passé colonial que la France est loin d’avoir soldé.
Mais leur rôle pendant la Grande guerre demeure peu connue du grand public à la différence des épisodes pénibles voire atroces dont ils ont été victimes pendant la Seconde guerre mondiale (massacre commis par la Wehrmacht à Chasselay dans la région lyonnaise en juin 1940, « blanchiment » par de Gaulle des troupes ayant libéré Paris en 1944, massacre des soldats africains qui réclamaient leur solde à Thiarroye au Sénégal en décembre 1944, non-reconnaissance du rôle joué par les soldats de l’empire français dans le débarquement de Provence en août 1944, etc.).
Si la France a pu vaincre difficilement l’Allemagne en 1918, si elle put racheter le déshonneur de la collaboration de Pétain avec les Nazis, c’est donc largement grâce aux troupes des colonies d’Afrique qu’elle le doit. La France doit donc leur rendre hommage, en particulier au « soldat inconnu noir » dont l’âme erre à l’Arc de Triomphe et qui est évoquée à la fin du film par le renard sauvé précédemment des barbelés par Bakary Diallo.
La presse n’a pas manifesté un enthousiasme excessif à l’égard de « Tirailleurs », c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a même parfois carrément exprimé ses réserves y compris à gauche. En témoigne par exemple Le Canard enchaîné qui range Tirailleurs dans la catégorie des « films qu’on peut voir à la rigueur »[6].
Mais ce sont les propos d’Omar Sy suite à la sortie de son film qui ont suscité les réactions les plus vives. La phrase qui a lancé la polémique est la suivante : « Je suis surpris que les gens soient si atteints (par le conflit en Ukraine). Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints ? »[7]. On est dès lors placés dans la problématique du « deux poids-deux mesures » et il est vrai que si le sort de l’Ukraine a réussi à mobiliser l’opinion et l’aide occidentale, il n’en va pas de même, sans parler de l’Afrique avec les conflits en Tchétchénie, en Irak ou en Syrie.
L’Ukraine est en effet peuplée de Blancs chrétiens, considérés comme Européens. C’est un conflit qui, comme l’on dit, « se déroule à nos portes », et il est le résultat de l’invasion par une puissance étrangère, la Russie. À l’inverse, comme l’a déclaré la journaliste Judith Waintraub, en rappelant tout d’abord les propos de la députée européenne Nathalie Loiseau relatifs à la cinquantaine de soldats français morts au Mali depuis 2013[8], les conflits en Afrique sont des « guerres civiles », autrement dit des guerres ethniques qu’elle semble opposer aux « guerres classiques » comme celle d’Ukraine. En outre, comme elle le dit dans cette même interview, les Ukrainiens ne posent pas de problèmes de « différences culturelles » et sont parfaitement « assimilables », à la différence de « certains Africains » d’ailleurs nombreux à être accueillis en France.
Or, contrairement à ce qu’elle affirme, les guerres africaines dites civiles ne peuvent être abstraites d’un environnement international. Impossible, en effet de ne pas invoquer, entre autres, l’intervention de la France de Sarkozy en Libye comme facteur de déclenchement du conflit sahélien. Les guerres soi-disant « intestines » sont donc également des guerres faisant intervenir des grandes puissances.
Le film et les propos d’Omar Sy, ainsi que les réactions qu’ils suscitent, ont donc débouché, à l’encontre de la volonté de l’acteur-producteur, sur une controverse politique qui révèle un passé colonial que la France est loin d’avoir soldé. La France est toujours tributaire de son passé esclavagiste et colonial, passé qui a resurgi récemment de façon inattendue à travers les commentaires désobligeants qui ont été faits ça et là sur la composition de l’équipe de football française finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar[9].
Là encore, on peut se demander si les joueurs noirs majoritaires, fussent-ils pour certains grassement payés, ne renvoient pas inconsciemment à l’image ancienne des « tirailleurs sénégalais », à ces « troupes noires » supplétives dont l’appoint a été décisif pour triompher de l’ennemi ? De la « chair à canon » footballistique, en quelque sorte.
Tirailleurs de Mathieu Vadepied, en salle depuis le mercredi 4 janvier.
