Pascal, roman – sur Pascal : Tombeau pour un ordre de Marianne Alphant
Il semble qu’on n’en ait jamais fini avec Pascal : peut-être parce que son œuvre elle-même – et en particulier les Pensées – n’est pas formellement finie : œuvre ouverte, en effet, laissée à l’incertitude posthume, comme un défi presque malicieux aux exégètes qui depuis près de quatre siècles proposent un ordre possible au vrac des fragments, hasardant un sens sûr au désordre, de fait, laissé derrière lui par un génie.
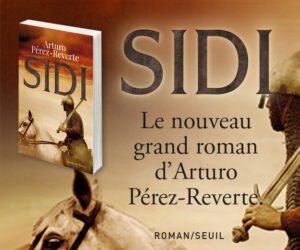
« Une espèce de bazar à propos d’un texte essentiel », écrit ainsi Marianne Alphant, dont le livre, Pascal : Tombeau pour un ordre, publié une première fois en 1998, donne à partager une aventure originale, presque intime, à nouveau explicitée dans sa préface d’aujourd’hui : « Il ne s’agit pas d’écrire sur la philosophie ou la morale de Pascal, mais d’accéder à lui à travers les éditions des Pensées, en reprenant l’histoire d’une œuvre en ruines, mais aussi, et peut-être surtout, en parlant des effets de lecture ainsi produits : effets de discontinuité, de lumière et d’obscurité, d’égarement et de fascination. »
Incertain Pascal, qui semble inviter de la sorte à des relectures infinies, et se révèle plus que jamais notre contemporain, si l’on en croit le nombre de ceux qui continuent de s’en réclamer, ne serait-ce que dans le champ littéraire… Interroge-t-on sur ses goûts un ministre en vue (comment on-dit), qui pourtant préférerait qu’on le voie comme un écrivain ? Il répond placer l’éminent et inaccessible Pascal au-dessus de tous, et même de son cher Proust. Scrute-t-on de près l’œuvre romanesque d’un hyper-contemporain comme Jean-Philippe Toussaint ? On s’aperçoit que de livre en livre, et Marianne Alphant le note en passant, celui-ci est resté fidèle à l’esprit de son premier roman, La salle de bain, maintenant le filigrane discret de Pascal en transparence de ses compositions, romancier attentif au fragmentaire et préoccupé du divertissement : le monde, la mode, le vide des art fairs, la foire aux vanités …. et Dieu ? Chez Toussaint, il arrive qu’on le croise nageant dans une piscine, dans l’absurde mouvement d’aller-retour d’un bassin même pas olympique : ceci est une autre histoire. Et c’est pourtant la même, d’une certaine manière, que raconte Marianne Alphant dans son formidable Tombeau pour un ordre.
Lorsqu’on se passionne depuis toujours pour les Pensées, il est difficile en effet de ne pas admettre que l’on cherche… mais quoi ? Un ordre, un sens, un centre, quelque chose en tout cas qui viendrait rompre l’absurde d’un Dieu crawlant d’un bord à l’autre du bassin (et du monde) : le Dieu caché de la nage, ou de la marge, qu’importe. Bien sûr, Marianne Alphant n’use guère de si triviales métaphores, mais elle raconte l’expérience éminemment personnelle de sa fréquentation d’un texte sans limite assignée, dont elle rappelle l’histoire des réceptions successives, et des éditions concurrentes, qui n’ont pas cessé : « Éditions Strowski, Souriau, Sellier, Kapla, François de Neufchâteau, Martineau, Faugère, Tourneur, Tourneur et Anzieu, Giraud, Michaut, Havet, Gazier, Dieux, Massis, Le Guern, Drioux, à mesure que la collection se développe, la lecture des Pensées s’exaspère, en quête d’un arrêt, d’un ordre introuvable, d’un vrai lieu, comme dit Pascal. »
La quête de ce « vrai lieu » fait la trame du livre, au fil de chapitres qui sont aussi un moyen de revisiter avec l’écrivaine l’espèce de cadastre problématique du texte pascalien : « Dans la chambre d’un mort », « Un champ de ruines », « La lecture et ses éclats », « L’auteur et ses figures », « Théâtre pascalien », « Figures d’un livre »… On y voit le pluriel à l’œuvre, le plus souvent, pour mettre en avant ce qu’on appellera simplement la modernité fragmentaire de Pascal. Et l’analyse détaillée qu’en fait Marianne Alphant montre bien que les agencements divers adoptés et revendiqués avec force par les éditeurs, convaincus le plus souvent d’obéir au « vrai » plan supposément prévu, ne sauraient à chaque fois convaincre, parce que l’énigme est moins dans l’intention de Pascal que dans la vérité du désordre qu’il nous a laissé, tel quel, en éclats : en éclats comme nous le sommes, nous-mêmes, aujourd’hui.
Le vertige que fait partager ce Tombeau a quelque chose de kafkaïen : tel le héros du Château, on arpente le territoire du ou des textes, ces liasses dont l’ordre échappe depuis quatre siècles, à la recherche folle d’un cœur dont on voudrait croire que Pascal lui-même a disséminé les indices pour en indiquer la voie. Mais la loi des fragments est plus forte que notre désir d’entrer au château, dont la clé demeure obstinément manquante (en allemand, le terme de château, das Schloß, on se plaît volontiers à le rappeler, désigne également la serrure)… Nous ne sommes même pas sûrs, du reste, que le château-serrure existe vraiment. Parierait-on ? On ne forcera pas davantage l’analogie, en tout cas, les exégètes pouvant sourire du parallèle entre le projet pascalien d’apologie de la religion chrétienne et la fable sans morale explicite d’un certain monde juif. Il n’empêche : ce qui se révèle commun, en lisant le Pascal de Marianne Alphant et le Kafka du Château (par exemple), c’est que l’une et l’autre dramatise d’une certaine façon l’aventure de la lecture, mise en abîme comme expérience de la vie.
C’est à un roman que s’apparente alors le Tombeau qui rappelle du théâtre les effets, les objets.
C’est précisément ce qu’écrit Marianne Alphant lorsqu’elle évoque le « théâtre de Pascal » (ailleurs il est question de son cinéma, et en particulier de Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer) : elle rappelle que Kafka fut lui-aussi lecteur de Pascal, deux fois cité dans le Journal, en particulier dans un fragment célèbre daté du 2 août 1917, recueilli dans le onzième cahier : « Pascal met tout en ordre avant l’apparition de Dieu, mais il doit y avoir un scepticisme plus grand, plus anxieux que celui de l’homme sur son trône, qui se poignarde avec, certes, de merveilleux couteaux, mais la placidité d’un boucher. D’où lui vient ce calme ? Cette sûreté dans le maniement du couteau ? Dieu est-il un char triomphal de théâtre, qu’on tire sur scène de très loin, à l’aide de cordes, en avouant toutes les peines et le désespoir des machinistes ? » (traduction de Jean-Pierre Lefebvre). La note est saisissante, et Marianne Alphant y attrape le couteau tendu par Kafka pour en faire briller la lame – coupe-papier ou surin de l’âme – dans des pages de glose d’un extrême brio, où se ressent comme une urgence la nécessité de comprendre, et un danger le fait de ne pas y parvenir : voilà le suspens infini du sens.
C’est à un roman que s’apparente alors ce Tombeau qui rappelle du théâtre les effets, les objets : nous en sommes les K, héros et lecteurs (ou « lectrice » : ainsi l’écrivaine se désigne-t-elle volontiers dans son propre texte), qui avançons dans l’arpentage sans terme des éditions et des hypothèses… Marianne Alphant en possède plusieurs dizaines, de ces éditions avec lesquelles elle vit depuis des années : et depuis des années elle cherche, comme nous qui n’avons pas son érudition mais partageons sa passion… C’est un chemin fait de cahots, et ce sont des sentiers qui bifurquent, jonchés de formules qui frappent, d’objets laissés sur le talus : « Une balle, une planche, un charbon, un coffre, une girouette, une poulie, des orgues, une tuile, un fauteuil, un luth, un grain de sable : le catalogue des objets que mentionnent les Pensées comporte encore un billard, une corde, un talon de soulier, un habit de brocatelle, un croc, une clé. Combien en tout ? Une cinquantaine peut-être. Un carrosse, une bague, des miroirs, des chaînes, un bonnet carré, un gravier, des lunettes, un tison de feu, une montre. » Énumération fascinante, elle aussi, qui donnerait presque des envies de roman perecquien à partir de ces drôles de choses abandonnées dans les ruines, et sur lesquelles il arrive que l’on retombe, sans comprendre comment. Pour cette raison également, on pourrait se croire parfois, lisant les Pensées, nous perdant au hasard du labyrinthe, dans un film de David Lynch.
Alors on cherche encore. On relit. On lit et relit les lectures des autres. On se perd, et dans cette drôle d’aventure – un roman, disions-nous – c’est un homme, tout de même, qui se laisse deviner, silhouette, figure, signature furtive de ce qui parfois ressemble à une autobiographie éclatée. Marianne Alphant est celle qui tente quelque chose comme un impossible dialogue avec lui, ce « moi haïssable » d’un être dont sa sœur Gilberte a écrit : « Non seulement il n’avait point d’attachement pour les autres, mais il ne voulait point du tout que les autres en eussent pour lui. » Et peut-être est-ce là, en définitive, et d’une bien autre façon, une clé possible pour comprendre notre attachement à Pascal aujourd’hui.
Dans un monde (littéraire) où toutes les astuces rhétoriques et facilités narratives sont bonnes pour se faire aimer, vite, il y a une jouissance spéciale à vivre l’aventure compliquée des Pensées : « quelle que soit leur édition, écrit encore Marianne Alphant, leur lecture a quelque chose d’aventureux. C’est une lecture qui s’enfonce, remonte, vole au loin, s’arrête, reprend encore. La descente y a la même ampleur que la force ascensionnelle qui propulse la pensée sur cette orbite grave où Pascal nous place sans effort, d’une seule phrase. » Sans doute n’est-ce pas la pire des places, cette « orbite grave » où nous voulons bien demeurer.
Marianne Alphant, Pascal : tombeau pour un ordre, P.O.L, 352 pages, avril 2023, 16 euros.
