Dans la maison vide – sur La fortune de Catherine Safonoff
Devenir vieille, devenir vieux. Voilà un projet raisonnable, facile et à la portée de chacun, mais auquel la plupart d’entre nous rechigne généralement. Ils ne sont pas si nombreux non plus, les écrivaines et écrivains à nous faire profiter de leur expérience du vieillir. En général, ils préfèrent continuer leurs petits tours poétiques, les concentrer, devenir toute littérature, même si y affleure in fine l’expérience du désassemblement. Par exemple Leiris, à 87 ans dans À cor et à cri (1988), réduit en éclats de lui-même, au milieu rumoral des « soubassements du monde » ; ou Duras signant un C’est tout (1995) en miettes où elle explique à Yann Andréa qui lui demande ce que « fait Duras » : « Elle fait la Littérature ».
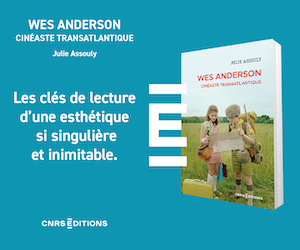
Une autre forme de livre de vieillard insiste sur la détresse et l’approche de la camuse, sans livrer toutefois la corde pour se pendre : La cérémonie des adieux (1981) de Simone de Beauvoir raconte les dernières années de Sartre, parfois atteint de délire et déclarant à une amie : « Toi aussi tu es morte, petite. Comment ça t’a fait d’être incinérée ? Enfin, nous voilà tous les deux morts, maintenant. » Le texte, perçu comme sacrilège, fit scandale en son temps. On pense aussi à la Lettre à D. (2006) d’André Gorz qui décrit la maladie de son épouse et s’achève sur ces mots : « Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l’autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. » Ils se suicident l’année suivante.
Et puis il y a l’autobiographie stoïque, apaisée, du vieillissement. Cette fois, c’est plutôt Colette qu’on pourrait convoquer. On la trouve à la page 144 de la Fortune de Catherine Safonoff : « Je remontais vers la maison, me réjouissais de revoir Mélie ou de l’attendre. La plus haute des deux collines était devenue bleu noir, une masse de nuit surplombant la mer. Au-dessus, une seule étoile très brillante, l’étoile Vesper, disais-je à Mélie. En vérité je n’en savais rien. » L’étoile Vesper (1946) est aussi le titre du premier des deux derniers récits de Colette, quand elle n’a plus vue que sur les jardins du Palais-Royal par sa fenêtre et, alitée, sur le ciel.
Catherine Safonoff, écrivaine suisse aussi essentielle que mal connue, est née en 1939. Sa narratrice, Maya, a le même âge au début du récit : 82 ans. Elle a été mariée à B. il y a longtemps, qui est un personnage récurrent de ses romans (Canouille dans La part d’Esmé, 1977, qui ressort en poche, ou Léon dans la Distance de fuite, 2017 – tous aux éditions Zoé). Elle est « mère, par lui, de deux enfants », dont Mélie. Monsieur B. a prêté à la narratrice une maison pendant 25 ans et, maintenant que la voilà vieille et malade, il décide de la récupérer. Cela ne change apparemment rien à son amitié, ni à ses visites régulières. Simplement, il répète de plus en plus souvent et d’un air badin, cette phrase qui est le miroir de celles de Sartre ou de Gorz : « On ne meurt toujours pas toi et moi ».
Au point que l’héroïne, désormais SDF, se demande s’il ne souhaite pas qu’elle disparaisse. Elle pense à un livre qu’elle a lu sur les Iks du Cameroun, dont les vieillards finissent enfermés dans des cases au ban des villages. « Motif de cette claustration : il faut jeter ce qui ne sert plus à rien. » Quant à elle, elle a été accueillie par Mélie et son mari Jeff dans leur ferme, en France, à Boinges, village imaginaire non loin de l’A40, où ils lui ont fait une chambrette au-dessus de la cuisine : « B., Monsieur B. ? Le personnage de mon leitmotiv ne menait nulle part. Il menait ici, à Boinges, à la ferme. Il m’avait « envoyée à la campagne », comme le disaient les dirigeants chinois d’un élément gênant. »
Elle, de son côté, pense « Je n’irai pas aux funérailles de Monsieur B. », le dit à leur fille, tout en se rendant compte « qu’aucun oracle n’avait prédit qu’il me précède dans la mort ». La Fortune est ainsi un texte de lutte contre le ressentiment : comment la narratrice peut-elle ne pas en vouloir à Monsieur B., ce personnage essentiel de ses autofictions ? C’est un peu comme Dieu, on a beau ne pas y croire, c’est plus pratique d’en parler que de l’ignorer.
La Fortune est un livre sur l’écriture de la vie où le récit est aussi indéterminé, instable que l’existence elle-même.
Peut-être que la Fortune se recommande à ceux qui commencent à vieillir et/ou qui aident leurs parents en fin de vie. Ils y reconnaîtront l’enchaînement des péripéties du quatrième âge (chutes, fatigue, maladies), les troubles cognitifs en moins car on a rarement lu plus lucide[1] que Safonoff, y compris chez les trentenaires. Mais enfin, voilà, « les choses usuelles, les interrupteurs, les lunettes, les lampes de poche, les briquets – je perds tout, je mélange tout, tout m’échappe, je laisse tout tomber, je tombe moi-même. » Elle note : « deuxième crise cardiaque, en novembre 21, et ses séquelles, le déclin brutal de mes facultés ». En août 23 : « la troisième chute est quand même survenue. La troisième, la énième, l’imparable en dépit de toutes les parades. Je fais une dépression, me disais-je, comme l’été précédent, le verbe faire pour banaliser ce qui m’arrivait. » En janvier de la même année, à son cardiologue : « J’ai prétendu ne pas avoir peur de la mort mais de la douleur, terriblement. N’ai pas dit que la peine de mourir était en train depuis pas mal de temps. »
À la différence de nous ou de nos vieux parents en charpie, Catherine Safonoff est artiste : aussi bien son travail ne lui permet pas d’être dans le déni, sans quoi il cesserait d’exister : « C’est que tu es très vieille et que tu n’en peux plus, personne n’écrit dans cet état » note Maya. Et c’est dommage, il nous faut plus de livres comme celui-ci, écrits depuis la vie en pleine vie, sans fards, légèrement dysfonctionnelle (puisque c’est en vieillissant qu’on se rend compte que la vie est par nature dysfonctionnelle et que, quand ça ne dysfonctionne plus, c’est qu’on est mort).
Par facilité, on a évidemment envie de dire que cette histoire d’expropriation est une métaphore du vieillir, chose inhospitalière. Il n’y a pas ou presque pas d’intérieurs dans La Fortune, seulement des trajets, des routes, des promenades car la narratrice cherche à habiter la ferme en cartographiant les environs, mais n’y arrive pas (« Pas le temps d’ailleurs. »).
Elle se plonge à la place dans des épiphanies ordinaires, entre sentiers, mobilier urbain et couleur des arbres : « J’ai rejoint la route au pont de Sierne. J’avais marché au-dessus de mes forces. Tant que je pourrai, épuiser le corps pour épuiser la mélancolie. L’abribus de Villette est en bois peint en vert pâle. Sous le banc, une mousse en plastique était roulée, collée avec du scotch ; quelqu’un avait dormi là ? Par chance, le bus 8 arrivait. J’ai levé le bras. Plus loin, personne n’attendait à mon arrêt familier. Autre chose certaine, je ne repasserais jamais auprès de mon ancienne maison. Je l’habitais toujours, je n’étais pas partie. » Le seul intérieur décrit ici, c’est l’absence des livres aux murs, restés en partie dans les cartons du déménagement.
Facilité, aussi, que de penser que ces promenades d’une rêveuse solitaire sont une forme d’anamnèse : « je n’allais pas mais je pensais. Pensais comme je pouvais dans le goutte-à-goutte du temps. » Catherine Safonoff revient sur les épisodes de sa vie avec Monsieur B., les autres femmes de celui-ci, Boston, road-trips, le swinging London de sa jeunesse dorée, la rencontre de celui qui s’appelle Lancelot dans La Part d’Esmé, son autre fille, Ji : « c’est il y a cinquante ans, ma vision du regard de la toute petite. » Une « interminable Lettre aux miens ».
Un des chapitres nous entraîne dans une soirée tragicomique en 2022 chez son éditeur, où un confrère lui raconte son amour de l’imparfait du subjonctif et lui en donne plein d’exemples (« que nous distinguassions, que vous gagnassiez »…) : mais la narratrice se demande à quelles propositions principales ces subordonnées hypothétiques pourraient bien correspondre.
Car La Fortune est bien sûr un livre sur l’écriture de la vie (normal pour une autofiction) : « entrevoir de loin une scène est une chose, la rendre vraie par l’écriture, une autre ». Le récit est aussi indéterminé, instable que l’existence elle-même. À la toute fin, Maya explique comment elle a trouvé le titre La Fortune, « le titre, mais la fin, non, elle ne venait pas », ce qui, à la fin, est embêtant. Dès son premier livre, La Part d’Esmé (qu’on entendra volontiers comme « la part d’aimer »), Safonoff mettait en scène cette complexité du rapport à la véridiction autofictive : « Voilà, je commence déjà à faire des gribouillis dans les bords de la page, c’est mauvais signe, c’est signe que je ne crois déjà plus à ma lettre ».
Peut-être la vieillesse simplifie-t-elle un peu la donne : l’autrice se joue de (et surjoue) un des avantages de la sénilité : c’est que, dans la confusion et la désorientation, tout se mélange et se rassemble pour former une coque d’où le sujet peut encore s’exprimer. « La maison est vide » mais c’est une maison. Ici, Boinges devient aisément la Grèce où l’héroïne a commencé son premier texte (non publié, dit-elle, dans le goût du nouveau roman, suivi de dix ans de silence) et où elle se rend avec Mélie : « En vacances, je suis en vacances ? Ma petite Mélie, depuis que je suis en résidence à la ferme, je flotte dans une même brume, Grèce ou grotte en Haute-Savoie c’est kif-kif. Ne pars pas, m’a dit le portillon de la ferme. Ne pars pas, a redit le trottoir craquelé du Pirée. »
Parmi les nombreuses pages merveilleuses que compte La Fortune, l’une d’elles raconte le ravissement de Maya par un membre d’équipage du ferry Myconos (« ce nom veut dire tas de rocs empilés »), qui l’embarque parce que trop faible pour marcher : « je me suis mise à pleurer dès que j’ai senti son bras autour de moi. Il avait un léger parfum, peut-être de lavande. Nous montions vers les ponts. Je n’avais pas de billet, je n’avais rien que ce bras qui me tenait, mes larmes et l’homme qui me disait que tout allait bien, no worry, everything ok. »
Qu’ajouter après ce transport, cet enthousiasme au sens littéral (« possession divine »), sinon peut-être l’avant-dernière parole du Christ sur la croix : « Tout est accompli ». Sentiment de finitude paradoxal puisque Jésus aura encore une septième parole. « Mon rouleau était au bout » écrit Safonoff, mais comme tout ce qui se dévide, on n’en voit pas la fin.
Catherine Safonoff, La fortune, Éditions Zoé, avril 2024
