Face à l’extractivisme vert au Portugal – sur Covas do Barroso de Paulo Carneiro
Le film Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective sort en France cette semaine. Dans ce long-métrage, le réalisateur portugais Paulo Carneiro met en scène le combat d’un village contre un projet minier controversé, porté depuis 2017 par la société britannique Savannah Resources. Celle-ci ambitionne d’implanter sur le territoire de Barroso ce qui pourrait devenir la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d’Europe.
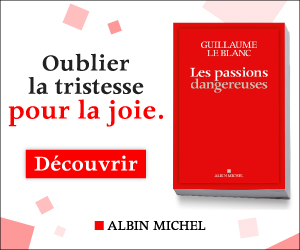
Destinée à produire chaque année de quoi équiper entre 500 000 et un million de batteries de véhicules électriques, l’exploitation devrait entrer en service en 2027 pour une durée minimale de douze ans. L’APA, agence de protection de l’environnement du Portugal, a donné son feu vert au projet fin mai 2023.
En 2018, ce territoire situé au nord du Portugal dans la région de Trás-os-Montes (« derrière les monts ») a pourtant été classé Système Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Au nombre de 89 dans le monde, dont 11 seulement en Europe, les SIPAM « représentent non seulement des paysages naturels inouïs, mais également des pratiques agricoles qui génèrent des moyens de subsistance dans les zones rurales tout en combinant de manière unique la biodiversité, des écosystèmes résilients, traditions et innovations », indique la FAO.
Au-delà de la mise en péril d’un patrimoine agricole et culturel exceptionnel, l’exploitation minière pourrait provoquer plusieurs dommages environnementaux : forte consommation d’eau dans une région où la pénurie se fait sentir, pollution, fragmentation des écosystèmes, atteinte à la biodiversité… Or, ce territoire borde le parc national de Peneda-Gerês, lui-même intégré à la réserve de biosphère transfrontalière Gerês-Xurés, l’une des plus vastes d’Europe, reconnue par l’Unesco en 2009.
Face à cette menace sur l’écosystème et le paysage, les habitant·es de Covas do Barroso ont déployé une résistance déterminée et multiforme. La population ne rejette pas les énergies renouvelables en tant que telles, mais s’oppose à la destruction de son territoire, de son mode de vie et des perspectives des générations futures, au nom d’une transition dite « verte » qui, en réalité, ne l’est pas. Organisé·es depuis 2018 au sein de l’association Unidos em Defesa de Covas do Barroso, ils et elles ont engagé des actions en justice pour contester l’approbation environnementale du projet, tout en mobilisant un large soutien à travers des pétitions signées par plusieurs milliers de citoyens et des résolutions municipales condamnant l’initiative.
Sur le terrain, occupations, manifestations, campements de protestation et rassemblements ont rythmé leur lutte, attirant activistes et médias bien au-delà des frontières locales. En parallèle, ils et elles ont mené un important travail de mobilisation et de plaidoyer, en participant à des conférences et en collaborant avec des organisations environnementales internationales, afin de visibiliser leur lutte, et de renforcer les alliances contre l’extractivisme. Le mouvement s’est notamment inscrit dans des réseaux anti-mines translocaux, qui permettent aux communautés concernées de partager des informations et de renforcer leurs capacités d’action. Ils et elles ont ainsi porté une contestation qui dépasse leur village, interrogeant les contradictions d’un modèle qui perpétue les logiques extractivistes sous couvert d’écologie.
Écologie des villes, écologie des champs : une relation sensible à la terre
Malgré ce que suggère son titre, Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective, qui évoque une narration linéaire et engagée, le film ne se limite pas au registre du documentaire militant classique. Au contraire, il adopte une approche décalée, non dénuée de dérision. Le jeu de mots du titre original portugais, A Savana e a Montanha, opposant l’entreprise Savannah Resources à la montagneuse Covas do Barroso, emblème de la résistance des habitant·es, reflète sans doute mieux son esprit. « Je crois que pour parler d’un sujet sérieux, il faut utiliser l’humour, et les habitants de Covas do Barroso ont beaucoup d’autodérision, et leur ironie va aussi de pair avec l’absurdité de ce qui se passe là-bas », souligne Paulo Carneiro.
Son film brouille alors les frontières avec la fiction, empruntant au western, au théâtre populaire et au cinéma militant pour raconter une lutte où se conjuguent engagement et créativité. Loin d’une approche didactique – qu’adopte par exemple le documentaire Transition sous tension (2024) de Violeta Ramirez sur le projet d’implantation d’une mine de lithium dans l’Allier – ou même informative, il repose sur une mise en scène inventive dans laquelle les habitant·es rejouent leur propre combat, mêlant reconstitutions et scènes théâtralisées. En plaçant la participation collective au cœur du récit, le film témoigne aussi de la force du collectif face aux logiques extractivistes qui le menacent. Cette dimension collective s’exprime également à travers la musique de Carlos Libo, habitant de Covas et compositeur, dont les mélodies imprègnent le film et en accentuent la charge émotionnelle. Si sa chanson Exploração a déjà accompagné de nombreuses manifestations de protestation, c’est ici Hora de Lutar qui occupe une place centrale : ses paroles appellent la communauté à se mobiliser avec détermination, à ne pas céder au découragement.
Mais Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective ne se contente pas de montrer l’opposition à un projet industriel ; il met aussi en lumière le lien profond qui unit les villageois à leur environnement. Plus qu’un simple récit de résistance, le film restitue l’essence-même de cette lutte : une relation intime avec un territoire menacé. Ici, la terre n’est pas un décor, mais un héritage vivant, un écosystème où humains et animaux cohabitent dans une interdépendance fragile. Rythmé par le cycle des saisons, le film capte l’intimité de ce rapport, fait de gestes quotidiens et d’une attention constante au vivant. La scène d’ouverture l’illustre, où l’on découvre Carlos Libo, qui est aussi éleveur de chevaux et apiculteur, s’y adresser avec douceur à « Castanho », un cheval, tentant d’apaiser la nervosité de l’animal, qui semble ressentir la menace pesant sur sa terre.
Ce lien à la nature est au cœur du combat. À rebours des discours vantant l’extraction du lithium comme un progrès écologique et une occasion de développement pour une « région moribonde », Covas do Barroso révèle comment cette industrie bouleverse les territoires ruraux et détruit des équilibres fragiles au nom d’un développement imposé de l’extérieur. Les villageois·es défendent une autre vision du monde, fondée sur l’interdépendance entre l’humain et son milieu.
La ruée vers le lithium, encouragée par l’Union européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et renforcer sa souveraineté énergétique face à la domination chinoise sur ce marché, soulève de fait un paradoxe : peut-on réellement parler de transition écologique si celle-ci reproduit les logiques extractivistes héritées de l’économie fossile ? Ne faisons-nous pas que déplacer la pression environnementale en sacrifiant certains territoires pour assurer l’approvisionnement en métaux stratégiques ? Ce débat met en lumière un clivage récurrent : d’un côté, une écologie centrée sur la question climatique, qui se revendique comme moderne et inscrite dans un discours de progrès ; de l’autre, une écologie attachée aux liens avec la terre, souvent reléguée au rang d’archaïsme. La violence spatiale sous-jacente à l’extractivisme vert et à la colonisation infrastructurelle repose sur un récit qui dépeint les espaces ruraux comme « arriérés ». Les acteurs étatiques et les entreprises porteuses de cette nouvelle vague d’exploitation des ressources en milieu rural européen prolongent une vision du développement et de la modernité qui associe la ruralité à la dépopulation et à des économies supposées obsolètes, nécessitant une industrialisation salvatrice.
Dans le cadre des réflexions sur les injustices environnementales, il s’agit ainsi de souligner l’importance de la dichotomie entre zones rurales et urbaines. Pour les habitant·es mobilisé·es de Covas do Barroso, l’extraction du lithium relève en tous cas d’une écologie conçue pour les villes, qui impose à des territoires périphériques le poids de la transition, sans leur en offrir les bénéfices. « Il faudrait polluer nos villages pour dépolluer les villes ? », s’interroge l’éleveur Nelson Gomes. Une inquiétude partagée par le berger Paulo Pires, qui précise : « Je ne suis pas contre le lithium (…), mais je refuse que l’on pollue mon village et d’autres comme le mien pour dépolluer les villes ».
À cette perception d’une écologie qui sacrifie des territoires ruraux, s’ajoute une défiance propre au clivage Nord/Sud : « Les riches du Nord ne se soucient pas de nos villages », déplore Aida Fernandes dans le film. Ce sentiment d’injustice est renforcé par le manque de concertation et d’information autour du projet. Les habitants ont en effet découvert l’existence des prospections minières par les médias, une fois celles-ci engagées, sans avoir été consultés en amont. L’entreprise a mené des négociations ciblées avec plusieurs propriétaires privés – notamment en usant pour obtenir les ventes de la menace d’une possible future expropriation des terres décidée par l’État – sans en informer les collectivités locales. La défiance envers les autorités centrales, qui ont donné leur aval au projet, est exacerbée par le scandale de corruption et trafic d’influence dans les concessions de prospection de lithium dans le nord du pays, qui a conduit à la démission du Premier ministre, António Costa, en novembre 2023.
Dans le rapport sur le classement en SIPAM du système agro-sylvo-pastoral du Barroso, la FAO insiste particulièrement sur le rôle des baldios comme fondements de cette organisation sociale communautaire résiliente. Terres en propriété collective, dont le droit de jouissance appartient aux habitant·es et est lié à la résidence, les baldios servaient traditionnellement au Portugal à divers usages essentiels : le pâturage des moutons, porcs et bovins, la collecte de bois pour se chauffer, de branches et feuillages pour la litière des animaux et comme engrais, de matériaux pour les constructions, de fruits sauvages, ou encore la production de miel.
Certaines terres étaient également cultivées. Ressources clés pour la survie des populations rurales, elles sont donc loin d’être des terres inutilisées comme le laisse entendre l’origine du mot baldio – dérivé de l’arabe bâṭil, qui signifie « inutile ». Leur gestion reposait sur des règles coutumières garantissant un accès collectif et équitable. Aujourd’hui encore, les baldios couvrent environ 500 000 hectares, soit un peu plus de 5 % de la surface du Portugal, et restent particulièrement présents dans les régions montagneuses du Nord, où ils demeurent un socle essentiel de l’organisation sociale communautaire et de l’économie agro-pastorale.
Or 75 % des zones visées par le projet d’extraction de lithium sont des baldios. Si Savannah Resources a pu acquérir certaines terres privées dans le cadre du projet, l’enjeu est tout autre pour ces terres communautaires, dont l’exploitation nécessiterait l’accord des usager·ères. Aida Fernandes, qui avec son mari Nelson Gomes, est une figure centrale de la mobilisation, préside le Conselho Diretivo dos baldios de Covas do Barroso – après qu’une personne employée par Savannah Resources ait tenté d’occuper cette position stratégique. Ainsi, Covas do Barroso. Chronique d’une lutte collective s’inscrit aussi dans une histoire plus vaste, celle des baldios, ces terres communautaires qui, depuis des siècles, sont le théâtre de tensions entre logiques d’accaparement et préservation des communs.
Les baldios convoités : une alternative à la gestion privée ou étatique des terres
Les baldios ont des origines si anciennes au Portugal qu’elles se perdent dans le temps. Leur possession a cependant toujours été marquée par une grande précarité, les communautés rurales devant continuellement faire face aux risques de confiscation par divers acteurs. Ces tentatives d’accaparement se sont succédées sous tous les régimes politiques, d’abord par la privatisation sous les monarchies et la Première République, puis par une mainmise des services de l’État sur ces terres sous la dictature salazariste. Si la première grande offensive contre les baldios remonte à la loi des Sesmarias de 1375 – qui, en réaction aux ravages de la peste noire de 1348, visait à fixer les travailleurs ruraux à la terre pour enrayer le dépeuplement –, plusieurs autres dispositions à leur encontre ont suivi au fil des siècles. Ici, nous nous concentrerons sur les plus récentes, qui ont profondément transformé leur statut et leur usage.
Les baldios sont particulièrement critiqués à partir du 18e siècle avec le développement des doctrines physiocratiques. Margarida Sobral Neto le résume : « tous les physiocrates portugais considéraient l’existence des baldios comme un obstacle au progrès agricole et plaidaient pour les mettre en culture, afin d’augmenter la production et la productivité agricole et d’améliorer la qualité des pâturages. Beaucoup associaient les notions de collectif et d’improductif, et considéraient l’individualisme agraire comme le moyen le plus efficace pour développer l’agriculture ». Cette remise en cause s’accentue au 19e siècle avec la montée du libéralisme économique : plusieurs réformes foncières cherchent alors à privatiser ces terres sous prétexte de modernisation agricole, déclenchant en retour des révoltes paysannes.
Jusqu’en 1875, les baldios couvrent toutefois encore une superficie de 4 millions d’hectares – soit plus de 40% du territoire portugais. L’offensive contre les baldios ne s’interrompt pas avec l’avènement de la République en 1910. Au contraire, sous l’influence des idées libérales et du développement du capitalisme, le partage, la privatisation et la mise en culture des communaux sont perçus comme des réponses nécessaires face aux défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.
Mais cette pression s’intensifie après le coup d’État de 1926 et l’instauration de l’Estado Novo en 1933. S’ouvre une période particulièrement sombre pour les baldios. Sous la dictature de Salazar, les communautés rurales sont progressivement dépossédées de leurs terres. Entre 1932 et 1938, une nouvelle politique des baldios se met en place, à la fois par l’adoption d’une législation spécifique et par la création en 1936 de la Junta de Colonização Interna (JCI) chargée du recensement des terres. Le régime de l’Estado Novo, qui mise sur une politique d’autosuffisance alimentaire, confie à la JCI la supervision de l’installation de familles colons agricoles.
L’offensive contre les baldios s’appuie alors sur un discours dépréciant la culture agro-pastorale, assimilée à la paresse – les populations ne produisant que le nécessaire – et à la promiscuité. En témoignent par exemple les rapports de la JCI sur le territoire du Barroso qui, au début des années 1940, insistent sur la résistance à l’évolution civilisatrice d’une population « fainéante » et aux mœurs « permissives », ainsi que sur la nécessité conséquente « d’éduquer le barrosão à la culture rationnelle et intensive de ses terres ». L’essentiel des terres n’est toutefois finalement pas consacré à l’installation agricole, mais confié aux services forestiers pour un vaste programme de reboisement – la forêt autochtone étant remplacée par des espèces plus rentables pour l’industrie et le commerce, en particulier le pin maritime. En 1938, un plan d’arborisation est lancé qui prévoit la reforestation totale des baldios et la construction de routes et d’infrastructures forestières. Bien que la loi mentionne un recensement des pratiques locales, les enquêtes concluent systématiquement à l’« inutilité » des baldios pour les populations, fournissant un prétexte à leur expropriation.
Les baldios ne sont pas de simples vestiges d’un passé révolu ; ils offrent une voie possible vers un développement plus résilient et plus équitable.
L’entreprise de soumission des baldios au régime forestier[1] a suscité une résistance multiforme de la part des communautés rurales. Certaines stratégies étaient discrètes, comme le refus de transmettre aux autorités les informations demandées sur ces terres ou l’envoi au gouvernement par les communautés rurales et les acteurs locaux de pétitions et de rapports dénonçant les effets néfastes de l’expropriation. D’autres formes de contestation relevaient du sabotage : planter les arbres à l’envers pour compromettre le reboisement, propager de fausses rumeurs selon lesquelles des terrains privés allaient également être saisis, ou encore braver les interdictions en envoyant le bétail paître sur les zones concernées, au risque de lourdes amendes.
Dans les cas les plus extrêmes, aussi plus rares, des incendies étaient déclenchés clandestinement pour détruire les plantations imposées, et des affrontements directs avec les autorités éclataient. Mais ces actes de résistance s’opéraient dans un climat de forte répression. Les emprisonnements étaient fréquents. A partir de 1954, un décret-loi autorisa les gardes forestiers à porter des armes, renforçant le contrôle sur ces terres. Quatre ans plus tard, Aquilino Ribeiro, figure majeure de la littérature portugaise, publie Quando os lobos uivam (Quand les loups hurlent), qui lui vaudra d’être inculpé pour « décrédibilisation des institutions en place » : à travers la lutte des paysans contre la confiscation de leurs terres, il met en lumière les premiers signes du déclin des communautés rurales face aux actions d’un pouvoir central autoritaire. Le régime salazariste censure le roman, ordonne la saisie des exemplaires disponibles et interdit toute réédition ou critique dans la presse.
Après la Révolution des Œillets, un décret-loi de 1976 restitue ces terres aux communautés rurales, à condition que des assemblées regroupant les habitant·es ayant droit à l’usage du baldio, appelé·es compartes, soient créées [2]. La Constitution reconnait par ailleurs les « moyens de production communautaires détenus et gérés par les communautés locales ». Le choix doit alors se faire entre deux modes de gestion – le second ayant été majoritairement adopté : la gestion communautaire exclusive, dans laquelle les décisions sont prises par les assemblées de compartes ; ou la cogestion entre la communauté et l’État.
Mais cette restitution intervient dans un contexte transformé par le dépeuplement rural et l’érosion des structures collectives traditionnelles. Sous l’effet de l’exode rural et de l’immigration massive, les baldios voient leur rôle productif traditionnel diminuer. Il s’agit sans doute de l’effet le plus marquant de la politique menée contre les baldios sous la dictature : lorsqu’ils sont rendus au peuple, c’est dans un contexte où les pâturages naturels et le cheptel ovin et caprin ont considérablement diminué, et où la population paysanne s’est fortement réduite. Conséquemment, en ce qui concerne la restauration de la relation traditionnelle des communautés avec les baldios, leur restitution a eu « une portée limitée ». Conséquence frappante de cette évolution, l’augmentation du risque de propagation des incendies est évidente : autrefois, la végétation arbustive restait contenue grâce au pâturage du bétail et à la coupe du mato (broussailles) pour la litière et l’amendement des sols ; avec la dépopulation, la végétation a proliféré, créant un terreau propice aux feux de forêt. Autrefois maîtrisables grâce à une mobilisation collective, ces incendies sont désormais plus difficiles à contenir, surtout lorsque chaleur et vents secs en favorisent la propagation.
Aujourd’hui, bien des communautés voient moins les baldios comme un moyen de subsistance que comme une source de revenus, rendue possible par le développement d’activités telles que la foresterie commerciale (vente de bois), la location de terrains pour parcs éoliens, ou le développement de projets touristiques et récréatifs. « D’une communauté d’usagers du baldio, on est passé, dans de nombreux cas, à un organe de gestion de revenus. » Lorsque le baldio est administré dans une logique rentière, le principal risque est un affaiblissement des liens communautaires.
On observe plus précisément aujourd’hui un contraste entre deux modèles de gestion de ces terres. D’un côté, un modèle de gestion collective et solidaire, qui mise sur la revitalisation des communautés, encourage l’économie sociale et combine pratiques traditionnelles et nouvelles activités économiques. Les revenus générés sont réinvestis dans des infrastructures locales, telles que les écoles, les services de santé ou les routes, renforçant ainsi la cohésion du territoire. De l’autre, un modèle orienté vers le marché, où les baldios sont exploités à des fins commerciales, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’industrie. Cette approche favorise la marchandisation des terres et leur ouverture aux investisseurs externes, au détriment du lien avec la communauté locale, qui se trouve peu à peu dépossédée de son droit d’usage. Cette déconnexion s’accompagne d’une perte progressive du sens du bien commun.
Les études sur la gestion contemporaine des baldios mettent en évidence deux défis majeurs : la faible participation des compartes et le problème de renouvellement générationnel. Ces fragilités font peser la menace d’un transfert de leur gestion aux municipalités locales et aux structures intercommunales, éloignant encore davantage le contrôle des terres des communautés concernées. Face à ces enjeux, une loi adoptée en 2017 vise à renforcer l’autonomie des communautés locales et à adapter les modèles de gestion aux réalités contemporaines. Parmi ses principales dispositions figure la création des Agrupamentos de Baldios (Groupements de Baldios) qui encouragent la coopération entre communautés afin d’assurer une gestion collective plus efficace, en facilitant l’accès aux ressources et à un accompagnement technique renforcé.
Toutefois, bien que fragilisé par les transformations économiques et politiques des 19e et 20e siècles, le régime communautaire continue de structurer une partie du monde rural portugais, où persistent des formes d’organisation collectivistes. C’est notamment le cas à Covas do Barroso, où les terres collectives reposent sur un modèle de gouvernance participatif. Contrairement à d’autres villages où la gestion des baldios relève du conseil municipal, elle est assurée par un conseil directif, créé dans les années 2000, chargé de mettre en œuvre les décisions prises par l’assemblée générale des compartes.
Pourtant, malgré cette organisation démocratique, l’État a ignoré la volonté des compartes – qui se sont à plusieurs reprises prononcés contre la location des terres à Savannah Resources. De fait, les gouvernants voient dans la transition énergétique une « opportunité » pour le développement du Portugal – au-delà du souci de respecter les accords de Paris. Cette logique s’est traduite, en décembre 2024, par l’imposition d’une servitude administrative permettant à Savannah Resources d’accéder, pendant un an, aux baldios ainsi qu’à des propriétés privées pour y mener des prospections. Bien que trois propriétaires aient obtenu, en février dernier, une injonction provisoire (providência cautelar) du Tribunal Administratif et Fiscal de Mirandela suspendant les travaux, cette interruption n’a été que temporaire. Le ministère de l’Environnement et de l’Énergie a rapidement invoqué « l’intérêt public » pour annuler l’effet suspensif et autoriser la reprise des prospections.
•
Partout au Portugal, les communautés rurales s’efforcent de revitaliser leurs baldios en explorant des modèles de gestion innovants. Certaines misent sur l’agriculture biologique, l’écotourisme ou la foresterie durable pour renforcer leur autonomie économique tout en préservant leur environnement. D’autres se regroupent pour mutualiser leurs ressources et accroître leur capacité de résistance face aux pressions foncières et industrielles. Les baldios ne sont pas de simples vestiges d’un passé révolu ; ils peuvent constituer une alternative crédible et désirable à une gestion exclusivement privée ou étatique des ressources naturelles. En s’appuyant sur une gouvernance participative et une approche écosystémique, ils offrent une voie possible vers un développement plus résilient et plus équitable. Pourtant, leur pérennité est loin d’être assurée. Si le cadre juridique portugais reconnaît leur spécificité, leur survie dépendra de la capacité des communautés à résister aux logiques de marchandisation et d’accaparement des terres.
À l’heure où la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité sont devenues des priorités mondiales, la reconnaissance du rôle des baldios dans ces dynamiques pourrait leur conférer une légitimité renforcée et favoriser leur intégration dans les politiques publiques. Plus qu’un reliquat d’un modèle ancestral, ils doivent être envisagés comme une source d’inspiration pour repenser la gestion collective des ressources naturelles. Ainsi, les luttes pour défendre les baldios posent la question fondamentale du rapport que nous voulons établir avec nos territoires et nos biens communs. Seront-ils protégés comme des espaces de gouvernance partagée et de préservation des écosystèmes, ou seront-ils peu à peu absorbés par des logiques extractivistes ? L’avenir de ces terres repose autant sur la mobilisation des communautés locales que sur une volonté politique claire de reconnaître leur valeur en tant que patrimoine rural et écologique essentiel à la transition vers un monde plus soutenable.
