Arturo Escobar : « Il ne peut tout simplement pas y avoir un seul universalisme »
Quand on le rencontre à Paris, Arturo Escobar revient tout juste de la bibliothèque de la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. Il y a parlé de son dernier livre, Sentir-Penser avec la terre, mais aussi de ce que les expériences de luttes territoriales latino-américaines peuvent apprendre en contexte breton. Pas évident quand on professe, notamment à l’université de North Carolina aux États-Unis, le plurivers, l’altérité radicale de l’Amérique Latine. RB
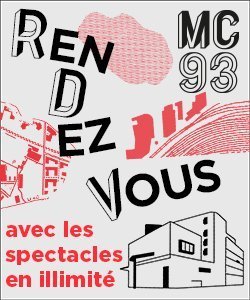
Peut-être qu’on peut commencer par expliquer le titre de votre livre… Sentir-penser avec la Terre, qui traduit en français le concept du Sentipensar (Sentir-Penser) théorisé par votre compatriote, le sociologue colombien Orlando Fals Borda. Comment permet-il de penser différemment la question écologique ?
Le titre du livre comprend deux parties : « Sentir-Penser » et « avec la Terre ». Sa finalité, c’est de porter l’attention sur ce qui arrive à la Terre, et sur la lutte pour la défense de la vie dans laquelle beaucoup de gens sont impliqués aujourd’hui. Contre le changement climatique, bien entendu, mais les dévastations écologiques, économiques et sociales vont bien au-delà. Mon hypothèse de départ, c’est qu’on vit actuellement une crise très profonde, une crise civilisationnelle dénoncée par un certain nombre d’activistes dans différentes parties du monde mais qui touche plus spécifiquement les peuples indigènes d’Amérique Latine. Ce que je suggère, c’est qu’on est face à une crise multiple : climat, énergie, inégalité… mais aussi une crise de sens, on ne sait plus comment donner sens au monde, comment le construire. La question est « civilisationnelle », même si le mot peut poser problème, parce qu’on est en train de dévaster la Terre qui accueille toutes les formes de vie. Donc, pourquoi Sentir-Penser, d’abord parce que c’est un concept de plus en plus utilisé par les activistes en Amérique Latine. J’ai siégé récemment dans le jury de thèse d’une étudiante mexicaine à La Haye, à l’Institute of social study, et elle utilisait beaucoup ce concept dans le cadre de son travail sur le Chiapas au Mexique. Parce qu’il nous permet ensuite d’aller au-delà du savoir établi, du savoir des experts, des scientifiques et de la rationalité. Cela ne veut pas dire que ces savoirs ne sont plus valides, ils le sont toujours, et utiles aussi. Je pense toutefois qu’ils font aussi partie du problème, parce qu’ils ont fragmenté la terre en petites unités que les scientifiques tentent de faire tenir ensemble de manière précaire. La pluralité, la multiplicité des savoirs permettraient pourtant de s’ouvrir à des approches plus holistiques, plus intégratrices en prenant en compte la sagesse de nombreux peuples qui, à travers le monde, coexistent avec la terre. C’est un appel à prendre conscience que, si la science moderne est importante – et encore une fois elle l’est pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés – il nous faut recourir non seulement à d’autres formes de savoirs, mais aussi d’autres façons d’être, d’autres manières de comprendre le monde.
Votre livre pose aussi une question épistémique, en s’intéressant par exemple à la façon dont l’occident fait de la science en mettant l’expertise au-dessus de l’expérience. C’est une erreur selon vous car ce que vous montrez, c’est que le savoir vient autant des mouvements sociaux que des laboratoires et des universités.
C’est une évidence, les mouvements sociaux sont bien plus sensibles aux dévastations de la Terre, à la problématique du changement climatique. C’est le cas par exemple des mouvements noirs en Colombie, ou des mouvements indigènes, qui ont un savoir très structuré et articulé à une pratique, à des propositions pour un « plan de vie » (planes de vida). C’est pour ça qu’il nous faut prendre au sérieux ce type de savoirs, que les chercheurs occidentaux ont tendance à marginaliser. Que ce soit dans ce que j’appelle le Nord global ou le Sud global, ils supposent que le monde se divise entre eux et nous, entre ceux qui ont le savoir et ceux qui ont l’expérience. Rien n’est plus faux. L’autre point important, c’est la critique à mon avis très pertinente, de la configuration moderne du savoir, de l’épistèmê moderne. C’est l’idée développée par Michel Foucault lui-même lorsqu’il fait l’histoire de cette épistémê qui court en Europe depuis la Renaissance à l’âge Classique puis à l’âge Moderne et qui place l’Homme au centre. Un anthropocentrisme dominé par une approche dualiste et l’importance donnée aux experts, et qui rend totalement invisibles les autres formes de savoirs tirés de l’expérience, de la spiritualité, de l’intuition…
C’est là qu’intervient la politique. Selon vous, il nous faut « décoloniser le savoir ». Précisons que cette notion de décolonisation a un sens différent en Amérique du Sud que celui que nous pouvons lui donner ici en France. Qu’entendez-vous par ce savoir décolonisé ?
Oui c’est en effet très important de faire cette différence entre la France et l’Amérique Latine quand on aborde ce sujet de la décolonisation, même si je constate que désormais certains utilisent chez vous ce terme dans le sens que nous pouvons lui donner… mais c’est un autre sujet. Ce qui caractérise l’idée d’un savoir décolonisé, c’est la critique de différentes interprétations de la Modernité et spécifiquement l’approche européenne. Il ne s’agit pas, encore une fois, de dire qu’elle est fausse, c’est juste que nous insistons sur autre chose. Si on veut comprendre cette nouvelle manière de penser en Amérique latine – qui n’est pas si nouvelle et doit avoir à peu près 25 ou 30 ans – il faut comprendre qu’elle se penche d’abord sur les conséquences de la Modernité depuis 1492 sur le savoir, l’expérience, l’ontologie et la vision du monde des peuples indigènes et afro-descendants. Il faut parler de « colonialisme du savoir » et imaginer que depuis la période de la conquête, il y a cette face cachée, cette domination de la modernité européenne qui a systématiquement marginalisé le savoir et l’expérience des autres peuples. La décolonisation épistémique renvoie à un programme pour ramener ces savoirs à la visibilité… et pas seulement à la visibilité, mais au maintien des fondements de la réalité qu’ils sous-tendent.
Vous utilisez beaucoup les travaux de l’anthropologue britannique Tim Ingold, sur la domination de la raison abstraite sur toutes les formes de pensée. Vous interrogez aussi la distinction entre nature et culture en vous référant à Philippe Descola. Comment est-ce que vous liez ces deux critiques, et en quoi cela affecte le monde de façon concrète ?
C’est une des questions centrales de mon dernier livre, Designs for the Pluriverse (NC, Duke University Press, non traduit). L’entreprise de repenser la différence entre nature et culture court depuis 30 ou 40 ans avec Descola et Ingold par exemple. On peut aussi citer des intellectuels comme Bruno Latour qui ont mené des travaux déterminants pour aider à comprendre ce dualisme entre humain et non humains. C’est aussi une question abordée par Michel Foucault dans Les Mots et les choses, pour lui le problème central de l’ethnologie est cette relation entre nature et culture. Ce que montrent ces différents penseurs, et que j’interroge aussi, c’est que la façon la plus commune de regarder le monde a consisté à établir une séparation : entre les humains qui ont la faculté d’agir (agency) et les non humains qui se contentent d’exister. Ces derniers sont eux-mêmes divisés entre vivants et non-vivant. Ce qui amène petit à petit à établir toutes les autres distinctions entre « eux » et « nous », entre le corps et l’esprit, entre la raison et les émotions. Selon moi, ce dualisme philosophique est central et un instrument important de compréhension de la relation coloniale qui s’est établie au travers de l’historie avec les personnes et la nature. Prenons l’exemple concret de la plantation dont parle l’anthropologue américaine Anna Tsing dans son livre sur Le Champignon de la fin du monde (La Découverte). C’est le produit d’une logique d’extraction et de domination qui ne peut naître que dans un esprit dualiste : si la nature est séparée des hommes, alors elle peut être manipulée, ordonnée et simplifiée, et on peut construire des plantations. Mais si on adopte une perspective non dualiste, cela devient impossible, la plantation est proprement inimaginable. Il reste alors ce que les paysans ont toujours fait : la polyculture et non la monoculture, une forme « d’agricologie ».
Dans son livre sur le Matsukake Anna Tsing prend cet exemple de la plantation pour illustrer ce qu’est une démarche d’extraction. Dans votre livrevous optez pour l’exemple d’une montagne. Si on considère une montagne juste comme un amas de pierres, il est possible d’y creuser des mines. Si on adopte un autre point de vue cela devient impossible.
Oui, c’est une idée que j’ai empruntée à Marisol de Cadena, une anthropologue péruvienne qui a écrit un grand livre, Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds (2015), dont j’espère qu’il pourra bientôt être traduit en français. C’est un livre qui a été beaucoup débattu dans le milieu académique anglo-saxon, mais Marisol de Cadena est aussi en discussion avec Bruno Latour, Jacques Rancière ou la philosophe belge Isabelle Stengers. Son idée, et c’est un programme de recherche que l’on partage, c’est de développer le champ de ce qu’on appelle « l’ontologie anthropologique ». Pour ça, nous nous appuyons à la fois sur la critique du dualisme dans la théorie occidentale, mais aussi sur les mouvements sociaux d’Amérique latine. Son livre se penche sur un peuple indigène, au Pérou, qui défend ses terres contre la construction d’une mine d’or au motif que la montagne est un « être sensible ». J’utilise ce concept faute de mieux, car il y a quelque chose de bien plus complexe qui se joue là et qui est intraduisible. Mais on peut l’exprimer comme ça : trois possibilités s’ouvrent à vous quand vous vous représentez une montagne. Vous pouvez adopter le point de vue du président péruvien, qui n’y voit qu’un amas de roches, c’est ce que nous enseigne d’ailleurs la géologie, la science occidentale, il n’y a aucune vie et donc on peut l’exploiter et la détruire pour le bien commun. Une autre position, celle des environnementalistes voit dans la montagne un écosystème important, à part entière, avec ses glaciers, ses rivières, ses lacs etc… C’est intéressant, mais il y a une troisième position plus radicale, qui consiste à voir dans la montagne un être sensible, c’est le point de vue de ces paysans, opposants à la Mine d’or, qui ne peuvent envisager de déménager car disent-ils ils sont leur territoire, ils sont la rivière, le lac, le sol… Au final, si vous détruisez la montagne, ils ne peuvent tout simplement plus exister, c’est ce que nous empêche de voir l’ontologie dualiste. Il ne s’agit pas pour nous de dire que c’est une approche moralement supérieure, mais d’apporter une autre perspective.
Ce qui nous amène à cette notion de « l’ontologie politique », qui considère qu’on est en permanence en train de créer le monde, « d’enacter » le monde selon votre expression. Qu’est-ce que vous entendez par cette idée « d’enacter » le monde ?
C’est la question clé pour comprendre l’ontologie politique. La meilleure définition a été donnée par le sociologue des sciences britannique John Law dans un article intitulé « What’s wrong with a one-world world ». Il y démontrait que l’occident avait développé, dans un temps très court, l’idée que sous vivions dans un seul monde, qui a fini par prendre la forme du monde capitaliste d’aujourd’hui. On a donc ce projet civilisationnel, consistant à imposer un monde fait d’un seul monde, celui du capitalisme globalisé, orienté vers l’individu et le marché. À l’opposé, on trouve par exemple la proposition des zapatistes qui proposent un monde fait d’une multitude d’autres mondes. C’est ce que j’ai appelé le « plurivers ». Donc, pour revenir à votre question, le cœur de l’ontologie politique c’est la question : quels types de mondes sont créés, enactés, par quels types de pratiques et avec quelles conséquences, pour les humains comme les non humains ? Enacter un monde de plantation, lié à l’esclavage et au colonialisme, c’est créer un monde bien spécifique, dans lequel le sucre et l’huile de palme sont produits par des ouvriers dans des conditions misérables. Au contraire, enacter des pratiques plus diverses, pleines de variétés de plantes, d’animaux et même d’esprits, de dieux et de déesses, permet de créer un autre type de monde. C’est le but premier de l’ontologie politique : montrer ces processus, puis voir comment ils sont liés entre eux.
On y reviendra mais puisque vous parlez des « plurivers », j’aurais aimé vous interroger sur une notion importante, fondamentale dans la pensée française, qui est l’universalisme. J’ai été surpris de ne trouver chez vous aucun critique véritable de cette notion, qui est pourtant aussi une émanation de ce monde unique que vous dénoncez. Comment vous vous situez dans ce débat ?
C’est vrai qu’on peut légitimement interroger les défenseurs du plurivers pour qu’ils expliquent comment ils pensent pouvoir construire une politique sans l’universalisme. Peut-on imaginer une politique de coalition sans universalisme ? Si on adopte le point de vue latino-américain, la réponse est oui. À la limite, le seul universalisme c’est celui de cette planète que nous partageons. Mais même dans ce cas, il y a tellement de façons de voir et de vivre la planète, tellement d’ontologies, qu’on ne pourrait même pas arriver à un accord sur le sujet. Il ne peut tout simplement pas y avoir un seul universalisme. Boaventura de Sousa Santos a une formule intéressante à ce sujet : le moment présent est défini par le paradoxe qui arrive. Ce que le sociologue portugais entend par cet aphorisme un peu énigmatique, c’est que nous sommes confrontés à des problèmes pour lesquels les solutions modernes sont insuffisantes. Dans ce cas, d’où peuvent-elles venir ? Notre réponse, c’est qu’elles viennent en partie de la Modernité, et en partie des nombreuses autres façons de voir et de se comporter. Car si on construit toute la compréhension du monde sur les principes de l’universalité, on rend invisible tout le reste et c’est une vraie perte de connaissance. Pour emprunter une autre idée à Boaventura de Sousa Santos, il faut promouvoir une « justice cognitive » qui ramène ces savoirs dans le débat sur la meilleure façon d’affronter la crise.
Votre position est donc aussi morale, éthique…
Il est plus question en effet d’éthique que de vérité. Nous ne disons pas que le pluriversel est vrai et que l’universel est faux. Il ne s’agit pas de cela. C’est en effet une position éthique. Il nous paraît important d’être du côté de ces expériences historiques qui sont plus relationnelles, pluralistes, en lien avec la terre, moins traversées par les inégalités. Même si l’universalisme est une belle construction intellectuelle, qu’il fixe un horizon, il est politiquement inopérant.
Quand vous revenez sur l’universalisme, que vous militez pour une approche post coloniale, vous visez évidemment l’Ouest ou ce que vous appelez le « Global North ». Bruno Latour a fait récemment une critique de votre livre dans Le Monde des Livres et vous reproche de faire de « l’occidentalisme », en référence à « l’orientalisme » dénoncé en son temps par Edward Saïd… c’est-à-dire d’essentialiser l’occident. Qu’est-ce que vous lui répondez ?
Que c’est une critique qui a du sens, évidemment. J’ai beaucoup de respect pour le travail de Bruno Latour, mais je crois qu’on parle de quelque chose d’autre. Un de mes collègues vénézuélien, Fernando Coronil, a écrit un livre à ce sujet à la fin des années 90, Beyond Occidentalism, dans lequel il essayait déjà de répondre à cette critique. Car il est presque impossible en effet de porter la critique contre la modernité occidentale sans être accusé d’essentialisme et d’homogénéiser des réalités très diverses. L’occident, c’est un peu comme la civilisation, un concept qui peut être un piège. J’en suis évidemment bien conscient, et y fais très attention, ce qui m’amène à faire au moins deux constats. D’abord, que la modernité est aussi cruelle en son propre sein, l’occident est hétérogène et traversé par des forces de domination. Quand j’en parle en Scandinavie par exemple, mes amis et collègues me font remarquer qu’ils se sentent périphériques à cette modernité des Lumières qu’il vivent différemment des Français ou des Allemand. On ne peut donc pas occidentaliser l’Ouest. Mais dans le même temps, on ne peut complètement passer à côté de la réalité. Nous sommes actuellement en pleine transition dans la recherche en sciences sociales. Le poststructuralisme, celui de Foucault ou de Derrida, a été très utile pour montrer que la réalité sociale est une construction bien plus complexe que ce qu’ont supposé le marxisme d’un côté et le libéralisme de l’autre. Mais il ne nous a pas assez aidés à comprendre les mécanismes de la domination, comment le néolibéralisme globalisé a pu par exemple atteindre une telle stabilité malgré les critiques et continuer à produire un tel niveau d’inégalités. Donc ce que je réponds à Bruno Latour, c’est que sa critique a du sens d’un point de vue européen, mais que pour nous latinos américains, ce n’est pas tellement intéressant. Nous voulons bien sûr pouvoir compter sur des alliés partout, mais ils doivent accepter l’idée que nous tenons à notre altérité. Si on prend encore une fois l’exemple des indigènes, notre but n’est pas de montrer qu’ils n’ont pas changé depuis la conquête espagnole, ni de les enfermer dans leurs traditions. Ils sont dans le monde, mais en même temps ils sont différents et c’est cette différence radicale que nous valorisons.
Peut-être qu’une des différences tient à la question de la domination. L’orientalisme est un instrument de domination. L’occidentalisme, s’il y en a un et qu’il faut s’en méfier comme vous l’avez remarqué, est plutôt en l’occurrence un instrument d’émancipation. La question de la domination est au cœur de votre travail sur les communautés noires en Colombie. Cela met en jeu la question du territoire, des déplacements…
La domination des Noirs ne date pas d’hier, c’est évident, et elle n’est pas propre à l’Amérique latine. Toutefois, les noirs y ont été exploités et maintenus dans un état de grande pauvreté. Non seulement cela, mais en plus ils ont été rendus pratiquement invisibles comme groupe ethnique, totalement effacés par l’idéologie internationale d’une démocratie post-raciale. Une belle construction encore une fois, qui a commencé à se fissurer à la fin des années 80 avec l’idée de multiculturalisme, puis par sa radicalisation à travers les mobilisations en faveur des identités ethniques. On a réalisé à ce moment-là qu’en plus de la domination, de l’exploitation et du racisme, il y avait une occupation ontologique du monde noir. Quand des paysages sont détruits, des territoires où historiquement vivaient les populations noires occupés par des plantations de canne à sucre, c’est une occupation ontologique, pas simplement symbolique ou physique. Il y a plus de 5 millions de déplacés en Colombie aujourd’hui.
C’est pourquoi vous parlez beaucoup de relocalisation, de territoire. Quel rôle joue cette notion de territoire dans la transition que vous désirez ?
C’est le sujet de mon tout nouveau livre, qui va bientôt être traduit en français, Designs for the pluriverse. Je consacre tout un chapitre à cette idée de la transition dans lequel je distingue les différents principes. D’abord la relocalisation, on le constate tous les jours que ce soit la nourriture, l’énergie, la santé, les transports, l’éducation, il y a un vaste mouvement pour relocaliser ce qui a été globalisé ces cinquante dernières années. On le voit à Paris, à Barcelone… mais cela comporte aussi des dangers auxquels il faut être attentif. Que faire quand un groupe de suprématistes blancs voudra se relocaliser à l’exclusion de tous les autres ? Ce n’est donc pas une panacée, la transition est aussi un moment risqué. Le second point très important concerne la nécessité de recréer des communs. Cela suppose d’imaginer le genre de communautés qu’on désire pour être mieux connectés à la terre, aux dynamiques pluriverselles. Le troisième principe touche à l’auto-gouvernement et à l’autonomie locale. On peut ajouter, comme nous y enjoint le peuple Nasa de Colombie, la libération de la Terre-Mère. C’est un principe pour tout le monde, du Nord au Sud car nous partageons cette planète. Enfin, et c’est très important, il faut dire avec le féminisme décolonial latino-américain que tout ce qu’on vient de dire n’aura aucun effet si cela ne s’accompagne pas d’une sortie du patriarcat. Il ne peut y avoir de décolonisation sans « dépatriarcalisation » car c’est l’origine de ce dualisme, des inégalités, des hiérarchies, des mécanismes d’appropriation, de la guerre, de la violence, de la domination dans le monde.
