Étienne Anheim : « L’histoire ne peut pas répondre à toutes les difficultés de la société française vis-à-vis de son passé »
Médiéviste, Étienne Anheim a dirigé, jusqu’à une date récente, la très célèbre revue Annales. Histoire, Sciences Sociales, avant de prendre la responsabilité des éditions de l’EHESS, une école où il enseigne la sociologie historique de la culture en Europe au Moyen-Âge et à la Renaissance. Se pliant en 2015 au dernier exercice scolaire désormais requis par la carrière universitaire, il a présenté un « mémoire de synthèse » dans lequel, selon l’usage, il revient sur son parcours biographique et intellectuel. Ce texte riche, qui propose un portrait de l’historien en travailleur lui-même travaillé par l’histoire, paraît cet automne (Le Travail de l’histoire) et nous offre l’occasion de revenir avec l’auteur sur la place et le rôle des historiens professionnels au moment où ils sont la cible de polémistes qui se mêlent fort différemment de s’occuper du passé. L’occasion aussi d’évoquer les conditions de travail et de publication des chercheurs en sciences sociales comme la question de leur enseignement souvent problématique dans le secondaire. RB et SB
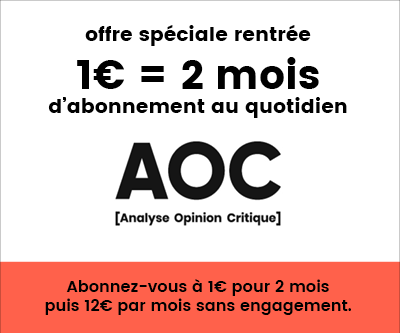
Dans son nouveau livre, le polémiste Eric Zemmour attaque les historiens professionnels. Gérard Noiriel a choisi de lui répondre vertement dans Le Monde. Ce nouvel épisode illustre parfaitement l’un des constats de départ de votre livre, Le Travail de l’histoire : les historiens professionnels n’ont pas le monopole de l’histoire. Quelles conséquences cela emporte-t-il ?
La polysémie du mot histoire produit souvent des dialogues absurdes. Non que le texte de Noiriel soit absurde, j’en partage l’essentiel de l’argumentation. Simplement lorsque Zemmour dit « histoire », il parle d’autre chose que de ce qu’est, en effet, l’histoire pour les historiens professionnels. Éric Zemmour a évidemment le droit d’écrire sur le passé comme les gens qui le veulent. Si l’histoire veut dire le passé d’une société, n’importe qui peut prononcer un jugement sur ce passé. Si l’histoire, en revanche, désigne une discipline qui dispose de règle
