Xavier Moni : « Avant de vendre des livres, un libraire les achète »
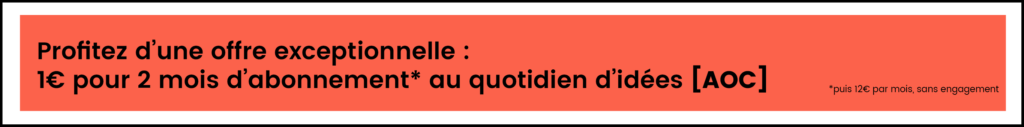
Président du Syndicat de la librairie française depuis 2017, Xavier Moni est le co-gérant de « Comme un roman », grande librairie généraliste située en plein cœur de Paris sous le signe évident du roman éponyme de Daniel Pennac, qu’il a fondée en 2001 avec Karine Henry, et qui emploie aujourd’hui 7 libraires. Les 30 juin et 1er juillet se tiendront les 5e Rencontres nationales de la librairie, rendez-vous biennal initié par le SLF en 2011 et d’une importance majeure pour la profession, mais aussi pour le secteur du livre dans sa globalité. Après Lyon, Bordeaux, Lille, La Rochelle, c’est au tour de Marseille d’accueillir près de 1 000 libraires, éditeurs, diffuseurs, distributeurs et acteurs publics pour se pencher sur l’avenir de la librairie. L’occasion pour le président de ce syndicat professionnel d’éclairer un secteur économique souvent méconnu, y compris de ceux qui y participent pleinement, comme lecteurs et parfois auteurs.
On pourrait commencer de façon assez large à propos de l’état de la librairie aujourd’hui, pour en détailler les grands enjeux et ensuite s’attarder sur les enjeux spécifiques de la librairie indépendante — car quand on parle de librairie on oublie parfois qu’il n’y a pas que la librairie indépendante.
Il n’y a pas que la librairie indépendante en effet. Le Syndicat de la librairie française a vocation à regrouper les librairies, y compris des librairies qui capitalistiquement parlant ne sont pas indépendantes, comme les librairies d’éditeur qui sont aussi de très bonnes librairies. Je considère que, certes, les librairies Gallimard, par exemple, n’ont pas tout à fait les mêmes contraintes économiques que moi, mais globalement je pense que dans la tête d’un client, la notion d’indépendance dépasse la notion capitalistique et que derrière l’indépendance, il y a une manière de faire, une manière de travailler, et une manière d’être au monde et de se présenter dans le monde.
La distinction serait donc plutôt entre ces librairies-là, qu’elles soient indépendantes ou pas, et les hypermarchés et les chaînes ?
Exactement, parce que derrière le modèle économique de la librairie dite indépendante, c’est-à-dire la librairie qui construit un assortiment dédié à du livre majoritairement, qui le propose dans un magasin, lui-même situé souvent en centre-ville, c’est un modèle économique totalement différent de celui de la grande surface culturelle, de la grande surface alimentaire ou de la vente en ligne, et ça se voit à un indicateur très précis : le poids de la masse salariale dans nos comptes de résultat. Une librairie aujourd’hui c’est grosso modo – il y a des disparités selon les situations géographiques – 20% du chiffre d’affaires consacré à la masse salariale. Donc c’est le premier poste de coûts, de charges ou d’investissements, selon la manière dont on le considère. Cela représente une vraie différence avec la grande distribution qui se situe plutôt autour de 10 à 12 %, voire en dessous de 10 % pour la vente en ligne des pure players, qui ont évidemment des productivités qui ne sont pas du tout les mêmes. La différence – c’est là que je mets le curseur – est qu’une librairie indépendante doit avoir un chiffre d’affaires d’à peu près 170 000 € par salarié. Évidemment, plus la librairie est grosse, plus les charges fixes se diluent dans le chiffre d’affaire global, et on peut faire descendre à 160 000 ou 150 000 € pour certaines librairies. Cela dépend aussi d’autres particularités, comme lorsqu’une librairie est propriétaire de ses murs par exemple.
Cela doit dépendre des villes également et sans doute qu’à Paris la situation est particulière.
Oui mais la caractéristique, et ce sur quoi la librairie doit se battre, c’est de ne pas se déshabiller en termes de compétences. Aujourd’hui ce qui fait notre différence fondamentale, c’est notre métier et notre métier c’est acheter des livres et les revendre. Ça s’accompagne bien sûr d’autres tâches, mais globalement, c’est ça notre métier. Et pour ça il faut des équipes. Aujourd’hui, ici, il y a deux représentants dans la librairie ; ils vont faire le tour des rayons, ils vont rencontrer les libraires ; pendant ce temps les libraires ne vendent pas de livres. Mais comme je le dis souvent, un achat, c’est le premier acte de vente parce que quand on achète, on se projette dans la vente. Qui plus est dans un environnement qui est l’univers du livre, lequel a une particularité qu’on a longtemps appelée « diversité culturelle » et que j’appelle moi, maintenant, surproduction. On a 65 000 nouveautés par an. Évidemment tout n’est pas littérature, tout n’est pas sciences humaines, tout n’est pas jeunesse… Mais on travaille des milliers de titres tous les mois.
Quel est le nombre de nouveaux livres commercialisés dans une librairie comme la vôtre chaque année ?
Ici on vend 130 000 livres par an et en nombre de références vendues, c’est-à-dire de titres différents, on est autour de 70 000-75 000 par an. Avec beaucoup de livres vendus à l’unité, et quelques-uns au-dessus de 300, 400 ou 500 exemplaires, qui sont des phénomènes d’édition. Cette année, les livres qu’on a vendus au-delà de 500 exemplaires c’est Michel Houellebecq, dont a vendu 800 exemplaires, et L’Arabe du futur de Riad Sattouf. De fait, il y a un certain nombre de livres qu’on vend au-delà de 100 exemplaires mais l’immense majorité, c’est du 2, 5, 10, 15, 20 exemplaires. Sans oublier les coups de cœur que font émerger les libraires, et leur capacité de vendre, de conseiller, qui font parfois des succès au sein de la librairie. La difficulté de notre métier d’acheteur, c’est le matériel avec lequel on travaille, c’est-à-dire les bons de commande des diffuseurs qui nous sont envoyés, sous forme papier, avec le titre, l’auteur, le code-barre, etc. Et des programmes comme ça, on en reçoit 60 par mois. C’est plus aride que des piles de livres… Et en outre il y a un côté complètement artisanal, parce qu’à partir de ces programmes, je suis incapable de dire combien d’argent je vais engager. Parfois n’y figure même pas le prix des livres, et si oui il s’agit des prix publics et non pas des prix remisés pour l’achat par les libraires. Aussi, c’est souvent ce que je dis aux libraires que je forme aux achats quand ils arrivent à la librairie : en fait, vous avez la carte bleue de la librairie, avec le code, donc si vous vous lâchez, vous avez vite fait d’acheter pour 1 000, 2 000 et même 5 000 € de livres.
Chaque responsable de rayon est autonome dans ses achats ?
Ici, oui. Il y a deux grandes écoles dans la librairie : soit on centralise soit on autonomise. Quand on centralise, on peut le faire à plusieurs niveaux : le gérant, ou le responsable des achats – tout dépend de la taille de la librairie et dans une petite structure la question est vite réglée, quand on est tout seul ou deux –, peut centraliser, par exemple, uniquement les nouveautés. En ce cas le gérant achète toute les nouveautés, ce qui nécessite d’obtenir les bons au préalable, éventuellement de les faire circuler dans la librairie, puis c’est un acheteur qui négocie en tête à tête, et pas dans la surface de vente, avec le commercial de l’éditeur – je tiens à la notion de commerce. Ou alors on délègue les achats. Ici, le responsable jeunesse achète la jeunesse mais il y a quand même un cadre préalable qui définit des manières de faire et d’acheter. Par exemple, je suis très réservé sur la notion de « un », c’est-à-dire quant au livre pris à l’unité : c’est celui qui génère le plus d’invendus dans une librairie.
Cependant existent bien sûr des cas de figures particuliers, celui par exemple des nombreuses librairies qui travaillent avec des collectivités, comme les bibliothèques. Celles-là procèdent beaucoup à l’unité, parce que les collectivités viennent voir la totalité de la production, voire prennent les livres qu’on dit à l’office, c’est-à-dire les nouveautés.
Mais il y a un exercice passionnant à faire, et avec le diffuseur ou le commercial, pour observer le devenir des livres : on prend par exemple les nouveautés d’août-septembre, on les reprend au mois de janvier de l’année d’après, et on voit ce qu’il est advenu des livres. Eh bien il y aura des tas de livres pris unitairement qu’on aura retournés, et quelques livres seulement qu’on aura vendus par 5, 10, 15, 20…, mais c’est très rare. Globalement, c’est générateur de retours. C’est pourquoi je demande aux libraires de faire attention aux commandes unitaires. Je préfère un libraire qui s’engage sur quelques titres. La surface d’exposition sur les tables est réduite, les livres « saupoudrés » finissent en étagère, interclassés avec le fond, et là autant dire que sauf demande particulière, ou article dans la presse, ou parce que quelqu’un en a parlé, il y a peu de chances de vente.
Justement, parlons de cet interlocuteur qui est le vôtre, le commercial. On a le sentiment que le monde de l’édition s’est transformé très vite ces 10-15 dernières années, avec une forte spécialisation, avec l’importance prise par le marketing, etc. Est-ce que de ce point de vue le discours de vos interlocuteurs a changé ?
Ça fait vingt ans que j’exerce ce métier, et en vingt ans j’ai en effet vu le profil de mes interlocuteurs changer, j’ai vu passer une génération. D’emblée, j’ai pu assister au phénomène de concentration dans l’édition et la diffusion. Aujourd’hui, grosso modo, j’ai quatre gros fournisseurs avec lesquels je fais à peu près 90 % de mon chiffre d’affaires : Hachette, Editis, Madrigall et Media Diffusion. Je vends 9 livres sur 10 avec eux.
Par ailleurs, historiquement, on avait en face de nous, surtout sur des catalogues « très qualitatifs », des vrais lecteurs, des gens qui venaient du livre, qui avaient une culture du livre. Aujourd’hui ce sont des commerciaux, sauf exception, que nous avons en face de nous. Des gens qui sont formés pour vendre des choses à leurs clients, des livres ou autre chose. Souvent les diffuseurs mettent les libraires fassent à leurs responsabilités en termes de formation, en disant que libraire est un métier très hétérogène, et effectivement c’est un corps de métier très hétérogène. Mais je dirais que malheureusement il n’y a aujourd’hui presque plus d’hétérogénéité du côté de la diffusion et des représentants : on se retrouve avec une population homogène qui n’a pas de formation intellectuelle. Ce qui pose question quant à la façon de vendre, aux arguments de vente. Si on me propose un livre en me disant qu’il y a un plan média important, pour moi c’est un argument très léger… surtout en sciences humaines.
Qu’est-ce qui fait acheter alors ?
Ce qui me plaît c’est quand je vois un représentant qui hiérarchise son programme. Quand on me dit qu’on présente 100 nouveautés et qu’on croit à 100 nouveautés, je n’y crois pas, ce n’est pas possible. Ce que je demande au représentant, ce n’est pas de pointer avec moi le bon de commande de la première à la dernière page, c’est qu’on voie mes objectifs ensemble, et spécifiquement pour « Comme un roman ». Des objectifs qui seront différents de ceux d’une autre librairie. Qu’est-ce qui selon lui va pouvoir fonctionner dans ma librairie ? J’estime qu’il doit avoir une connaissance du profil de mon magasin, de son histoire, du profil de mes clients et il doit m’attirer vers les livres qui y correspondent, et également me surprendre sur quelques titres. Prenons l’exemple de Perdre la Terre de Nathaniel Rich : pourquoi j’ai lu ce livre-là avant sa sortie ? Parce que l’éditeur et le représentant m’ont alerté sur sa sortie en me disant qu’il était important pour ma librairie.
J’imagine que c’est rare de voir l’éditeur intervenir. Est-ce que cela aussi a un peu changé ?
Oui. Parce que la montée en puissance de la diffusion a un peu coupé le lien de connivence qui peut se créer entre libraires et éditeurs. Peut-être qu’a eu lieu une rupture, ou bien un renouveau générationnel. Mais il y a des éditeurs qui l’ont très bien compris et qui se sont très vite installés dans le milieu de la librairie, je pense à Gallmeister, au Tripode, à Zones sensibles. Parce qu’ils se sont dit : notre clientèle n’est pas la librairie française dans son exhaustivité, notre but est de travailler, dans une démarche qualitative, avec 200, 300 ou 500 librairies qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement les plus grandes. Ce sont des librairies qui ont une intention portée vers cette typologie de catalogues. Quand ça fonctionne, c’est magique. La seule réserve c’est qu’on ne peut pas faire cela avec tout le monde quand on voit déjà 60 représentants par mois. Surtout qu’a émergé un phénomène de sur-diffusion – un nouveau métier qui vient mettre une deuxième couche de diffusion entre le diffuseur, l’éditeur et le libraire. Il y a des structures dédiées à ce type de métier qui vise à la promotion et à l’organisation d’animations, mais ne s’occupe pas des commandes ou des négociations proprement commerciales. Concrètement, il s’agit de repérer des librairies avec lesquelles construire plus de relations. Ce qui veut dire, comme je l’évoquais tout à l’heure, qu’avec le représentant on est, la plupart du temps, seulement dans une relation commerciale.
On touche ici à un point de l’évolution du métier de libraire, celui de l’animation en librairie. Les pouvoirs publics attendent d’ailleurs que les librairies soient aussi des animateurs culturels de quartier. Est-ce qu’il y a une évolution ? Est-ce que ça s’accentue ? Ou est-ce que ça ne fait plus débat ?
Ça fait toujours débat, et c’est un vrai sujet. On a beaucoup mis en scène l’auteur ces dernières années dans nos librairies. Et des rencontres, il y en a beaucoup, partout, chaque jour. On s’est aperçus aussi qu’on fait rarement de simples séances de signature, mais également des interviews, parfois ça s’inscrit même dans un cycle, parfois on travaille en partenariat avec les théâtres, les cinémas, on peut même faire un club de lecture avec les enfants, ou avec le lycée ou le collège du coin. Certaines librairies jouent ainsi un rôle de centre culturel au sein d’un territoire. Mais finalement, ça pèse lourd sur les comptes d’une librairie : c’est du temps, des heures supplémentaires, un coup à boire… On peut difficilement quantifier le retour sur investissement. Mais j’ai quand même l’impression que c’est important, même s’il faut se garder que ça devienne systématique.
De plus, on n’en fait rarement un vrai levier de fidélisation, on donne ça à tout le monde. Je pense que c’est un tort. Depuis la loi Lang de 1981 sur le prix unique des livres, tous les revendeurs doivent vendre les livres au même prix, celui qui est fixé par l’éditeur, avec une possibilité de faire 5 % de rabais. Dans l’immense majorité des librairies, cela fait l’objet d’une carte de fidélité qui coûte très cher aux libraires : c’est environ 2% de la valeur de ce qui est vendu en librairie qui est redistribué aux clients. Par expérience, je me rends compte que si certains clients sont attachés à une librairie, bien souvent on n’interroge même plus ce que c’est que d’être fidèle. Qu’est-ce qu’être fidèle ? Une enquête faite par l’Obsoco il y a quelques années nous disait qu’on était formidables, nous les libraires : on ne gagne pas beaucoup d’argent, on le redistribue aux clients, et ces clients sont absolument infidèles ! Et effectivement, à part une frange très précise de notre clientèle qui en représente 15 % environ, le reste n’est pas du tout fidèle. Ils achètent un livre à « Comme un roman », puis ils vont dans une autre librairie, puis à la Fnac… et puis ils commandent sur Amazon.
Est-ce qu’Amazon a eu un rôle sur ces comportements d’infidélité ?
Ah oui ! C’est d’autant plus marqué qu’à Paris, où il y a une offre très importante dans tous les quartiers, les clients sont les plus gros acheteurs de livres sur internet. D’où notre association Paris librairies, créée il y a cinq ans, et le portail web du même nom, qui permet de géolocaliser le livre qu’on recherche et de le réserver.
Que la clientèle soit volatile c’est une réalité, mais est-ce que les cartes de fidélité, ou les animations, ou bien la diversification de l’offre avec d’autres produits que des livres – on a beaucoup parlé il y a quelque temps d’ouvrir des coins café ou de restauration dans les librairies – attirent la clientèle voire la renouvellent ? Rappelons que pèse aussi sur la librairie un enjeu spécifique, partagé certes avec les bibliothèques, de développement de la lecture.
Le sujet qui traverse la profession aujourd’hui, c’est de savoir si une carte de fidélité, détenue dans une librairie ou bien un réseau de libraires, doit donner accès à un certain nombre d’avantages autres que les 5%. L’idée autour de laquelle on réfléchit, c’est ainsi de savoir si on ne peut pas créer une carte de fidélité payante donnant accès à un certain nombre de services. Car l’expérience montre que les personnes ayant une carte de fidélité payante sont bien plus consommatrices que les personnes ayant une carte de fidélité gratuite.
En fait je crois que maintenir notre activité, dans un archet qui est légèrement à la baisse depuis quelques années, nous demande de plus en plus de travail : il faut qu’on soit meilleurs en tout, dans les achats, dans l’animation, sur les réseaux sociaux, les vitrines. Il faut déployer un certain nombre d’outils pour provoquer une appétence à l’égard des livres. Et en même temps, on se fait souvent la réflexion ici, on perçoit qu’il y a un rajeunissement de la clientèle. C’est purement intuitif. Mais je suis heureux de voir que pour les générations de 25-30 ans, le livre conserve une symbolique et un usage social. Et que pour eux c’est important d’avoir un lieu où aller acheter un livre, y compris si on en a lu un résumé sur internet, si on l’a acheté en numérique et qu’on a ensuite envie, besoin, de l’objet, par exemple pour l’offrir. De ce point de vue, il y a un élément factuel qui en dit long : c’est le nombre de paquets cadeaux que l’on fait en librairie.
De plus en plus de livres vendus sont destinés à être offerts mais pas à être lus : ce n’est pas contradictoire avec la baisse de la lecture, ni avec le fait que l’objet livre garde une valeur symbolique peut-être même accrue dans un univers dématérialisé. Ce qui, j’imagine, change la pratique du libraire comme de l’éditeur, car les livres que l’on offre ne sont pas les mêmes que ceux qu’on lit.
Effectivement, et d’un point de vue pratique ça change une chose très factuelle, et rien moins que littéraire, qui est le choix et la qualité du papier cadeau. Je sais qu’il y a des gens qui viennent à la librairie parce que les papiers cadeau sont jolis, choisis avec attention, renouvelés régulièrement, etc. Le pendant négatif est qu’on est en train d’avoir des exigences à notre égard qu’on n’a pas pour nos concurrents comme la Fnac. Les gens viennent ici aussi parce qu’il y a du service. Parce qu’il y a du conseil aussi bien sûr, parce qu’il y a les rencontres, parce qu’il y a un assortiment, mais ils viennent aussi pour les papiers cadeau.
En fait, le rapport au livre, la baisse de la lecture, etc., est un sujet qui dépasse la librairie, ou l’édition, qui nous concerne tous. À la radio, j’entendais Abd al Malik parler de sa vie et notamment de ce qui lui a permis de grandir et il disait : « Ce qui m’a sauvé dans la vie, c’est la lecture. Le livre, la lecture, c’est ça qui m’a fait grandir, c’est ça qui m’a fait devenir qui je suis. » Beaucoup de personnalités pourraient être, sur ce modèle, des ambassadeurs de la lecture et s’adresser à des clients potentiels des librairies, des gens qui ne fréquentent pas la lecture ou les librairies parce qu’ils se disent que ce n’est pas pour eux. J’ai tenté d’impliquer le Syndicat national de l’édition et ils ont l’air d’être partants pour lancer une campagne de communication, des vidéos, etc., qu’on ferait circuler sur les réseaux sociaux pour parler de la lecture, de la librairie, des métiers que ça représente aussi, sans oublier les auteurs, pour engager les gens à lire. Il y a un encore et toujours un gros travail à faire. Et d’ailleurs on peut le voir d’une manière plutôt optimiste finalement, d’avoir potentiellement plein de gens à conquérir.
Alors justement, la lecture baisse mais le chiffre d’affaires du secteur a connu un mieux à partir de 2015-2016, par rapport à la période autour de 2010 où l’activité se portait mal. Est-ce Amazon, ou les grandes surfaces, ou la librairie indépendante, qui en ont profité et qu’en est-il aujourd’hui ?
La question des chiffres dans notre activité est difficile. Contrairement à d’autres métiers, comme le cinéma par exemple, il y a une grande opacité. Aujourd’hui, je suis incapable de vous dire combien il s’est vendu en France, à l’exemplaire près, du dernier livre de n’importe qui. Il n’y a pas d’outil qui agrège toutes les remontées et les ventes de stocks. C’est un sujet. Mais, globalement, le gâteau à se partager est plutôt stable. Les libraires ont vu arriver un concurrent hyper important et hyper proactif dans ce qu’il savait faire, c’est-à-dire l’expédition, la logistique : Amazon. Il ne faut pas oublier aussi qu’on a vu des concurrents disparaître ou presque : France Loisirs, et de manière générale les clubs de livres qui représentaient une grosse part du marché il y a quelques années. Donc le marché a changé. La librairie là-dedans, comme n’importe quel secteur quand un gros concurrent arrive, a dû se dire : il faut qu’on soit meilleurs dans nos pratiques. La librairie a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Non qu’elle était alors moins bonne ; elle n’était tout simplement pas dans le même environnement et il a fallu qu’on s’adapte à notre environnement, qu’on développe des services, qu’on soit plus réactifs. Et il me semble qu’on a maintenu notre part de marché, mais au prix d’un énorme travail et avec un problème structurel de marge commerciale dont on n’arrive pas à se dépêtrer. Ce que nous laisse la vente de livres pour faire tourner le commerce de nos entreprises est aujourd’hui trop faible, notamment pour maintenir des compétences.
La part du gâteau pour un libraire, selon sa taille, se situe entre 30 % et 40 % sur le prix public du livre, moins la TVA. Les critères pour établir ce taux de remise sont à la fois liés à la quantité de chiffre d’affaires effectué – ce sont les critères dits quantitatifs ; jouent également les critères qualitatifs que sont, entre autres, les animations, recevoir des représentants, faire des vitrines… Avec ces deux types de critères, on aboutit à une remise dite « fichier » à partir de laquelle le libraire doit faire vivre son établissement. Il n’y a pas d’autres marges de manœuvre.
Cette remise de base peut être revue tous les ans et à cela peuvent s’ajouter d’autres points de remise en fonction d’événements spécifiques. Par exemple, j’ai 37 % chez Harmonia Mundi, je fais une vitrine sur tel titre, je peux négocier ce qu’on appelle une surremise, et je vais pouvoir avoir 38, 39 ou 40 %.
Bref, pour reboucler avec votre première question, mon sentiment est que la librairie est très dynamique, qu’il y a aussi un renouvellement générationnel, mais qu’il y a une forme de précarisation. Durant ces dix dernières années le nombre de librairies a été à peu près stable. Mais c’est le nombre de libraires qui a diminué. On a supprimé à peu près 1 000 postes. Ça veut dire que la marge d’ajustement pour un libraire aujourd’hui, c’est de rogner ne serait-ce que sur un demi-poste, sans pour autant pouvoir s’enrichir – on est toujours dans les 20 % de masse salariale –, car on a des coûts généraux qui continuent d’augmenter, comme dans les autres secteurs du commerce : les postes budgétaires des salaires et cotisations, le loyer, le transport des livres, sont les plus importants. L’augmentation des frais est aussi liée au numérique, qui nous apporte de grands services mais qui peut peut-être expliquer une partie des 1 000 emplois supprimés. On a connu des gains de productivité avec les logiciels de gestion des stocks, les messages EDI [ndlr – échanges de données informatisées] qui fluidifient l’activité, la réception des livres va beaucoup plus vite qu’avant, etc. Mais tous ces abonnements ont un coût.
La spécificité de ce commerce par rapport à d’autres, c’est qu’il est strictement encadré par le prix unique. Que peut-on dire aujourd’hui de cette réglementation ? En quoi fait-elle tenir l’ensemble et dans quelle mesure elle aurait besoin, ou pas, d’être complétée par d’autres dispositifs de politiques publiques pour garantir la pérennité voire le développement de la librairie ?
La librairie française, et je le vois quand je rencontre des confrères à l’étranger, est souvent citée comme un modèle de pérennité et de développement. Mais ce que je vois aussi dans les yeux de ces confrères, c’est que pour eux on bénéficie d’un environnement législatif hyper favorable, notamment avec la loi sur le prix du livre. Et n’oublions pas non plus la TVA à taux réduit de 5,5 %, plus un certain nombre de dispositifs qui permettent l’ancrage de la librairie dans les territoires. Cependant, on est aussi aujourd’hui à l’heure du numérique avec un gros concurrent dont on a parlé tout à l’heure, Amazon, qui a compris que d’un point de vue législatif, aujourd’hui, et malgré un discours ultralibéral, le livre est une sorte de cause sacrée, de sanctuaire. Ils ont compris que ça ne bougerait pas beaucoup. Ce qui ne les pas empêchés, et j’en suis très inquiet, d’avoir réussi à brouiller l’image du prix unique du livre avec leur mode d’affichage des prix sur les plateformes. Même un livre sorti très récemment, on peut le trouver neuf d’un côté et, de l’autre, d’occasion comme neuf. « D’occasion comme neuf », ça n’existe pas dans la vie, c’est soit d’occasion, soit neuf. Les prix sont de l’ordre de -20, -30, -40 % en référence au prix unique et donc, aujourd’hui, dans un monde où nous avons tous pris l’habitude de comparer les prix, ici parfois des gens me disent « à combien vous me le faites celui-là ? », « — au prix indiqué », « — pourtant je l’ai vu sur Amazon, il était moins cher », « — oui il était moins cher mais il était d’occasion », etc.
Le livre d’occasion est-il devenu un vrai enjeu aujourd’hui ?
Il y a un vrai enjeu autour de l’affichage du prix. On a essayé d’arriver à un accord avec le Syndicat national de l’édition, le Syndicat des loisirs culturels (qui représente les grandes surfaces spécialisées en produits culturels, comme Cultura), les libraires et les auteurs. Tout le monde était d’accord sur le fait qu’il fallait clarifier l’affichage sur les plateformes internet. Le seul qui n’a pas signé, c’était Amazon. Ils ne signeront pas ce texte-là parce qu’ils sont d’accord sur tout sauf sur le fait qu’il faille clarifier. Le mal est fait. C’est entré dans les mœurs. Nous on doit alors inventer comment communiquer sur ce point. On réfléchit actuellement, avec un certain nombre d’éditeurs, mais c’est compliqué de communiquer sur le prix unique, qui n’est pas unique puisqu’il y a 5 % de rabais, qu’il n’est unique à l’étranger, etc.
Est-ce qu’il y a des revendications pour d’autres formes de protection ?
S’expriment des revendications très fortes concernant les relations avec les diffuseurs, notamment sur la question d’une remise minimum. Il y a un prix unique, nous on voudrait qu’il y ait une remise minimum. Parfois, des confrères m’appellent et m’apprennent qu’ils ont 32 % de remise chez Hachette, et qu’ils ne se paient pas. Ce n’est pas acceptable. Ce sont des libraires qui essaient de faire un travail qualitatif mais on ne leur en donne pas les moyens. En fait, la loi de 81 concentre tous les pouvoirs dans les mains de l’éditeur. C’est une loi d’éditeur qui protège la librairie. L’éditeur fixe et le prix et la rémunération des différents acteurs.
On demande ainsi une remise minimale de 36%. Ce chiffre ne vient pas de nulle part. Quand on déconstruit le modèle économique d’une librairie, on s’aperçoit qu’à 36 % de remise, et si le reste est bien maîtrisé, un libraire peut sortir des salaires, vivre et payer ses factures. En-deçà, c’est forcément des sacrifices et souvent le salaire du gérant est la variable d’ajustement. Donc ça c’est une revendication. Sauf que, pour avoir présidé la commission commerciale du Syndicat de la librairie française, je sais qu’on n’y arrivera pas de gré à gré, et que ça ne pourra venir que d’une évolution de la loi de 81, mais c’est compliqué et cela voudrait dire privilégier un secteur commercial.
Vous avez récemment pris à partie le groupe Hachette dans une tribune publiée par Le Monde à propos du taux de remise trop faible qu’il consent aux libraires. La réaction du président d’Hachette Livre, Arnaud Nourry, fut immédiate : il a annulé la présence aux Rencontres nationales de la librairie des personnels de son groupe. Qu’en pensez-vous ?
Je regrette cette décision. Ces rencontres, tout comme cette tribune, ont pour vocation de susciter des échanges et des discussions. Le constat fait que les marges commerciales consenties par le premier groupe éditorial auprès des plus petites librairies sont les plus faibles n’est pas nouveau. Et il est de notre responsabilité d’alerter une nouvelle fois nos partenaires sur le risque à fragiliser un nombre croissant de librairies. La main est tendue, et j’espère qu’avec le groupe Hachette, comme avec les autres, nous pourrons faire avancer ces dossiers capitaux.
Que dit le ministère de la Culture concernant vos revendications et l’éventuelle modification de la loi Lang ?
Le ministère de la Culture entend que cette loi aurait besoin d’être consolidée, que l’environnement a évolué, sans pour autant la remettre en cause. Parce qu’il est vrai que la loi Lang est régulièrement attaquée en France, et d’ailleurs tout ce qui est marché régulé aujourd’hui n’a pas bonne presse. Par exemple, il y a quelques années, Jean Dionis du Séjour, alors député du Sud-Ouest de la France, sans doute sensibilisé par un certain nombre d’acteurs qui n’étaient pas des libraires, a produit un amendement sur la réduction du délai de solde. La loi Lang a mis en place un double critère pour pouvoir solder : que le livre ait été publié depuis plus de deux ans et que son dernier réapprovisionnement remonte à plus de six mois. En France, très peu de libraires pratiquent les soldes. L’éditeur quant à lui peut aussi décider de manière unilatérale de solder ses livres, lorsque par exemple il a du stock qu’il ne veut pas pilonner, mais dans ce cas il a obligation d’en informer tous les revendeurs, en déterminant la baisse de prix concernée. Ou alors, deuxième option, il passe par le réseau des soldeurs qui revendent au prix qu’ils veulent. Alors, proposer la réduction du délai pendant lequel il est interdit de procéder à des rabais, cela ne semble rien comme ça, sauf que ça remet fondamentalement en question la loi de 81. Derrière ça, il y avait un argument qui était imparable : l’écologie ; il y a trop de gâchis dans notre métier. J’ai d’ailleurs entendu qu’on allait interdire de détruire les invendus. Pour l’instant on ne parle pas du livre mais il va falloir surveiller ça. On nous dit « c’est scandaleux », tous les invendus on les pilonne, et quelle est la solution pour éviter de les pilonner ? Eh bien, c’est de réduire le délai de solde.
Cet argument écologique et le pilon nous ramènent à la question de la surproduction, qui concerne tous les acteurs de la chaîne du livre, y compris les auteurs. Quel est le point de vue de la librairie, qui est en bout de chaîne ?
C’est certain qu’il y a un problème de surproduction. Il suffit de voir le nombre de nouveautés et les effets de suivisme que cela entraîne. Prenez l’écologie justement. Ce n’était qu’un rayon, une branche des sciences politiques et aujourd’hui on pourrait ouvrir une librairie uniquement sur l’écologie. On publie désormais tout et n’importe quoi et cela vient à mon sens d’un manque d’engagement des éditeurs par rapport à leur production. Et du coup on se retrouve avec des non-livres, pas édités, dont on ne sait pas quoi faire.
Et est-ce que ça ne traduit pas, de la part de certains éditeurs, ce qu’on pourrait appeler une « économie de casino », avec l’idée de publier des livres comme on cherche à tirer le gros lot ?
Exactement. Il faut considérer le modèle économique concerné : publier un livre aujourd’hui ne coûte pas rien mais ne coûte pas très cher, d’autant plus que l’on fait payer les achats par le revendeur, quitte à lui rembourser ses retours, ce qui nécessite de faire un nouveau livre, etc. Et cela a des conséquences sur le reste de la chaîne, y compris sur les auteurs, oui, qui produisent les contenus et pourtant ont le sentiment d’être les moins rémunérés de la chaîne. C’est discutable pourtant, parce que si on reprend le schéma de la répartition de la valeur, à l’auteur reviennent 10 % du prix d’un livre, ce qui est certes moins que les 35 % qui reviennent au libraire, mais ce ne sont pas 35 % au total qui vont dans sa poche : avec cela il faut payer toute une chaîne de coûts, et de même chez l’éditeur. Mais ce que l’on ne peut pas nier, c’est que la surproduction, plus l’érosion de la lecture, plus le phénomène de best-sellerisation, font que le tirage moyen et la vente moyenne des livres diminuent : un livre se vend en moyenne en moins d’exemplaires qu’il y a 15 ans. Tant qu’on continuera à publier toujours plus dans un marché qui n’est pas croissant, on observera ce phénomène. Et les auteurs qui vendent 1 000 exemplaires effectivement ne peuvent pas en vivre. Quand bien même leur pourcentage de droits d’auteur serait plus élevé.
Est-ce qu’il y a des pistes de travail pour remédier à cette situation ?
Du côté des auteurs, cela a été très tendu et il y a beaucoup de discussions, notamment à l’initiative des auteurs jeunesse, mais peu de pistes sont avancées : inverser le modèle économique, ou alors éventuellement essayer d’envisager un équivalent de système d’intermittence, un système plus solidaire en reversant une quote-part des ventes dans une caisse commune, etc. Mais je ne vois pas bien. D’autant que l’immense majorité des libraires et des éditeurs ne sont pas riches. Et tandis que les grands groupes font des résultats importants voire très importants.
Concernant la surproduction, le libraire détient une partie des clés puisqu’avant de vendre les livres il les achète. Aux libraires que je forme, je dis souvent que le zéro est une quantité. Je milite pour un certain nombre de pratiques, qui sont un peu anciennes et que les jeunes libraires n’ont pas forcément connues. C’est que le pendant de la surproduction, ça a été la dérégulation des retours. Aujourd’hui, un libraire peut acheter un livre un jour et le retourner le lendemain. Revenons à ce qu’on faisait avant : on était obligés de garder les livres 3 mois. Ça change la donne quand on achète, vu le manque de place en librairie. De même, on n’avait pas le droit de les retourner après un an ; mais à cet égard, je suis favorable à ce qu’on ait fait sauter ce plafond, parce que c’est prendre le risque de garder les livres plus longtemps. Je ne dis pas qu’on doit réinstaller la règle des 3 mois, mais ça peut être un critère de se demander : est-ce que je vais garder ce livre pendant 3 mois dans la librairie ?
Une dernière question, sur le numérique en librairie, parce qu’on s’est beaucoup énervés sur le sujet depuis 10 ans : est-ce que ça reste un sujet ?
Aucune des tentatives d’introduire le livre numérique en magasin n’a fonctionné – ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais. Cette résistance du marché français au livre numérique tient à plusieurs facteurs, notamment le prix, mais aussi la relation à l’objet livre. Si on considère que le livre est le cadeau le plus répandu, un livre papier reste plus attirant et chaleureux que le livre numérique. Et, oui, le numérique aujourd’hui n’est plus un sujet.
Le grand sujet aujourd’hui, selon moi, est autre et il dépasse le simple cadre de la librairie. J’essaye d’ailleurs de créer des passerelles avec d’autres associations de commerçants ou de métiers proches, comme nos homologues du cinéma. Mon grand rêve c’est de proposer une alternative de consommation par rapport aux pure players. On a un discours à développer, des services à développer. Le cinéma indépendant a les mêmes problématiques que moi : la surproduction, la durée d’exposition des films, la négociation avec les producteurs, la réactivité, sentir un truc qui va marcher, les influenceurs… Et puis, il y une autre question qui est capable de fédérer tout le monde, c’est la question des centres-villes, la manière dont les centres-villes peuvent revivre et autour de quoi. Je pense qu’il y a quelque chose autour de cette notion d’indépendant, qui est vague, mais qui dit quelque chose aux gens. Si on regarde bien, il y a des métiers entiers où il n’y a plus d’indépendants, et d’autres où ils commencent à réapparaître, comme les disquaires. J’aimerais bien qu’on retisse des liens entre nous, les professionnels de divers secteurs. Y compris avec les cavistes ! Les cavistes sont très proches du livre. On aurait pu inviter par exemple Jonathan Nossiter, l’auteur d’Insurrection culturelle, aux Rencontres nationales de la librairie, non seulement parce que le rapport au vin et la commercialisation du vin partage bien des aspects avec ceux du livre, mais aussi parce que ce qui se passe chez les vignerons indépendants pourrait être transposé dans les milieux culturels.
