Hito Steyerl : « L’information fusionne avec la popularité et la rentabilité »
Plasticienne, vidéaste et théoricienne des médias, l’allemande Hito Steyerl, à qui le Centre Pompidou a consacré cette année une riche rétrospective, est, depuis les années 1990, l’une des rares figures contemporaines capables d’articuler une pratique artistique multimédiale à une réflexion critique de manière originale et cohérente. Professeure à l’Université des Arts de Berlin, où elle a co-fondé le Centre de Recherche en Proxy Politics, son dernier livre en date, De l’art en duty free, a paru en octobre dernier en France aux Presses du réel. Steyerl y déplore, sur un ton tantôt ironique, tantôt acerbe, les dérives néolibérales et fascisantes du marché global de l’art contemporain. Dans le sillage de Harun Farocki, elle pointe également du doigt les contradictions et paradoxes de la production et de la circulation massive d’images, du capitalisme computationnel, de la surveillance généralisée, de la militarisation et des technologies numériques, et prône une politique de la représentation, un art public capable d’inépuisables expérimentations. Surtout, elle reste une artiste pleinement engagée avec la condition contemporaine et les enjeux sociopolitiques les plus pressants de l’actualité en adoptant un prisme post-colonialiste, féministe et matérialiste. Son dernier travail, SocialSim (2020), traitant les violences policières lors des mouvements des Gilets Jaunes et de Black Lives Matter, le corrobore. GHL
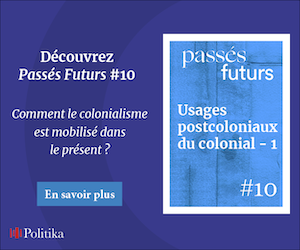
Nous utilisons Zoom pour cette interview, un logiciel qui a été beaucoup critiqué pendant le confinement pour ses politiques de données. Il semble néanmoins que cette application se soit désormais normalisée, et que les critiques à l’endroit de certaines technologies ne parviennent pas à avoir vraiment d’effet. Comment ne pas penser que nous sommes piégés par ces nouveaux dispositifs qui extraient nos données et comportent de nombreux effets pervers ? Comment ne pas se sentir pris dans une forme de servitude volontaire ?
La pandémie a exacerbé ces prob
