Tiphaine Raffier : « Je fais un théâtre d’événement »
Tiphaine Raffier est une des metteuses en scène les plus passionnantes de sa génération, également autrice et comédienne. Alliant une recherche radicale au plaisir simple de raconter des histoires, ses œuvres s’offrent comme des mondes en soi pour explorer des questions profondes tout en assumant une dimension spectaculaire. Elle cherche ainsi à concilier la plus grande exigence avec le divertissement, en mettant en tension tous les moyens qu’offre la scène : travail sur la langue, jeu de l’acteur, dispositifs sonore et vidéo léchés, scénographie sismographique… Considérant le théâtre comme un lieu qui peut à la fois séparer et réconcilier les êtres, cette « femme coupée en deux », nom qu’elle a choisi pour sa compagnie, aime à explorer les vertiges éthiques. Avec Némésis, sa dernière création présentée en ce moment à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, elle adapte un roman de Philip Roth qui nous plonge dans la communauté juive de Newark, en 1944, à travers l’existence de Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique. Alors que tous ses amis débarquent sur les plages normandes en héros, lui s’occupe d’un terrain de jeu du New Jersey jusqu’à ce que survienne un événement terrible : une épidémie de poliomyélite, événement inventé par Roth. La maladie frappe arbitrairement les enfants et Bucky s’indigne et s’interroge, devenant un « malade du pourquoi ». Car comment comprendre que la déesse de la vengeance s’abatte ainsi sur des innocents ? Y.S.
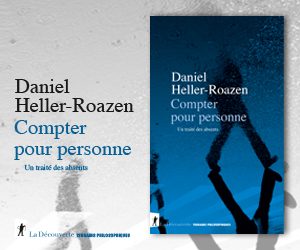
Votre travail met souvent en scène des dilemmes moraux, je pense notamment à La Réponse des hommes, qui m’évoque une sorte de « théâtre de situation » renouvelé. Comment continuez-vous à explorer la question du mal avec Némésis, que l’on peut considéré comme une parabole ?
Je dirais que je ne m’intéresse pas tant à la question du mal qu’à la question du bien. Le titre « la réponse des hommes » m’est venu de l’Évangile de Saint Matthieu 25, au moment où Jésus énonce ce qu’on a appelé par la suite les « œuvres de miséricorde », à savoir des préceptes comme donner à boire aux assoiffés, à manger à ceux qui ont faim, ou encore vêtir ceux qui sont nus, les règles pratiques que doivent suivre les chrétiens. Jésus énonce ces règles, et les hommes répondent par des questions car ils ne comprennent pas les images que Jésus leur propose. Les questions éthiques m’intéressent notamment quand on les fait descendre de leur échelle abstraite, conceptuelle, pour les incarner dans la singularité de la vie, dans des moments où nous sommes poussés à faire un choix, et c’est ce choix qui va, finalement, nous définir beaucoup plus que d’autres paramètres. Nous sommes après tout une somme de contradictions, et ce sont les circonstances qui vont orienter nos actions. Ruwen Ogien a écrit un livre qui s’appelle De l’influence des croissants chauds sur la bonté humaine, et tout est dit dans ce titre : n’est-on pas plus enclin à donner ou à être empathique quand il y a une bonne odeur de viennoiseries industrielles dans l’air ?
Je crois que le bien et le mal sont relatifs, et c’est ce regard-là sur l’humanité qui me passionne. Deux grandes approches fondent aujourd’hui la philosophie morale : on parle d’un côté de conséquentialisme, où l’on ne prend en compte que les conséquences d’une action, c’est-à-dire qu’une action est considérée comme juste si elle a des conséquences souhaitables, mais reste alors à voir lesquelles, tandis que le déontologisme affirme que chaque acte doit être jugé selon sa conformité ou non à certains devoirs, comme « ne pas mentir » ou « ne pas tuer ».
Si l’on prend l’exemple de Bucky Cantor, le personnage principal de Némésis, on constate qu’il pense faire absolument le bien en refusant l’amour de sa fiancée, car il ne veut pas que celle-ci soit condamnée à rester toute son existence avec un infirme, puisqu’il a été atteint par la polio. Or, on peut se demander ce que cette décision implique : est-ce réellement faire le bien que refuser son choix à elle ? Va-t-elle vraiment être heureuse grâce à ce « sacrifice » ? Comme les héros tragiques, et dans Némésis on pense bien sûr à Œdipe, qui libère la cité de la Sphinge mais apporte dans son sillage la peste, le personnage de Roth pense faire le bien, mais en réalité il court à sa perte… L’enfer est pavé de bonnes intentions. Il peut y avoir plein de causes au mal, mais je crois que seulement un infime pourcentage résulte du désir de le commettre et d’en jouir sciemment. Cela résulte plutôt d’un manque d’empathie, d’une situation de monopole du pouvoir…Souvent le mal, c’est une forme d’ignorance qui confine à la bêtise.
Certains passages du spectacle résonnent évidemment avec ce que nous avons vécu pendant la pandémie du Covid-19, et toute la première partie montre notamment les différentes réactions possibles face à une situation sanitaire extrême, comme celle du Dr Steinberg à qui Bucky vient rendre visite pour demander la main de sa fille.
Beaucoup de femmes, et notamment les mères de famille, sont taxées d’hystériques dans Némésis parce qu’elles considèrent la situation comme extrêmement sérieuse, ce sont des Cassandre à qui on ne prête pas attention. À l’inverse, l’homme, médecin, bourgeois, est écouté. Il incarne le camp de la raison classiquement associé au masculin. Il veut calmer la situation, chiffres à l’appui, en rappelant que la maladie ne touche qu’une infime partie de la population et qu’il ne faut absolument pas changer notre mode de vie ni céder à la panique, les conventions doivent être maintenues. Alors que les femmes, lorsqu’elles viennent tirer la sonnette d’alarme, le font d’une manière qui explose tellement les bienséances dans une société très réglée qu’elles ne sont pas prises en compte. Cela m’intéressait de mettre en scène cette épidémie dans une société de l’Amérique des années 40, donc une société extrêmement patriarcale.
Dans le spectacle, cette scène est le moment où on allume la caméra et le docteur présente sa maison, que l’on a décidé de représenter en maison de poupée. Cela fait signe vers le côté démiurgique de ce médecin, qui joue presque à la poupée avec le monde vivant, et cela permet de représenter aussi le fait qu’il est à l’écart des réalités sociales, lui qui est dans sa grande demeure à propos de laquelle Bucky s’extasie car elle est entourée par un jardin privatif, chose très rare dans le quartier. La caméra passe de pièce en pièce, s’arrête sur les petits objets, il y a aussi la présence, et tout ce dispositif nous permet d’interroger notre rapport à la matière, ce à quoi nous a poussé la pandémie je trouve.
C’est-à-dire ?
Eh bien on a commencé à regarder les objets qui nous entouraient d’une autre façon, tout devenait possiblement un danger, le virus invisible pouvait se loger partout. Travailler sur cette maison de poupée alliée à la caméra permettait de poser la question du contrôle. Le Dr Steinberg est quelqu’un qui veut circonscrire la peur, car après tout nous sommes en Amérique, et là il n’y a pas de raison d’avoir peur, la peur, elle est ailleurs, en Europe, et nous, les juifs américains, nous ne devons pas avoir peur, voilà sa position. Dans la première partie, on assène qu’il faut maîtriser ses émotions car ce sont nos ennemis, et à un moment, après l’enterrement d’un des petits garçons, une des mères n’en peut plus, elle arrache ses vêtements selon le rite juif et se répand sous le regard gêné de son mari et de Bucky. Chez Roth, je dirais qu’il y a deux types de roman : les romans de la pulsion, ceux qui d’une part mettent en scène des personnages libertaires, obsédés par le sexe, comme dans Portnoy et son complexe ou Le Théâtre de Sabbath, qui accueillent leurs pulsions ; et d’autre part les romans de la convention, les « œuvres du surmoi », avec des personnages qui explosent à un moment car ces vies-là sont intenables, comme dans Némésis.
Cela m’a intéressée aussi de travailler les conventions sociales en miroir avec les conventions théâtrales et leur éclatement. Et quand la convention théâtrale est ébranlée, c’est pour nous retrouver ensuite dans une pratique hautement conventionnelle, à savoir la comédie musicale dans la deuxième partie du spectacle.
Pour la première fois, vous passez par la voix d’un autre, et sachant que la notion d’écart vous est chère, que vous permet cette adaptation sur scène du roman de Philip Roth, Némésis, livre dont le potentiel de théâtralité ne paraît pas évident à la lecture ? En quoi cela vous déplace-t-il d’en votre façon de créer jusque-là ?
Passer par les mots d’un autre, cela m’a aidée au sens où Philip Roth est un auteur qui décrit la vie d’un homme pris précisément dans son époque. Vous dites que je fais un théâtre de situation, je ne l’ai jamais formulé comme cela… Je dirais que je fais un théâtre d’événement, c’est-à-dire qu’il y a des événements qui arrivent et qui vont réorienter ou désorienter notre boussole empathique, mettre à l’épreuve notre morale, notre vision du devoir, et cela induit un autre regard sur une situation et le personnage qui y est confronté. Philip Roth pense l’événement, et notamment l’événement historique, par rapport à la vie d’un homme ou d’une femme en particulier, et c’est cet événement-là qui va corseter un destin, qui va le marquer d’une façon inattendue. La petite histoire rencontre la grande par le travail du détail, et la singularité d’une existence offre une matière magnifique pour la fiction théâtrale.
Le roman est structuré en trois parties que j’avais envie d’absolument sacraliser, ce qui est visible dans la scénographie qui change radicalement pour chacune d’entre elles. C’est le côté formel qui m’a plu. Roth met en place aussi des dispositifs littéraires très forts, notamment la place du narrateur. Dans ses romans, on se demande souvent : qui parle ? Dans Némésis, ce n’est qu’après plus d’une centaine de pages qu’on découvre que c’est en réalité Arnie, un ancien élève de Bucky, qui raconte l’histoire arrivée des décennies auparavant. Je trouvais que ce dévoilement était jouissif à mettre en scène au théâtre. Une autre chose qui m’a paru intéressante, c’est le chassé-croisé entre incarnation et désincarnation qu’offrent en regard la trajectoire de Bucky et celle d’Arnie, cela m’a semblé éminemment théâtral. Bucky devient de plus en plus désincarné, à cause notamment de son envie d’être un héros, à cause de cette ambition il doit suivre une ligne de conduite, répondre à des figures imposées, et cet idéalisme le désincarne. À l’inverse, le narrateur, d’omniscient au début, se dote à un moment d’un nom, d’un âge, d’un récit, et il offre un point de vue en réalité particulier sur les événements. Et il a un corps, que l’on découvre à la fin, et en plus un corps malade car il a gardé des séquelles de la polio quand il était enfant.
Bucky veut être un héros, mais il souffre dès le départ d’une culpabilité, celle de ne pas être sur le front en Europe avec ses camarades car il a été réformé à cause de sa mauvaise vue. Cette culpabilité sera redoublée non seulement quand il n’arrivera pas, sur le terrain de jeu dont il est responsable, à protéger les petits garçons qui l’admirent, mais aussi car il croit avoir apporté la maladie dans le camp de vacances où il se réfugie. Ce personnage vous intéressait-il pour battre en brèche un certain héroïsme viril ?
Bucky est mis sur un piédestal car les grands frères sont partis pour se battre, alors il faut combler cette place vacante. Mais il a été aussi élevé en héros, et il s’inscrit dans la lignée des héros tragiques grecs car il obéit à un déterminisme absolu. Il y a notamment une scène d’anthologie, matricielle, que je n’ai malheureusement pas pu intégrer au spectacle, qui raconte comment il acquiert son surnom de « Bucky » : c’est lorsqu’il a tué un rat à coup de pelle quand il avait neuf ans, dans la cave… Buck, ça désigne vraiment le mec, le mâle…Le livre interroge comment cet homme va vers ses origines, et puis aussi la question de la dignité : qu’est-ce qu’être un homme, notamment à une époque où on les élevait pour être des soldats, des vaillants protecteurs du foyer et de la patrie ?
En miroir, le narrateur, Arnie, a grandi vingt ans plus tard, dans les années 70. Il a reçu une autre éducation, et il a réussi à retourner son infirmité en avantage puisqu’il va en faire son business et devenir riche grâce à ça, avec une entreprise spécialisée dans l’accueil des personnes handicapées. Peut-être même que son infirmité est même devenu un outil de séduction, c’est ce qui est suggéré quand il dit à Bucky : « Vous savez, être un homme avec un certain handicap ça peut plaire à un type de femme, je le sais pas expérience. »
Cela questionne donc bien sûr la masculinité, mais je crois plus généralement que cela traite de l’éducation des enfants, la façon dont on leur parle. Comment leur donner la liberté d’être eux-mêmes ou non ? Que valorise-t-on dans l’éducation des enfants pour en faire des êtres libres et puissants ? Et plus largement : quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses ? J’ai choisi pour jouer Bucky âgé, dans la troisième partie, un de mes anciens professeurs, Stuart Seide, qui m’a donné toute la boîte à outils, tout l’arsenal que doit savoir un acteur pour survivre. Ce qui est cocasse, c’est que dans le spectacle il joue donc un ancien prof qui retrouve un ancien élève… Et je me suis rendue compte que s’il faut tuer les maîtres pour s’émanciper, en même temps on ne peut jamais complètement, ils nous accompagnent jusqu’au bout. Cela implique une responsabilité dans la transmission, ce que je pouvais voir de façon presque transgénérationnelle en travaillant avec les enfants du chœur de Saint-Denis : ils intègrent très rapidement des notions, des placements du corps, la gestion de l’espace…
Cette confrontation de l’ancien maître et de l’élève met aussi en scène deux réactions face à l’infortune et au « scandale du mal », à savoir dans Némésis la mort inopinée d’enfants innocents. Si Arnie fait finalement fructifier son malheur, Bucky se confine dans une forme d’intransigeance, il n’accepte pas de frayer avec un monde qui continue son business as usual tout en sachant cela. On peut le rapprocher du Ivan Karamazov en ce sens, personnage de Dostoïevski qui ne supporte pas de constater l’aisance avec laquelle on consent à continuer à vivre alors que la mort d’un enfant, même un seul, exigerait que nous arrêtions tout. Mais la position que Bucky défend n’est-elle pas mortifère, dans la mesure où sa retraite et son refus du bonheur ne vont pas faire revenir les petits garçons disparus ?
Son attitude qui considère comme indécent d’être heureux dans un tel monde, son refus du compromis lui confère-t-elle une forme de dignité ou non ? Voilà la question. « Némésis » signifie « indignation », et Bucky demeure dans son indignation, comme prisonnier de cette dernière. Roth lie dans ce roman des influences grecques avec des questionnements bibliques. En lien avec le Livre de Job, il vient surtout mettre en doute la question de la rétribution divine appliquée à l’Amérique, à savoir si tu travailles bien, si par exemple la pomme que tu achètes tu la vends bien, eh bien avec l’argent acquis tu pourras acheter deux pommes, puis trois, et ainsi tu vas t’enrichir et ton travail sera toujours récompensé de son usufruit.
Roth, de son côté, court-circuite complètement cette logique dans beaucoup de ses romans, assénant que non, cette idéologie-là est une illusion, que la vie humaine est frappée de hasards et d’injustices, que ceux qui n’ont pas intégré cette propagande n’ont pas les armes pour affronter le monde. Dans le récit biblique, Job est frappé d’une quantité astronomique de malheurs : il perd ses biens, sa maison brûle, ses enfants meurent, il finit par être malade, et ses amis qui viennent lui rendre visite lui demandent : « attends, t’as du faire quelque chose de pas bien quand même, non ? » et lui rétorque mordicus que non, qu’il est un bon croyant un bon pratiquant. Commence alors une espèce de discussion théologique pour savoir pourquoi il aurait mérité un tel traitement. La leçon de tout ça pour moi est que l’on a toujours besoin de raisons… Et même dans nos sociétés contemporaines occidentales, cette idée de la rétribution divine est toujours bien présente, sous d’autres formes : on va dire que c’est le karma, les énergies ou que sais-je, telle ou telle chose qui nous arrive devait arriver, et on culpabilise les êtres de leurs malheurs d’une certaine manière, comme s’ils en étaient responsables car l’absence de causalité nous est insupportable. C’est cette culpabilité-là qui me semble douloureuse, et elle nous parle je crois que notre condition humaine en général, et plus particulièrement à notre époque où elle est partout, si l’on pense au réchauffement climatique. Je ne dis pas que ce sentiment de culpabilité n’est pas nécessaire, mais il faut en faire quelque chose et ne pas y être condamné.
Une différence par rapport à aujourd’hui néanmoins, à propos de ce sentiment de culpabilité, me paraît être la place des États-Unis. Dans la fable, nous sommes en 1944 et l’Amérique prend le pouvoir sur le monde et baigne dans l’insouciance. La scénographie de la deuxième partie exemplifie cela, avec ses immenses toiles peintes représentant des montagnes bucoliques où se situe le camp d’Indian Hill, nom qui désormais sonne déjà de façon problématique à nos oreilles. En quoi Némésis ironise-t-il sur la Destinée manifeste et la mythologie américaine ?
En quittant Newark, on plonge dans une sorte de paradis factice avec cette colonie de vacances de scouts. Cette rupture est soutenue par la musique : pendant la première partie, on avait en tête les B.O. de films de guerre, les sons sont pris comme une matière vivante, avec de possibles déflagrations, on peut être attaqué de toute part. Dans la deuxième partie, on retrouve la mélodie, une forme d’harmonie. C’est en effet un monde qui ne se pose pas de questions, on ne voit pas de problème à représenter des Indiens grimés, à faire des « red face » car alors les massacres des peuples autochtones sont complètement oblitérés, la population est pétrie par l’imaginaire des westerns, et l’ « Indien » est soit le barbare sanguinaire, soit le grand prophète de la Nature, comme ici à Indian Hill.
Roth place son histoire en 1944, il illustre ainsi vraiment comment l’histoire est écrite par les vainqueurs en renvoyant dos à dos le hors champ de la Shoah avec le génocide commis par les colons en Amérique, qui lui, est passé sous silence. Et dans cette espèce d’utopie transcendantaliste que représente ce camp de vacances, les belles sœurs de Buck peuvent l’embrasser sur la bouche quand il rejoint la troupe, on mange du roastbeef goulûment, tout est possible, la flèche avance dans le bon sens. Mais c’est un paradis vicié, car il s’est construit sur des monceaux de cadavres, et pourtant on se considère comme le camp de Bien, rien ne vient mettre en doute cela et le pays se pense exempte de crimes, à l’écart de l’histoire des exterminations… Et le journaliste et écrivain Daniel Mendelsohn, dans Les Disparus, a aussi puissamment montré en quoi les juifs américains portent le poids d’une autre culpabilité, celle de ne pas avoir aidé les leurs à échapper à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, en suivant le parcours de deux frères. L’innocence est donc mise en doute par différents biais.
Dans cette deuxième partie, vous reprenez les codes de la comédie musicale pour mieux les retourner contre eux-mêmes et poursuivre ainsi votre critique de l’impérialisme américain, tout en assumant la part de divertissement qui lui est liée. Cet attrait pour le factice et la culture populaire était déjà présent dans votre court-métrage La Chanson, qui se situait à Disneyland et en ce moment adapté au théâtre.
J’avais envie de prendre à bras le corps ces conventions, sans ironie. Et avec l’équipe nous nous sommes vite rendus compte qu’il fallait être très humbles, parce que je crois que c’est une des formes les plus difficiles à réaliser. Je suis allée à Broadway, j’ai vu des choses qui tournent en France, regardé beaucoup de DVD, il y a des éditions très belles de Sondheim et Bernstein. Quand ça marche, je trouve que c’est vraiment génial, cela provoque une forme d’ivresse, de plaisir face à cette virtuosité, on est ébahi par ce monde enchanté. Et le retour à la réalité ne peut être que déceptif.
D’un autre côté, j’ai un rapport plus ambigu à la comédie musicale, je trouve que l’aspect technicolor, les sourires parfaits, tout cela est suspect, trop lisse. Il y a une forme de totalitarisme derrière cette perfection. Cette forme exemplifie aussi l’impérialisme culturel américain, que j’avais envie de miner de l’intérieur dans ma mise en scène. Car toute cette légèreté va se retrouver plombée par l’inoculation du virus, de la même manière que dans un spectacle, tous les soirs il y a de l’aléa, du danger, comme ici avec les numéros de voltige. Ça met le spectateur dans une situation de tension comme au cirque, même si le risque est mesuré malgré tout on défie les lois de la gravité et quand l’acteur se jette dans le vide, c’est toute la salle qui saute avec lui. Ce pacte est important. La gravité peut être aussi prise dans un sens plus figuré : elle travaille aussi la légèreté dans la dernière chanson, « laundry day », quand une des cheftaines dit que c’est le jour de lessive, on chante, on chante en faisant la lessive, tout va bien dans le meilleur des mondes mais l’inquiétude plane car c’est aussi pour enlever les microbes et autres virus potentiellement tueurs.
Plus généralement, il me tient à cœur que les gens qui n’ont pas lu le roman, ou qui ne vont pas souvent au théâtre, se sentent accueillis, qu’ils puissent prendre part au spectacle. Je ne veux laisser personne à la porte. Pour moi, au-delà du type de forme, cela passe par le fait de raconter des histoires, et ce n’est pas incompatible avec la création d’images, à la recherche de traductions scéniques qui donnent accès à d’autres niveaux de lecture, et chacun vient avec sa propre sensibilité, sa culture, son histoire pour compléter le spectacle. Mais raconter une histoire me paraît fondamental. Mon ancien professeur, Stuart Seide, disait que le spectacle le plus long de sa vie durait 40 minutes… Cette impression n’a rien à voir avec la durée réelle du spectacle bien sûr. Cela tient au pacte que l’on établit avec le spectateur. J’aime la fiction, la dimension spectaculaire, disons pour le dire grossièrement que « les gens en aient pour leur argent. » Si on veut faire venir les gens au théâtre, il faut leur proposer une expérience qu’ils ne peuvent pas avoir ailleurs : dans une salle, nos organes ne fonctionnent pas de la même manière, les sons nous traversent autrement, nous sentons, nous voyons, nous écoutons différemment. Alors j’ai besoin de mettre tout l’artisanat théâtral au service de ce moment qui doit être un moment unique, un moment de convergence pour faire ressentir des sensations, des émotions au public. Il doit y avoir un événement. Sinon à quoi bon ?
Frédérique Leichter-Flack, dans son ouvrage Pourquoi le mal frappe les gens bien ?, parle du paradoxe d’ « une contingence inéluctable », à savoir qu’en littérature le malheur arrivera toujours, rien ne peut être déjoué et il frappera chaque fois qu’on lira le roman. Mais c’est peut-être cette inéluctabilité-même qui est un moyen de conjuration. En reproduisant chaque soir ce « hasard inéluctable », est-ce une façon de mieux affronter le « scandale du mal » ?
Je crois que j’y réponds par mon métier, oui. Raconter des histoires, créer des spectacles, c’est pour moi mettre en forme ces questions et donc, d’une certaine manière, les apprivoiser même si il n’y a pas de réponse. Faire du théâtre, c’est une façon de conjurer le sort. Disons que mettre en forme le chaos permet de vivre avec ces angoisses-là, je crois que c’est un rapport au monde qui est à la fois obsessionnel et est un bon moyen de calmer ses névroses…. Je pense qu’il faut être obsessionnel pour s’enfermer dans une salle noire et travailler à mettre en forme et en mots l’inconnu. C’est un rendez-vous une fois par jour que l’on se donne avec le mystère. Et la beauté, avec le théâtre, c’est que c’est un art vivant, c’est une rencontre avec l’inconnu chaque soir.
Si cette confrontation permanente avec l’aléa est un des traits du théâtre, vous avez aussi une pratique de cinéaste. Vous avez recours à la vidéo sur scène, mais comment plus largement cette autre pratique vous nourrit-elle ? Et qu’est-ce qui vous attire dans le cinéma que vous ne trouvez pas au plateau ?
Je crois que c’est un travail de traduction qui m’intéresse, c’est pour ça que j’ai eu envie d’adapter mon court-métrage La Chanson au théâtre, et à l’inverse d’explorer ma pièce Dans le nom au cinéma. J’ai l’impression que la potentialité d’un sujet peut se déployer en images au cinéma quand j’ai l’impression que cela déplace et apporte quelque chose. C’est pour cela que je ne ferais pas de France-Fantôme un film, car justement je crois que l’intérêt de ce spectacle est de proposer de la science-fiction au théâtre, ce qui est très rare, alors que ce genre est majeur au cinéma. Sur un plateau, cette proposition est vraiment un pari.
Au théâtre, ce qui m’intéresse c’est notamment de mettre en mouvement la puissance imaginaire des spectateurs. On va venir mettre le public à contribution puisque l’image n’existe pas, il faut qu’elle naisse dans cette rencontre avec ce qui se passe sur scène et dans la tête du spectateur. Et puis je trouve que l’on a beaucoup de libertés dans les arts du spectacle : ça coûte moins cher, il n’y a pas d’équivalent du producteur, on peut plus facilement tenter des choses et réaliser sa vision. Alors qu’au cinéma, tout le monde donne son avis, c’est difficile de prendre des risques à cause de l’argent impliqué. Le théâtre est un art de l’oralité, et ontologiquement un art pauvre qui peut exister de façon minimaliste, juste par la rencontre d’un acteur et d’un spectateur, et à partir de là, rien qu’avec ça, tout est possible. Je trouve d’ailleurs que le paysage contemporain français témoigne d’une grande créativité, d’une vraie diversité de formes.
Au cinéma par contre, le système tel qu’il est me paraît plus guindé, un peu momifié dans son embourgeoisement, il ne laisse que difficilement place aux expérimentations ou au lâcher-prise. Pour financer des films, il faut faire appel à des stars alors qu’au théâtre ce n’est pas du tout une question. Ce qui me passionne néanmoins, c’est le montage des images, de voir à quel point les images pensent, à quel point la confrontation de deux images peut titiller notre intelligence, provoquer des émotions. Sur ça, le théâtre ne pourra jamais rivaliser. Je pense cependant que je travaille de plus en plus comme une monteuse au théâtre.
Entre un spectacle de science-fiction, un autre à partir des œuvres de miséricorde, et désormais une adaptation d’un romancier américain, on constate que vous vous remettez en jeu pour chacun de vos projets. Avez-vous besoin de vous mettre en danger pour créer, tout en creusant votre sillon ?
Une telle démarche s’inscrit dans le plaisir d’apprendre, j’adore commencer un projet en me disant que je ne sais pour le moment encore rien ni sur ce que l’on va faire ni sur un sujet, et que je vais donc découvrir plein de choses. Il y a quelque chose de l’ordre de l’enquête, avec ce pari de faire ce que je n’ai jamais fait auparavant. Sinon, j’ai peur de m’ennuyer terriblement. Je veux proposer un nouveau monde en soi à chaque fois. Et pour cela, j’ai l’impression de repartir à zéro, ce qui est évidemment terriblement angoissant parce que je crois ne pas pouvoir capitaliser sur les expériences précédentes, une manière de faire… Et en même temps, c’est un peu une illusion car je sais bien que j’avance, qu’il y a une forme de progression au fur et à mesure, que je gagne en expérience, surtout dans l’écriture, et ça c’est très joyeux et agréable. Pour revenir sur votre question précédente, je pense que j’ai aussi beaucoup appris de l’écriture de scénario, et entre France-Fantôme et La Réponse des hommes je crois qu’on sent vraiment comment cette écriture scénaristique m’a aidée à me concentrer sur une espèce d’essence, à percevoir comment une image, ou quelques éléments suffisent à être signifiant. Je voulais sortir de l’épopée pour explorer quelque chose de beaucoup plus fragmentaire, en m’inspirant plutôt d’un travail de nouvelliste. Au départ, on a envie de tout mettre dans ses premières œuvres, ce qui créé une sorte de saturation. Et puis on apprend à épurer… mais il faut savoir garder la prise de risque.
Némésis, librement adapté du roman de Philip Roth par Tiphaine Raffier, jusqu’au 21 avril 2023 aux Ateliers Berthier (2h50).
