Splendeurs et misères de l’humanité – sur La réponse des Hommes de Tiphaine Raffier
Cela commence tambour battant : les blouses blanches s’agitent, puis laissent place à des costumes folkloriques éclairés par des flammes, tandis que des chants archaïques s’élèvent, puissants – de quelle cérémonie, de quel rituel sommes-nous les témoins mis sous tension ?
Tout va très vite : une couronne de fleurs est vissée sur la tête d’une femme, elle se débat, l’étau se resserre, la femme crie, du sang dégouline, et les fleurs se font épines, lui donnant l’allure d’une martyre femen. Une femme plus âgée apparaît, grimaçante, elle-même coiffée de ce couvre-chef de torture ; elle cherche à la rassurer : ne t’inquiète pas ma chérie, tu vas voir, ça va cicatriser, et au bout de quelques années, on commence à s’y faire…
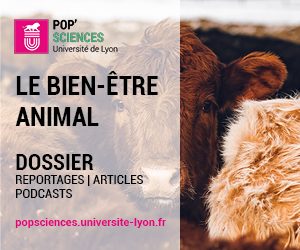
Peine perdue, la nouvelle couronnée ne semble pas réconfortée, le regard inquiet, le front rouge, et on la comprend. La porte s’ouvre de nouveau, et cette bourrasque d’intensité s’y engouffre, disparaissant derrière le mur blanc qui clôture la scène. On souffle un peu, encore sur ses gardes – que va-t-on maintenant nous faire vivre, après une telle entrée en matière ?
La Réponse des hommes renouvelle le théâtre de situations, un théâtre ajustant des situations-limites afin d’exprimer au mieux les enjeux du monde.
Les mots « Accueillir les étrangers » sont alors projetés, comme un titre ou un indice, avant de laisser place de nouveau à la vidéo. Mais cette fois les comédiens sont dérobés à notre vue, et nous sommes plongés par l’intermédiaire de la caméra dans une maternité reconstituée. La femme hurlant de douleur que nous avons quittée se tient désormais, sans couronne de fleurs, devant un psychiatre patibulaire à qui elle raconte le cauchemar auquel nous venons d’assister.
Nouvellement mère, elle confesse : elle n’arrive pas à considérer son enfant, cet étranger qu’elle a porté en son sein, à l’accueillir comme tout le monde s’attend à ce qu’elle le fasse. S’engage dès lors un jeu de regards avec le spectateur : alors que tous les soignants ne cherchent qu’à focaliser son attention sur cette vie nue entre ses bras, par des remèdes discutables (prendre des photos avec enfant, être filmée en train de le laver), son regard se fige inéluctablement face caméra, faisant de nous les témoins de sa détresse : tabou suprême, l’« amour maternel » lui est inconnu. Fin de partie et postpartum, elle porte la croix de la maternité et se sent incapable de prodiguer les soins nécessaires à son nourrisson.
Pourtant, nourrir les autres, et notamment les plus précaires, c’est son métier. Cette Madame Serra, comme elle est nommée, donne « à manger aux affamés », à des inconnus, au sein d’une ONG où elle est confrontée continuellement à des choix cornéliens – et où la perte d’une cargaison de 21 tonnes lui pèse encore sur la conscience. Dans un monologue un peu didactique, évoquant les survivants des films catastrophes, elle interroge alors : qui mérite d’être sauvé ? Toutes les vies se valent-elles ?
Accueillir les étrangers, Donner à boire aux assoiffés, Vêtir ceux qui sont nus, Visiter les prisonniers, Assister les malades. Ces préceptes chrétiens, miroir des Dix commandements, sont tirés des Œuvres de la miséricorde de Saint Matthieu, et se divisent entre œuvres « corporelles » et « spirituelles ». Tiphaine Raffier les prend comme titres et points de départ pour rythmer chacune des scènes qu’elle tisse admirablement. Elle sécularise certaines de ces règles morales pour les incarner dans des situations contemporaines, à la façon du cinéaste Krzysztof Kieślowski dans son Décalogue, source d’inspiration assumée de la metteuse en scène.
La Réponse des hommes renouvelle ainsi le théâtre de situations tel que Sartre le revendiquait, à savoir un théâtre ajustant des situations-limites sans se préoccuper de psychologisme, afin d’exprimer au mieux les enjeux du monde et d’entrer en résonance avec le public. Si le philosophe entendait montrer les frottements qu’impliquait la liberté, Tiphaine Raffier met en place de son côté autant de laboratoires pour nous confronter à des vertiges éthiques.
Sans s’encombrer d’une narration classique, elle s’attache tout de même à raconter des histoires, qui prennent la forme de neuf fictions tragi-comiques, portées par une ronde de dix comédiens formidables. D’aucuns lui reprocheraient une certaine superficialité dans cette accumulation de vignettes plus ou moins liées entre elles, mais c’est ce goût du risque, l’inventivité et la force de frappe répétées de chacune des séquences qui percutent. Le spectateur est comme invité dans un white cube scénique où, sans bouger, on lui propose de circuler de pièce en pièce pour sonder à chaque fois les splendeurs et misères humaines.
Opérant par cristallisation et constellation, l’autrice et metteure en scène privilégie ainsi le lacunaire à l’exhaustif, les zones troubles aux lignes de partage rassurantes, et déroute en s’attaquant à des sujets rarement mis en scène : le rejet de la maternité, la pédophilie, l’homosexualité dans l’armée, l’alcoolisme… Elle excelle surtout à créer des hiatus, à affermir les tensions, à démonter tout manichéisme : la vie du jeune Diego, survivant artificiellement grâce à une dialyse, est suspendue à une greffe de rein. Son attente est interminable, sa séparation amoureuse résulte de cette situation – tout pousse à la pitié.
Pourtant, Diego n’est pas exempt de « perversion » honteuse ; et malgré tout parfois il danse, il danse, un ange enfin léger et joyeux, porté par sa passion pour Fred Astaire… De même, alors qu’un psychiatre veut réaliser un documentaire fastidieux sur la pédophilie, une autre médecin se plaint : lui et son équipe prennent trop de place, utilisent trop d’argent pour des individus déviants qui ne le méritent pas, comprend-on à demi-mot. Autant de questionnements auxquels les hôpitaux ont été confrontés à leur façon dernièrement avec le tragique « tri des patients », ou encore l’exaspération provoquée par les malades du Covid non vaccinés en réanimation, faisant dire à certains qu’ils ne seraient pas dignes d’êtres soignés.
Mais, suivant l’éthique hyperbolique de Derrida[1], n’y a-t-il, justement, de pardon, s’il y en a, que de l’impardonnable ? Seules des situations extrêmes nous acculent à des choix moraux, nous poussent vers nos limites, et in fine mettent à l’épreuve notre humanité ; il s’agit donc, à chaque fois, de faire l’impossible.
Tout cela nous renvoie à nos propres tergiversations. Entre sirène de la dissonance et signal pour nous maintenir en éveil, une alarme scande le spectacle. Un mystérieux groupe d’activistes, entre Act Up et Extinction Rebellion, entrent dans les tribunaux, les hôpitaux, les musées pour afficher leur tract lapidaire : NOUS SOMMES DÉSOLÉS, écrit sous un triangle de Sierpiński, une fractale obtenue à partir d’un triangle « plein » se divisant en plusieurs triangles pour former un nouveau triangle. Nous sommes désolées, de quoi, pour quoi ? Si le triangle est mis en avant, le slogan et le spectacle évoquent plutôt la quadrature du cercle. Chacun, alors, répondra à manière dans la liberté des béances laissées ouvertes.
Tiphaine Raffier, cette « Femme coupée en deux », nous écartèle et nous unit, orchestre pesanteur et grâce, humour et gravité.
La Réponse des hommes, usant de tous les moyens dont le théâtre peut s’emparer – avec la présence des musiciens de Miroirs Étendus, la vidéo, la performance des comédiens, une architecture tectonique –, loin d’être une œuvre d’art totale dans la lignée wagnérienne, qui appelait de ses vœux la fusion des formes, opère par des montages conflictuels entre le texte, la musique, le décor et les comédiens, où chaque élément peut se retourner contre lui-même.
Ainsi, la mise en scène est à l’image des contradictions dont elle entend parler, s’offrant comme une surface d’interrogation où les éléments se distancient mutuellement. En cela, ce spectacle endosse l’héritage de Brecht, pour qui la représentation de la cruauté humaine n’empêchait pas d’être source de divertissement, tout en réalisant « des processus ajustés dans lesquels s’expriment les idées de l’inventeur de la fable sur la vie en commun des hommes », comme il l’écrit dans Le Petit organon. Plaisir grinçant qu’offre le miroir, à la fois de concentration et déformant, de la scène, où l’on peut prendre plaisir à voisiner les gouffres.
Tiphaine Raffier, cette « Femme coupée en deux »[2], nous écartèle et nous unit, orchestre pesanteur et grâce, humour et gravité comme lors de ce Secret Santa qui tourne mal, mélange les langues et les genres, et manœuvre de telle façon à n’être ni accablante ni édifiante tout en éveillant l’intelligence du public. Voilà, en somme, une œuvre bien généreuse qui nous hisse.
En 2016, le pape François décidait de rajouter une nouvelle œuvre de la miséricorde : « sauvegarder la Création ». Selon lui, cette mission requiert notamment de « simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme […] et se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur » (Laudato si’, n° 230-231).
Cette dimension écologique, dans le spectacle, prend la forme d’une archéologie du futur lors du dernier tableau, qui témoigne du goût pour la science-fiction dont avait déjà fait preuve Tiphaine Raffier dans ses précédents spectacles. Des individus, avec cette nonchalance des visiteurs philistins, suivent les indications d’une guide qui leur présente cette fameuse affiche leitmotiv mise sous cloche, et devenue de facto une icône et une curiosité du siècle passé.
La guide finit son explication, avant de se retirer. Le masque à gaz qu’elle enfile, et les éclairs tonitruants que la porte ouverte dévoilent, indiquent un monde hostile, où crainte et tremblement règnent – et le théâtre lui-même finira balayé comme une page blanche. Ici, la sauvegarde de la création s’accorde donc, aussi, à celle de la création artistique. Et voilà sûrement la plus belle réponse des hommes (et des femmes) que ce spectacle pouvait offrir.
La Réponse des hommes, textes et mise en scène de Tiphaine Raffier, jusqu’au 28 janvier au Théâtre Nanterre-Amandiers, du 3 au 12 février au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, les 23 et 24 février au théâtre de Lorient, du 2 au 4 mars à La Comédie de Saint-Étienne, du 9 au 11 mars au ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, du 16 au 19 mars au Théâtre Olympia de Tours, les 24 et 25 mars au Phénix Scène Nationale de Valenciennes et du 6 au 9 avril au Théâtre du Nord de Lille.
