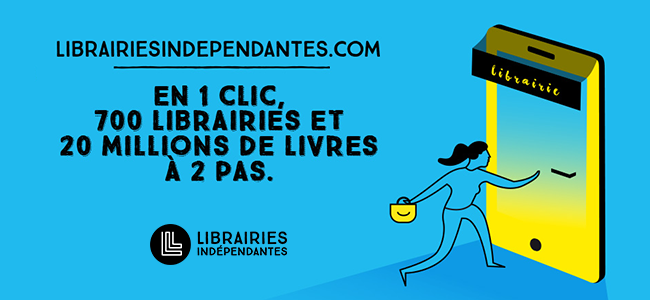Vélib’ ou la crise de la mobilité douce (1/2)
Les limites de nos démocraties représentatives se révèlent désormais au grand jour, ne serait-ce que quand il s’agit de travailler, dans le menu de nos expériences citoyennes, les controverses auxquelles nous sommes mêlés. Il est temps de prendre part aux arènes et forums, au titre de cette « démocratie dialogique » dont Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe avaient souligné l’importance et loué l’émergence. Ainsi est-il nécessaire de prendre part au choix des questions relevant de la décision, et de participer à la composition des assemblées ayant à les traiter.
D’autres auteurs, dans d’autres cercles [1], ont pu montrer combien notre conception de la démocratie était conditionnée par notre acception de la Loi, et par l’idée que nous nous faisons de l’autorité politique, sinon de la puissance publique. À Rome, il y eut les res publicae, les choses appartenant au peuple (poplicus), et la res publica, la chose publique, engageant l’organisation politique. Dans la période qui court de la République à l’Empire, s’effacera cette qualification d’un public délié de l’État, bien que ne relevant pas du domaine privé. Dès lors cette mise sous tutelle ne souffrira pas de remise en cause, sauf à de brefs intervalles (ainsi aux premiers temps de la République, lors de la Révolution française).
Dans ces circonstances de crise de la représentation démocratique, le retour du/des commun(s) revêt une forte signification. Il peut constituer un fil pour comprendre les enjeux des politiques du proche, dont celle de la ville – et au premier chef au regard de la question de la mobilité.
Arrêtons-nous sur cet instant de notre condition métropolitaine, voyant à Paris survenir simultanément le renouvellement chaotique du réseau public Vélib’ (mise à disposition de vélos par abonnements de courte ou longue durées grâce à des équipements situés sur la voirie et les bicyclettes) et l’irruption des flottes dites « libres » de petites reines en apparence sans attaches (free floating). Cela en une séquence d’aléas climatiques (crues de la Seine), suivie de débrayages des services publics de transports en commun, qui accuse l’importance d’une telle controverse.
Le réseau Vélib’ 1 était un service public dont la qualification juridique et économique faisait problème, tant apparaissaient imbriqués droits et obligations des contractants.
Dans une contribution récente à un ouvrage consacré au retour des communs, la juriste Aurore Chaigneau relevait que le réseau Vélib’ 1 (soit la délégation confiée à la société JC Decaux sur la décade 2007-17) était un service public dont la qualification juridique et économique faisait problème, tant apparaissaient imbriqués droits et obligations des contractants. Si la propriété de la flotte et de l’infrastructure revenait à la société exploitante, ainsi que les charges d’exploitation et d’entretien ; les bénéfices des recettes d’exploitation allaient à la maîtrise d’ouvrage (la Ville), tandis que seront en définitive imputés à cette dernière de lourds engagements financiers imprévus dans le contrat initial – ce, outre sa mission de contrôle de l’exploitation. Enfin, contre une obligation d’usage conforme, revenait aux citoyens-cyclistes l’utilisation potentielle de l’ensemble des vélos disponibles.
Le dispositif relevait d’un troc pour le moins discutable. Il assortissait cette mission de service public à la concession gracieuse de l’implantation publicitaire de l’affichiste sur le territoire (sinon l’acquittement d’une modeste redevance d’occupation du domaine public). Déjà présentes à Paris en amont de ce deal, les fameuses sucettes et autres supports d’affichage se rendaient dès lors indispensables au bon fonctionnement de la politique des transports de la Capitale, en donnant à craindre que tel service rendu au public ne se confonde indéfiniment en tel monopole lucratif consenti à un tiers. De plus il était à parier que « l’équilibre entre marché publicitaire et vélo en partage [ne soit en outre] rarement obtenu dans le sens favorable au développement progressiste de politiques de la ville, car les arguments marchands limitent [de fait] toute renégociation des usages », l’absence d’intéressement de l’exploitant pour les recettes encaissées et le coût du service à rendre ne l’incitant guère à y investir.
La part de financement assuré par l’usager étant par ailleurs, de ce fait même, si faible – Aurore Chaigneau estime à 5 ou 10% sa contribution au coût de revient contre 20 à 30% pour les transports en commun classiques – cette impression de quasi-gratuité du service (abonnement annuel autour de 29€ pour une utilisation illimitée et sans frais des premières demi-heures) ne contribuait pas non plus à ce que le cycliste ait conscience de l’investissement dont il avait l’usage.
Si Vélib’ 1 a pu rendre des services considérables aux utilisateurs et accomplir une fonction socio-écologique indéniable, quoique difficilement mesurable, il était ainsi grevé de vices de fonctionnements qui ne faisaient pas ou peu débat. Ainsi de l’inféodation potentielle de la collectivité à un réseau économique dont elle n’avait pas la maîtrise (avec le risque d’un abus de position dominante de l’opérateur encastré dans cet échange de services dont il était initiateur). Et de l’absence d’association des utilisateurs à la politique des transports (qui auraient pu alerter sur ces risques et mettre en garde quant à ces dérives financières), ce défaut de gouvernance résistant en tout état de cause à son inscription sous le sceau d’un commun urbain auquel d’aucuns voudraient à tort l’assimiler.
Or la puissance de feu de l’opérateur aura pesé lourd dans la renégociation des avenants au cours de la décennie écoulée. La Ville aura ainsi dû se résoudre à assumer une compensation conséquente (400€ par vélo) des dégradations surnuméraires à l’égard des prévisions initiales. Elle aura par ailleurs décidé de l’installation à ses frais dans les communes de la première couronne d’un nombre conséquent de stations supplémentaires. D’après Les Echos il en aurait ainsi coûté de l’ordre de 11 à 14 millions par an à la Ville entre 2010 et 2014 (après décompte des recettes d’exploitation) ; LCI porte l’addition à 15 millions par an selon un rapport commandé par la Ville dont il aurait eu connaissance.
Autant dire que le système, pour séduisant qu’il fût en apparence, était à long terme difficilement viable.
Le passif de la situation antérieure aura joué un rôle dans les motifs et la présentation de la décision, soit la victoire sur le Goliath de l’équipement urbain Decaux du présumé David Smoove.
L’appel à concurrence pour le renouvellement de cette délégation de service public se produira en 2017 dans un contexte bien différent. Le lieu de la décision se sera déplacé, dans le temps où le territoire changeait de dimension. La Ville de Paris passant la main, le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole a désormais en charge (depuis janvier 2018) la gestion d’un parc auquel sont associées 67 des 131 communes de l’instance territoriale qu’est la Métropole du Grand-Paris (créée en 2016). Cette échelle supra communale ayant davantage de raisons de s’inscrire avec efficacité dans les réseaux de transport en cours de reconfiguration à l’échelle francilienne.
Un tel service public métropolitain ne pouvait se satisfaire des arrangements municipaux antérieurs. Et le marché passé à hauteur de 600 millions € TTC reviendra à la qualification classique d’une prestation rendue par un tiers contre rétribution afférente. Exit donc le deal publicitaire.
Le poids joué par la ville Capitale dans le syndicat intercommunal (au titre de sa taille, et en tant qu’acteur originel du dispositif de vélo en libre-service, ou VLS), n’aura cependant pas été négligeable pour qu’au terme de longues péripéties juridiques, ce marché échoie au groupement Smovengo. Le passif de la situation antérieure aura joué un rôle dans les motifs de la décision et la présentation qui en sera faite, soit la victoire sur le Goliath de l’équipement urbain Decaux (3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 13.000 salariés), d’un présumé David, en l’espèce la « sympathique entreprise provinciale » Smoove (9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 38 salariés). L’amertume résultant des mécomptes antérieurs, et le marquage d’une souveraineté politique d’autant nécessaire que la situation précédente aura accusé sa faiblesse, auront joué comme des aiguillons pour que la Collectivité se rachète de la sorte une conduite en écologie politique.
Toutefois, cet adjudicataire de taille modeste n’avait pas à démontrer son savoir-faire au regard de son expérience, notamment en matière de gestion numérique des flux qui lui avait déjà permis de s’installer dans 26 villes, en France (Montpellier, Strasbourg, Clermont- Ferrand) et à l’étranger (Moscou, Helsinki, Marrakech, Chicago). En outre, tel petit poucet était adossé à trois puissants acteurs : le groupe de services automobiles Mobivia (détenu par la galaxie Mulliez), l’espagnol Moventia et Indigo (ex-Vinci Park), employant au total plus de 40 000 personnes selon la revue Challenges. Autant dire que le pouvoir d’influence de ces derniers n’éloigne pas le péril de renégociations futures durant le bail des 15 années à venir, quand le bilan d’exploitation se sera révélé moins flatteur que prévu.
Il importait de livrer d’abord cette relation du contexte dans lequel le service de vélos en libre-service a vu le jour à Paris, et la complexité de la structure juridico-économique qui fut celle de Vélib’ 1. Il importait aussi de dire en quoi la donne avait changé pour que surgisse ce Vélib’ saison 2.
Dès lors autant d’exploitants se succédant, autant de réseaux à concevoir ? La question se posera au titre de la seconde partie de cette chronique, à paraître demain (il est à croire que l’affaire Vélib’ mérite à elle seule l’invention d’un feuilleton à sa mesure…). Mais il nous reviendra d’abord de comprendre les raisons de la situation chaotique prévalant depuis la mise en service de ce nouveau bail, depuis janvier de cette année. Et d’en analyser les attendus techniques et politiques. Il sera ensuite temps d’interroger le phénomène des escadrilles des vélos sans attache survenues opportunément dans le paysage francilien, au moment même où l’armada du service public se voyait soudainement assignée à résidence.
Nul ne saurait concevoir de politique urbaine équilibrée, sans relation démocratique à la mobilité.