Fin de la longue histoire des directeurs d’école primaire ?
Est-ce le commencement de la fin ? On peut le supposer en prenant connaissance des conséquences d’un amendement présenté au moment de la discussion de la « loi pour une école de la confiance » qui vient d’être votée : la création d’« établissements publics des savoirs fondamentaux ». Une longue marche historique dont les acteurs peuvent être fiers irait ainsi vers sa fin.
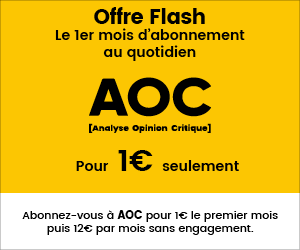
Pendant longtemps, le directeur d’école a été « le » maître de l’école communale, et les autres instituteurs ont été ses « adjoints ». Un premier tournant a eu lieu il y a juste un siècle. La circulaire du 15 janvier 1908 crée officiellement le « conseil des maîtres » dans un but d’ « unité et d’harmonie » tout en continuant à accorder au directeur un pouvoir important .
On notera l’insistance à mettre en évidence (déjà !) l’idée que le métier d’enseignant ne doit pas se pratiquer de façon solitaire : « L’Ecole est une, quel que soit le nombre de ses maîtres, et tout enseignement est une collaboration. Il n’est pas de conception plus fausse que celle qui maintiendrait le directeur et ses adjoints dans un isolement mutuel, le premier concentrant en sa personne toute la vie administrative et pédagogique de l’école, les seconds réduits à une obéissance étroite et bornant leur activité à enseigner suivant des méthodes et des principes acceptés sans discussion et sans foi, et imposés d’autorité ».
La circulaire de 1908 met pourtant en évidence le pouvoir qui doit rester dans les mains des directeurs. Le texte exclut des questions qui doivent être soumises au Conseil des maîtres tout ce qui relève du champ administratif : les relations entre l’école et les autorités locales, qu’elles soient « municipales ou académiques » ; les rapports avec les familles ; tout ce qui touche à « l’entretien des bâtiments » ; et enfin « l’ordre général de l’établissement ». Restent donc les questions pédagogiques, qui peuvent être discutées au sein du Conseil des maîtres.
Tout cela va rester sensiblement en l’état jusqu’
