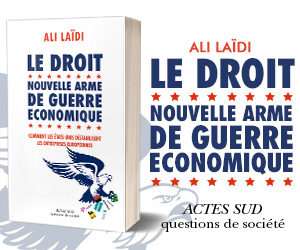Sage comme une image, l’hygiène du numérique
Il se fait et il se fera tout autant de bons et de mauvais films en numérique qu’en argentique. Alors ? Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce que ça change pour celles et ceux qui voient les films, qui les fabriquent, les cinéphiles, les cinéastes ? Peu et beaucoup. Rejoignant le fil des anthropologues et des philosophes de la technique et du geste (André Leroi-Gourhan, Gilbert Simondon), l’Association des Documentaristes (ADDOC) pouvait écrire il y a trente ans : « Les manières de faire sont des manières de penser ». Si l’on suppose que c’est toujours le cas, le passage général au numérique (tournage, montage, étalonnage, diffusion) a tout changé. Les machines à filmer (caméras, téléphones portables, tablettes) se sont multipliées au-delà de toute imagination. Cela fait symptôme : telle est la puissance de la marchandise en audiovisuel aujourd’hui. Avec le numérique, les prothèses visuelles, auditives et mémorielles que sont les machines à enregistrer et à filmer développent la consommation, sans doute, mais aussi le contrôle.

Nos yeux et nos oreilles occupés par le marché des images et des sons, ça tourne de tous côtés, manifestants, policiers, passants, pour prendre l’exemple des dernières manifestations des « Gilets Jaunes ». Une part de ces enregistrements audiovisuels est immédiatement « mise en ligne » et visible dans l’instant sur tous les écrans ; ils peuvent être à la fois divulgués et détournés. Adieu les questions, les doutes ! Il n’y a plus de délai entre vision, choix du cadrage, enregistrement et mise en circulation. L’utopie des kinoks de Dziga Vertov (1920) est devenue réalité universellement partagée. Les mêmes bandes images-sons seront visibles au même moment dans les cinq parties du monde. Il s’agissait pour Vertov d’accélérer, précisément, la circulation des motifs révolutionnaires dans l’immense Union Soviétique. En dépit des lenteurs de l’argentique : manipulation délicate, exposition aux agents chimiques, oxydations, encombrement et poids des