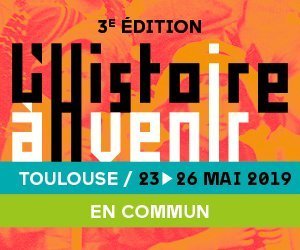Le temps des cathédrales et le rythme des réseaux sociaux
Mon premier souvenir de Notre-Dame remonte à l’enfance, sous la forme d’un puzzle de mille pièces représentant la façade ouest de la cathédrale, prise sans doute dans les années 1970 au vu des véhicules circulant sur les quais et des habits des badauds. Il y eut ensuite la découverte de la cathédrale elle-même, l’admiration devant ses beffrois et son chevet, le plaisir de laisser le regard errer sur le kaléidoscope de couleurs des grandes roses, le temps passé à déambuler dans les nefs latérales en découvrant un tableau jusque-là ignoré, l’agréable flânerie sur le parvis un soir d’été. Émotions personnelles, banales, presque convenues, mais aussi reflet des innombrables expériences vécues autour de la cathédrale par tant de personnes qui se croisent sous le regard de Notre-Dame et se reconnaissent, l’espace d’un instant, une identité commune.
Or, le 15 avril au soir, Notre-Dame brûle ! De longues heures durant, l’impensable devient probable : le vaisseau de pierre que l’on pensait éternel, non en raison d’une croyance quelconque, mais par sa simple présence dans le tissu urbain, s’avère brusquement mortel. Le choc est violent, l’émotion immédiate. Sans doute est-ce dans cette émotion qu’il faut chercher les raisons qui amènent, dès les premiers instants du drame, tant de personnes à s’imaginer vétéran des sapeurs-pompiers ou expert en restauration de bâtiments anciens. Le phénomène est exacerbé par les réseaux sociaux, où fausses bonnes idées – l’usage des Canadair suggéré par Donald Trump et une myriade d’internautes sincèrement choqués mais peu au fait des réalités de la lutte contre les incendies –, théories du complot farfelues ou xénophobes et indignations fracassantes se répandent aussi vite que le feu dans la charpente de la malheureuse cathédrale. Certaines prises de positions sont odieuses : des accusations islamophobes formulées par plusieurs représentants de l’extrême-droite aux railleries de quelques représentants d’un syndicat étudiant autrefois porteur des combats les plus progressistes, nombreux sont ceux qui se sont vautrés dans l’ignominie. Laissons-les à leurs tristes obsessions.
Car Notre-Dame nous rassemble, comme le suggère son nom, si familier qu’il est inutile de préciser de quelle église dédiée à la Vierge il est question. N’en déplaise à certains, la basilique en proie aux flammes n’est donc pas seulement un bâtiment, un assemblage de pierre et de poutres, dont on n’aurait aucunement à se soucier, et ceci d’autant moins qu’il n’y a fort heureusement aucune victime à déplorer. Mais il serait tout aussi faux d’en faire exclusivement l’incarnation de la civilisation chrétienne ou européenne, ou de ne pleurer que la perte des œuvres d’art inestimables qu’elle abrite. Si nous sommes si attachés à la vénérable cathédrale, dont on a fêté les 850 ans en 2013, c’est d’abord parce que son histoire et son ancrage dans le paysage urbain en ont fait un miroir de la cité et de nous-mêmes, dans lequel se cherchent et se reconnaissent des personnes aux trajectoires et aux idées aussi diverses que les pièces formant les panneaux des rosaces heureusement sauvées. Notre-Dame demeure, pour les Parisiens, mais aussi pour nombre de Français et de citoyens du monde, un repère dans un monde qui change. Nulle invitation ici à regretter le temps passé – « si c’était mieux avant, c’est parce qu’on était jeunes », nous avertit l’humoriste Yann Marguet. Il s’agit simplement de rappeler que Notre-Dame, en raison de sa place dans l’histoire de la ville, a pu devenir le pivot d’une myriade de systèmes symboliques et d’attachements personnels ou collectifs, interdisant de la réduire à un lieu de culte catholique ou à un piège à touristes avides de selfies.
Au fil des siècles, Notre-Dame a vu des lectures symboliques, parfois antagonistes à première vue, se greffer sur ses arches de pierre, et la cathédrale parvient à réaliser l’exploit d’accorder les contraires.
Victor Hugo l’avait bien compris, lui qui fit de Notre-Dame le personnage principal du roman homonyme qu’il publia en 1831 : Notre-Dame y incarne la ville de Paris, dont la vie collective s’articule autour de la cathédrale, alors que les destins des protagonistes et celui de l’édifice sont inextricablement liés. Comme nombre de grandes églises qui furent longtemps au cœur de la vie religieuse et politique d’une cité – le Dom de Cologne, la Grande Mosquée de Cordoue, et bien d’autres –, Notre-Dame fait partie de ces édifices chargés de significations que leurs concepteurs n’avaient pas prévues, ni même pu imaginer. Siège de l’archidiocèse de Paris en 1622, temple de la Raison sous la Révolution, église de la Nation après le concordat conclu entre Napoléon et le pape Pie VII, les destins de Notre-Dame sont multiples, jusqu’à accueillir quelques cérémonies marquantes d’une République qui se veut pourtant farouchement laïque depuis 1905 ; le Magnificat de 1944 plaçait ainsi symboliquement la Libération de la France sous le regard de Notre-Dame, devenue pour l’occasion symbole à la fois de la restauration de la République et de l’éternelle grandeur française, dont Charles de Gaulle se voulait le dépositaire.
Au fil des siècles, Notre-Dame a vu des lectures symboliques, parfois antagonistes à première vue, se greffer sur ses arches de pierre, et la cathédrale parvient à réaliser l’exploit d’accorder les contraires. Les thuriféraires d’un étroit nationalisme chrétien qui en revendiquent depuis quelques jours l’exclusivité sont donc particulièrement malvenus, car ils confisquent un monument certes en premier lieu pensé et construit comme lieu de la foi catholique, mais dont la polysémie invite à en refaire le reflet de la cité et de sa diversité en nous réunissant autour des quelques valeurs communes décrites par le grand théologien Hans Küng (Projet d’éthique planétaire. La paix mondiale par la paix entre les religions, 1991), persuadé qu’au-delà des croyances et des religions, humanisme et ouverture peuvent nous réunir.
Notre-Dame, c’est aussi le Temps. Un temps qui n’est pas celui de l’immédiateté. Les prises de positions et les idées avancées ces derniers jours révèlent toutes un sentiment d’urgence teinté d’incrédulité, une nécessité absolue d’agir sans attendre à défaut de pouvoir remonter le temps et d’éviter la catastrophe. Réaction normale, bien connue, mais amplifiée par les réseaux sociaux, accélérateurs de l’information pour le meilleur et pour le pire, et dont le rythme somme chacun d’initier sans délai les actions nécessaires, alors que toutes les données du problème ne sont pas connues. Or, c’est souvent la précipitation qui favorise les mauvais choix et conduit à prendre des décisions qui, faute de la réflexion nécessaire, peuvent s’avérer contre-productives.
Paris aura ses Jeux Olympiques en 2024, mais sans Notre-Dame : on peut le déplorer, mais c’est là une déception finalement bien légère face au spectre d’une restauration mal pensée.
Que l’on soutienne ou non les choix politiques, fiscaux et économiques du président de la République et de son gouvernement, une chose est certaine : quelle que soit la forme de la reconstruction, il est matériellement impossible d’achever les travaux dans le délai de cinq ans appelé de ses vœux par Emmanuel Macron. Plusieurs spécialistes, comme Frédéric Létoffé, coprésident du Groupement des entreprises de restauration de monuments historiques, évalue la durée des travaux entre dix et quinze ans. L’estimation des dégâts, les travaux de sécurisation les plus urgents et les études visant à déterminer la meilleure façon de reconstruire pourraient à elles seules nécessiter entre deux et cinq ans de travail intensif.
Paris aura ses Jeux Olympiques en 2024, mais sans Notre-Dame : on peut le déplorer, mais c’est là une déception finalement bien légère face au spectre d’une restauration mal pensée, réalisée avec des matériaux inadaptés et, dans le pire des cas, ouvrant la voie à un prochain désastre. La société et la politique souffrent de lois décidées trop vite, sous le coup de l’émotion, sans véritables études préparatoires, et parfois chassées par une nouvelle loi avant même d’être appliquées. Ne faisons pas la même erreur ici. Car si le financement de la reconstruction semble assuré, il importe maintenant de laisser aux historiens, architectes, ingénieurs, historiens de l’art et autres spécialistes le temps de penser le renouveau de la cathédrale. Il faut donc espérer qu’après des annonces précipitées et parfois incohérentes, et une fois l’émotion retombée, la raison saura prévaloir ; les décideurs doivent se souvenir que le temps de l’État qu’ils servent est d’abord le temps long, qui les oblige à se projeter au-delà de leur personne et de leur intérêt pour construire le bien commun.
Il faut aussi se donner le temps de réfléchir aux implications symboliques des différentes options de reconstruction. Bérengère Viennot, traductrice et spécialiste du langage politique, propose de ne pas reconstruire Notre-Dame et de se limiter à des travaux de consolidation. Mais figer ainsi dans la pierre l’empreinte de l’incendie au risque de réduire la cathédrale à ce seul moment, comme s’il fallait commémorer ce qui ne fut pourtant pas un attentat, est-ce vraiment une bonne idée ? Faut-il pour autant restituer le monument à l’identique et donner l’illusion qu’il ne s’est rien passé – et, diront certains, laisser entendre ainsi que le financement et l’entretien du patrimoine n’ont pas besoin d’être repensés ? Se montrer audacieux, par un apport résolument contemporain qui poursuivrait la longue tradition d’aménagement et de transformation d’un édifice vu comme l’archétype de la cathédrale médiévale alors qu’elle reflète l’image romantique que se faisait du Moyen Âge Eugène Viollet-le-Duc, architecte de la restauration des années 1840-1860 ? On peut douter de la pertinence d’une flèche de verre et de métal reprenant la forme du Shard londonien, déjà proposée par certains architectes. Enfin, même dans le cas d’une reconstruction visuellement identique, se posera fatalement la question des matériaux et des techniques employés ; et si l’on regrette la disparition de la « Forêt », incroyable prouesse des charpentiers du XIIIe siècle, une structure alliant le béton et l’acier ne serait-elle pas plus sûre ? Afin de conserver la trace de l’incendie tout en rendant à Notre-Dame son intégrité et sa splendeur, le projet pourrait s’inspirer de l’art japonais du kintsugi, où l’artiste restaure les céramiques brisées grâce à une laque saupoudrée d’or, magnifiant ainsi l’objet que l’on pensait irrémédiablement abîmé.
Ces questions, essentielles, masquent cependant à mon sens le fond du problème, que personne n’a formulé jusqu’ici de manière explicite. Il est crucial d’empêcher la confiscation de Notre-Dame par un ou plusieurs groupes désireux d’imposer leur seule lecture de l’édifice. Il faut donc imaginer une reconstruction qui permettra de préserver sa polysémie, qui semblait si naturelle que peu d’entre nous en avaient saisi le caractère essentiel avant la catastrophe. C’est seulement ainsi que tout le monde pourra à nouveau se retrouver dans Notre-Dame et que perdurera sa magie. Mais pour mener à bien cette tâche immense, il est urgent de faire le choix du temps des cathédrales plutôt que du rythme de Twitter.