Michel Serres en historien des sciences
Dans la pluie d’hommages qui saluent Michel Serres, bien des facettes du personnage sont évoquées, sauf celle de l’historien des sciences. On parle de manigance universitaire pour justifier l’élection de ce philosophe au département d’histoire de l’Université Paris 1. Mais c’est oublier que la tradition française associe étroitement histoire et philosophie des sciences. Pendant plus de vingt ans, Serres a formé des centaines d’étudiantes et d’étudiants de licence à l’histoire des sciences.
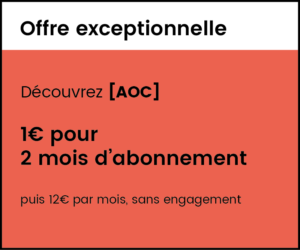
Tous les samedi matin, sous le regard bienveillant des vaches peintes par Puvis de Chavannes dans l’amphi Lefebvre bondé, Serres a exposé et discuté les réflexions qui forment la trame de ses ouvrages depuis les Hermès jusqu’au Contrat Naturel. Tandis qu’une foule bigarrée d’intellectuels parisiens succombait au charme de son vagabondage intellectuel de la thermodynamique à la théorie de l’information, en passant par Zola, Jules Verne et Lucrèce, les étudiants ont été conquis par une manière nouvelle d’aborder et de pratiquer l’histoire des sciences.
Ils n’ont certes pas été élevés dans le respect de l’histoire bachelardienne. En travaillant l’histoire des mathématiques et de la physique, Serres harcelait volontiers la philosophie du progrès qui sous-tend l’épistémologie bachelardienne. Il a mené une critique serrée de la tradition de philosophie des sciences dont il a hérité, remettant en question la classification des sciences et surtout la démarcation entre la science et le reste. S’appuyant souvent sur l’anthropologie (Mauss, Dumézil, Girard), Serres éclairait de manière féconde la production du savoir scientifique à partir de la peinture (Carpaccio, Turner…), de la littérature (Zola, Balzac, Lafontaine ou Molière) ou encore du théâtre (Corneille). Au fil d’une magistrale analyse transversale dégageant les structures communes à tous les savoirs (le point au XVIIe siècle, le plan à fin du XVIIIe et le nuage à la fin du XIXe siècle), les étudiants ont plutôt appris à bousculer le cloisonnement de l’histoire des sciences en histoires des mathématiques, de l’astronomie, de la physique…
Cette approche fondée sur la hiérarchie comtienne des sciences tend à imposer un modèle unique de rationalité qu’il s’agit précisément d’interroger pour chaque époque. Pourquoi la science de Diderot est-elle oubliée ou marginalisée au profit de celle de Laplace ? Pourquoi De rerum natura de Lucrèce est-il relégué dans la littérature ou la philosophie alors que son atomisme nous dit, en poésie latine, quelque chose de la mécanique des flux chaotiques ? Et si Lucrèce nous enseignait que, pour comprendre le monde, il faut se placer au plus près du chaos, de la noise, dans ces régions où l’ordre commence à émerger ? Quant aux étudiants, ils en ont retenu une leçon : qu’il n’y a pas de position de surplomb pour comprendre l’histoire de la Terre, car tout observateur est plongé dans le temps.
Serres ancre les sciences dans une philosophie de la nature qui embrasse tout ensemble le subjectif, l’objectif et le collectif, sans pour autant réduire leurs différences à l’unité.
Au fil de ses cours d’histoire des sciences, Serres a souvent questionné le rôle de la science et ses alliances avec le militaire. Profondément marqué par les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, qu’il interprétait comme la fin de l’histoire, Serres exprimait son angoisse devant la puissance que confèrent la science et technique. Il a longtemps eu la conviction que la science constitue un système idéal de communication rationnelle, universelle, exacte, rigoureuse, efficace. Mais ce système autorégulé n’a plus les moyens de s’autocontrôler : secrets industriels et militaires détruisent le fondement de la rationalité scientifique qui est communication optimale et la guerre s’installe partout. Si bien que « la question maintenant est de maîtriser la maîtrise, et non plus la nature. » (La Thanatocratie, Hermès IV, p. 93).
Sans s’arrêter aux critiques de la tradition, Serres a déployé une nouvelle manière d’approcher les sciences. Après s’être essayé au structuralisme puis avoir questionné les reconstructions mythiques du passé, notamment dans ses cours sur les origines de la géométrie, Serres a pris le tournant des choses. À l’heure où le courant des Science Studies s’implantait solidement en France dans les années 1980, Serres enseignait une nouvelle exigence : étudier les sciences c’est se tourner vers le monde, penser la terre, les fleuves, les turbulences et pas seulement le social. Il ancre alors les sciences dans une philosophie de la nature qui embrasse tout ensemble le subjectif, l’objectif et le collectif, sans pour autant réduire leurs différences à l’unité. D’où l’impression de quelqu’un qui papillonne, qui passe d’un sujet à l’autre, qui navigue dans l’encyclopédie comme sur la Garonne.
En se promenant dans l’histoire comme dans l’actualité des sciences, Serres a très bien perçu, dès les années 1970 l’ascendant des sciences de l’information, puis la montée en puissance des sciences du climat dans les années 1980. Alors que la plupart des cours d’histoire des sciences restaient focalisés sur la physique relativiste et la mécanique quantique, Serres a tourné l’attention de ses étudiants vers les sciences concernées par la genèse de leurs objets, leur histoire, vers les sciences concernées par l’ontogénie plus que par l’ontologie. Il a de même attiré le regard vers les sciences de l’impur. Le mélange, le mixte, le composite, longtemps déclassés par les sciences jugées nobles sont remis en scène par la chimie, la géologie, la météorologie, et l’histoire naturelle. Il a souligné le contraste entre science d’en haut et science d’en bas, entre l’astronomie dont les lois autorisent d’infaillibles prédictions et les météores qui localement s’essaient aux prévisions.
Il a surtout perçu, dès la fin des années 1980, que la distance entre les deux tend à s’estomper. Les turbulences n’agitent pas seulement le local, c’est le climat et l’ensemble de la planète qui traversent des épisodes chaotiques. Les caprices qui caractérisent le temps (weather) viennent troubler le sérénissime temps (time) de la mécanique rationnelle. Les sciences du vivant retenaient aussi son attention. Tout en contraste avec le temps irréversible de la thermodynamique, le temps de l’évolution biologique, créatrice, ne marche pas seulement vers l’indifférencié mais vers la différenciation comme il l’explique dans Le passage du Nord-Ouest (p.67-83). Tandis que Serres déployait un large éventail de temporalités, le temps de l’histoire sociale ou celui de la vie quotidienne finissaient par nous apparaître comme de tout petits ilots dans un océan qui brasse des temps multiples.
Malgré sa passion pour l’enseignement, Serres a toujours refusé de faire école, par crainte sans doute d’enraciner et de figer sa pensée.
Dans sa carrière d’historien des sciences, Serres a instauré un temps fort et particulièrement créateur en créant le groupe de travail qui aboutit à la rédaction des Éléments d’histoire des sciences (Bordas, 1989). Pendant trois ans et demi, un « collectif disparate » comme il le nomme dans la préface, a élaboré une sorte de manuel d’histoire des sciences qui s’adresse à un large public depuis l’« honnête homme » jusqu’aux scientifiques, en passant par les historiens, les philosophes, les littéraires, les enseignants, les étudiants. La disparité des auteurs fut voulue comme un moyen de lutter contre une image faussée parce que trop univoque, des sciences et de leur histoire. La science et son histoire sont retracées à travers des « éléments », des petites pièces balisant un parcours de « bifurcations », vingt-deux études de cas significatives d’une époque ou d’une culture.
En rupture avec l’histoire des doctrines et des concepts, l’ouvrage présente des objets de pensée comme le cercle, des instruments de mesure comme le gnomon, des controverses, des « révolutions », le rôle de l’industrie et du pouvoir, celui du jardinage, du bricolage, des échanges, l’encadrement sanitaire, tout cela montrant la science les multiples facettes de la science en acte. La construction de ce livre collectif ne s’est pas faite par une simple juxtaposition de textes. Chaque chapitre a été discuté, critiqué au cours de deux semaines estivales de travail collectif à la Fondation des Treilles, sous le regard bienveillant d’Annette Gruner-Schlumberger. Au fil d’interminables discussions, les auteurs de chapitres ont échangé leurs vues, leurs idées, partagé leur savoir avec un Serres tout à l’écoute, et non plus en représentation comme dans « l’amphi aux vaches ».
Durant l’année universitaire suivante, chaque projet de chapitre a subi le test de l’enseignement devant de vrais étudiants de licence qui ont aussi, par là-même, contribué à l’ouvrage. Dans ces temps de partage, Serres cherchait-il à former un cénacle de disciples ? Loin de là. Malgré sa passion pour l’enseignement, Serres a toujours refusé de faire école, par crainte sans doute d’enraciner et de figer sa pensée. Porté par la conviction que pour philosopher il faut voyager, il a plutôt agi comme un passeur, un Hermès au pied léger. Aussi les concepts qui ont émergé de ses cours et de ses livres cheminent-ils, parfois souterrainement, dans de nombreux travaux contemporains de philosophie ou d’anthropologie des sciences et des techniques.
