Brexit : la possibilité d’une nouvelle donne linguistique
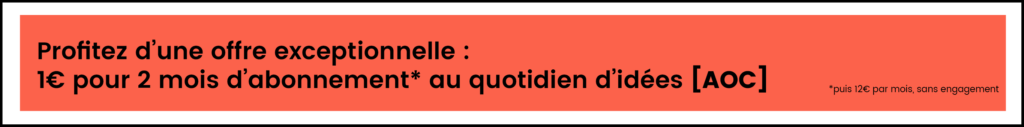
« Mais le problème, dit Alice, est de savoir si tu peux faire en sorte que les mots signifient des choses différentes.
-Le problème, dit Humpty Dumpty, est de savoir qui commande, c’est tout ! »
Lewis Carroll, À travers le Miroir
S’il a lieu, le Brexit emportera dans son sillage l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne. En effet, sur trois pays anglophones, seul le Royaume-Uni déposa l’anglais comme langue officielle lors de son accession à l’Union Européenne, les Irlandais étant ravis de pouvoir faire valoir le gaélique irlandais et non la langue des Anglais, alors que les Maltais virent en l’accession à l’Union, entre autres, l’occasion de donner des lettres de noblesse au maltais.
Mais peut-être la langue de Shakespeare, ou plutôt celle de Robert Burns, reviendra-t-elle si l’Écosse quitte le Royaume-Uni suite au référendum que Nicola Sturgeon souhaite ardemment organiser, si elle accède de manière autonome à l’Union Européenne et si elle dépose alors l’anglais comme langue officielle. Certes, avec des si, on mettrait le monstre du Loch Ness dans une bouteille (de Scotch) et tout cela ne se ferait pas du jour au lendemain.
En attendant cette échéance hypothétique et lointaine, quelle sera la langue qui exprimera le projet européen dans les cinq années à venir ? Le polonais, le finnois, l’espagnol, le grec, le letton ? Il y a fort à parier que ce sera l’anglais, langue d’un pays qui s’en sera détourné et qui ne sera plus que la langue de quelques 5 millions d’Irlandais et de Maltais, moins nombreux que les Slovaques. En effet, à défaut de préserver son statut de langue officielle, il est vraisemblable que l’anglais demeurera une langue de travail, en réalité la langue dominante de l’UE. Cela est d’autant plus possible que l’anglais a déjà ce statut de langue de travail au Parlement européen. Mais le Brexit ne modifiera pas du jour au lendemain l’ordre linguistique établi, car comme l’explique le linguiste Bernard Cerquiglini : « L’anglais est deven
