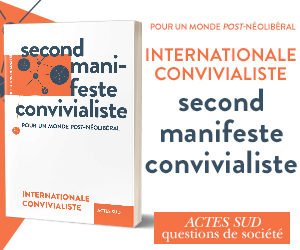Il faut défendre le Conseil national des universités
Le serpent de mer de la suppression du Conseil national des universités (CNU) revient à intervalles réguliers et s’inscrit le plus souvent dans le contexte d’une transformation radicale de l’Université et du statut des enseignant.e.s-chercheur.e.s, quelles que soient les dénégations des promoteurs de la disparition de cette instance nationale.
Au moment où les enseignant.e.s-chercheur.e.s et les chercheur.e.s affirment avec force leur attachement à des instances d’évaluation composées majoritairement d’élu.e.s, il n’est sans doute pas anodin que le CNU soit à nouveau la cible de voix marginales. Il n’est sans doute pas anodin non plus que cette nouvelle charge intervienne au moment où se tiennent les sessions de qualification et d’attribution du trop faible nombre de CRCT (Congés pour recherche et conversion thématique) aux enseignant.e.s-chercheur.e.s qui en demandent. Plusieurs éléments de cette mise en cause du CNU sont discutables : les éléments de langage, la mise en cause de la procédure de qualification, les autres missions du CNU passées sous silence (attribution de promotions, de primes et de congés pour recherche) et, le présupposé que le CNU ne protège ni ne garantit le statut de fonctionnaire d’État des enseignant.e.s-chercheur.e.s.
Commençons par les éléments de langage, qui ne sont jamais innocents. On le sait, la langue est malléable et les mots ont un poids dont on ne peut les délester à peu de frais. Ici ou là, on lit que la suppression du CNU serait considérée comme une « hérésie » par beaucoup d’universitaires français. Le choix d’un tel mot ne saurait être totalement le fruit du hasard et en dit long sur la manière dont les détracteurs du CNU considèrent les universitaires. L’hérésie est ce qui s’oppose au dogme et à l’orthodoxie et, dans un sens plus atténué, à l’opinion généralement admise. Affirmer que la suppression du CNU serait vue comme une hérésie revient à suggérer que les défenseurs du CNU se poseraient en censeurs, portés qu