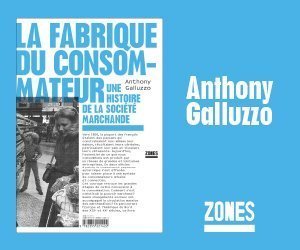État social et sûreté des citoyens
La situation actuelle, avec son effet de sidération, engage à réfléchir en essayant de se parer contre deux risques : la prédiction des meilleures solutions… a posteriori, et son interprétation pour confirmer ce que l’on croyait savoir déjà. Je ne garantis pas par avance de parvenir à y échapper. Je m’essaie, sous le risque de voir invalider ce que je vais dire d’ici quelques jours, à quelques questions et hypothèses, sans prétendre à l’analyse vraie de la situation concrète.
Cette ambition ne peut être que collective. La mise en circulation de textes différents voire divergents en est une condition nécessaire. Il y manque un moment essentiel : celui de la délibération publique, de la mise en œuvre d’une puissance du collectif.
1. Je ne voudrais pas commencer par une considération générale éthique à connotation ontologique sur le « retour de la grande faucheuse oubliée par “notre” civilisation ». La colère, l’indignation, avant la crainte anthropologique de la mort, doivent être comprises en situation historique et sociale ou socio-politique. Je suis donc contraint de raisonner en situation, c’est-à-dire en France en 2020. Un élargissement serait nécessaire : cette crise engage à reprendre ce que « humanité » veut dire en termes d’exigences éthiques et politiques. Je n’ai pas la place de le faire ici.
L’attente ou la demande adressée à l’État aujourd’hui ne peut pas s’interpréter en termes généraux : elle ne porte pas sur le maintien de la vie à tout quel prix, fût-ce à celui de la mort. Il faut la situer dans la réalité sociale et l’expérience collective qui s’est consolidée depuis au moins 70 ans. Pour le dire d’un mot, c’est à un État social ou « national social » (Balibar) que l’opinion s’adresse. C’est son constat de faillite relative qui est dressé.
On ne demande pas à l’État de prendre les « bonnes » décisions à notre place, mais de ne pas nous priver des moyens de les prendre.
Un petit détour historien s’impose. Le schème de la nation moderne s’installe à la fin du XVIIIe siècle comme cadre politique émancipateur, synthétisé par l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Je ne développe pas mais renvoie à tout ce que Balibar a pu dire sur ce principe de l’égaliberté. Il marque le passage d’une société d’ordre dans laquelle chacun est situé par son appartenance sociale ou sa lignée, à une société d’individus répartis en classes dans laquelle chacun est, de droit, un transclasse possible.
Ce schème est hanté par un autre : celui de la lutte des classes qui exprime le réel de la domination et de l’exploitation, et des résistances qu’elles provoquent. Le capital s’empare des vies (pas de toutes : de celles qui peuvent produire de la survaleur), les absorbe et les transforme en profit, soumettant, par là, la quasi totalité des relations sociales à une emprise mortifère. L’histoire et l’actualité nous apprennent comment l’État use des moyens de police (au sens large de la gestion disciplinaire des populations) pour l’y aider. La conjonction du capital et de l’État fabrique « un petit peuple d’hommes-machines » (Michelet), peuple rendu impolitique.
Ce n’est pas par un développement autonome de l’idée de l’État, que l’invention d’un droit du travail, celle des caisses de retraite et la sécurité sociale ont été possibles, mais par la lutte des classes qui ont résisté à l’emprise de mort du capital, à la captation de la vie pour la réduire à une force de production. Les luttes ouvrières expriment ce fait que la « vie humaine [est] une vie qui ne se définit point par la circulation du sang et autres fonctions communes à tous les animaux, mais avant tout par la véritable vie de l’esprit, par la raison et la vertu ». Le tressage de ces deux expériences ou voies de formation d’un peuple se situe peut-être dans ce que l’on a nommé « instruction publique » puis « éducation nationale » dont les enjeux, ces jours-ci, sont éclairants.
Cette histoire a modifié le statut de l’État qui ne peut plus être réduit à un appareil de domination de la bourgeoisie : il devient une instance de compromis, évidemment sensible aux changements dans le rapport des forces sociales donc politiques, qui porte à la fois sur la manière de gérer les règles de partage (ce que Rancière appelle la police) et d’en questionner la légitimité en posant la question de la part des sans-part.
Si l’on se réfère à la Déclaration de 89, l’État a pour fonction de garantir les droits, dont la « sûreté », faute de quoi les citoyens sont légitimés à résister à l’oppression (art. 2). Il n’est donc pas demandé au grand Léviathan d’assurer la sécurité de chacun replié dans son petit confort ou son jardin privé, demande qui nous ferait perdre le sens du risque et nous réduirait au stade de l’animal de troupeau. Discours aristocratique à l’encontre du vulgaire. Il est exigé qu’il assure la « sûreté » des citoyens, c’est-à-dire les conditions de leur liberté, selon l’article 2 de la Déclaration de 89. La première de ses conditions est que la puissance publique n’empiète pas sur la liberté des citoyens, ne les traite que comme des sujets. Sûreté n’est pas sécurité contrairement à ce que donne à croire le discours pervers d’aujourd’hui.
2. Excusez ce détour par trop général, mais je le crois nécessaire pour saisir les demandes adressées à l’État dans la crise sanitaire actuelle et esquisser ce qu’il en est de leur dimension politique éventuelle.
Je n’y vois pas d’abord une demande de sécurité ou de préservation de la vie quel qu’en soit le prix. Ça, c’est la réinterprétation du pouvoir en place. J’y reviendrai. La première des demandes est de conduire une gestion des biens publics qui permette à chacun, 1) de prendre une connaissance rationnelle des risques qu’il encourt en fonction de la position qu’il occupe dans la société ; 2) de lui fournir les moyens existants utiles pour y faire face, en prenant ses responsabilités, à l’égard de lui-même et de la collectivité.
On ne demande pas à l’État de prendre les « bonnes » décisions à notre place, mais de ne pas nous priver des moyens de les prendre, de ne pas empiéter sur la liberté qui est la nôtre. Or, le premier empiètement consiste à ne pas fournir les moyens existants pour faire face à une situation. Pire, d’user d’arguties rhétoriques ou juridiques pour donner à croire que ces moyens n’existent pas, qu’il faut héroïquement faire face à une fatalité, qu’il faut encourager « les héros » qui sont « en première ligne » etc. Ce qui est, au sens propre, « injustice » (Spinoza), négation du droit.
L’affaire des masques, en France, est le paradigme de cette injustice : en liquidant des stocks pour des causes de gestion financière, l’État a renoncé, parce que le rapport de forces social et l’hégémonie idéologique l’y déterminaient, à assurer la sûreté, au premier chef des personnels hospitaliers qui, depuis des mois, se battaient contre le délabrement de ce service public. Ce qui scandalise, ce n’est pas qu’il y ait des morts dus à une épidémie, c’est que les moyens matériels existants pour y faire face aient été rendus indisponibles, que des citoyens aient été rendus vulnérables par faute civique du pouvoir exécutif.
Au moment même où toutes les conditions matérielles pour faire peuple sont impossibles, le pouvoir exécutif surjoue le vocabulaire de la nation moderne.
3. J’ai été frappé d’entendre le président de la République, puis tous les hommes politiques et les journalistes faire un usage inflationniste du nous. Selon deux modes, repérés par Benveniste : exclusif et inclusif. Le premier ressortit au discours martial : « nous sommes en guerre », où le « nous » se définit par opposition à l’ennemi. Mode traditionnel pour réunir un « peuple » en le faisant taire. L’autre est plus intéressant : un nous inclusif qui, toujours énoncé par un je, seul capable de dire « nous », se pense non comme pluralisation mais comme « dilatation » du je : chacun dit « nous » comme si chaque je se reconnaissait similaire à tout autre, ou susceptible de l’être, disant « nous ». Or ce nous est celui qui, politiquement, est rendu possible par le schème de la nation moderne.
Reprenons. Au moment même où toutes les conditions matérielles pour faire peuple sont impossibles, c’est-à-dire où les corps sont empêchés de se rassembler dans l’espace public pour réclamer ou délibérer du bien commun, le pouvoir exécutif surjoue le vocabulaire de la nation moderne. Et ce alors que les premiers acteurs qui doivent affronter les effets de la crise sanitaire éprouvent le retrait pour ne pas dire la démission de l’État dans ses fonctions de sûreté sociale.
Tout se passe comme si le pouvoir exécutif prenait conscience de la nécessité de faire ou refaire peuple politiquement, là où les pratiques du pouvoir ont pour effet la dé-démocratisation (W. Brown), de « défaire le dèmos ». Contradiction qui se perçoit jusque dans le discours et la pratique présidentielle : d’une part il s’en remet aux « experts » d’un comité scientifique hors du contrôle citoyen, et d’abord dans les conditions de nomination de ses membres, et d’autre part engage un dispositif législatif d’exception se préparant à des mesures liberticides pour le moins inquiétantes.
Double contradiction donc. Entre le discours martial et le discours inclusif, ramenant ce dernier au rang de masque du premier qui discipline. Entre le discours inclusif qui veut faire fond sur une allusion au programme du CNR, et les pratiques administratives qui infantilisent les citoyens et les soumettent à l’autorité policière au quotidien, laquelle prend appui sur les définitions imprécises de ce qui relève ou non de la sanction. La contradiction devrait sauter aux yeux quand on entend le très libéral Macron parler de « nos entreprises », comme si elles appartenaient à la nation, alors qu’il n’est pas question de même les réquisitionner pour faire face aux nécessités du moment, ou de distribuer gratuitement ou de taxer certains prix comme ceux des masques qui sont obligatoires.
Qui est donc le « nous » qui possède les entreprises ? La question ne sera pas posée… Le sommet dans le genre « rôle à contremploi » se trouve (pour le moment) dans la vidéo postée sur Twitter dans laquelle le président de la République explique, navré, qu’il sera impossible cette année de « fêter comme nous le faisions, la journée internationale des travailleurs ». Vous souvient-il d’avoir croisé Macron sous une banderole (peu importe laquelle) d’une manifestation syndicale un 1er mai ? Le nous inclut-il un certain Benalla dont la rumeur dit qu’il a manifesté, au moins une fois, le 1er mai ?
4. Comment pouvons-nous tenter de former un nous dans cette situation ? Sur quoi faire fond ?
Il est clair que cette exigence éthique et politique ne se soumet pas au décret ou à la rhétorique de communication. Quel nous, c’est-à-dire quel « peuple » est appelé par l’exigence émancipatrice dans la situation actuelle ? Mon postulat négatif : pas un peuple configuré sur un mode martial, surtout si « l’ennemi » est invisible. Sa contrepartie est terrifiante : elle engage à débusquer les infiltrés, les mauvais soldats, les ennemis de l’intérieur, tous ceux qui ne veulent pas jouer au petit jeu de la « Patrie en danger » et qui passant à travers les mailles du dépistage, se déconfinent sauvagement et « mettent la vie d’autrui en danger ».
Ils seront bientôt traqués par les brigades de santé publique, dénoncés par leurs voisins, suspectés sous leur masque (rappelez-vous : il n’y a pas si longtemps il était considéré comme atteinte aux principes et valeurs républicaines de se promener dans la rue avec un visage voilé…). Nous ne sommes plus dans le monde des Furtifs d’Alain Damasio, mais dans un possible projet de loi du gouvernement Philippe. Sans parler du traçage de malades ou soupçonnés tels.
Il est clair qu’au niveau éthique il nous faut nous appuyer, chacun pour chacun, sur les Stoïciens, Épicure ou Spinoza : « L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort ». La crainte de la mort est, c’est certain, le ressort affectif de toutes les soumissions, et d’abord de la superstition qui conduit à surveiller le vol des oiseaux… ou à boire de l’eau de javel pour désinfecter ses poumons. L’éthique par laquelle nous nous efforçons de nous libérer de l’imaginaire de la mort conduit chacun à prendre les mesures pour ne pas être l’objet de décisions hétéronomes. Cela ne suffit pas : socialement et politiquement, il est impossible d’attendre que tout le monde soit sage…
Il faut, je crois, faire fond sur les expériences de politisation de situations similaires. De ce point de vue, ce que les mouvements associatifs de lutte pour obtenir les thérapies contre l’infection du VIH apprennent, est riche d’enseignement. L’association AIDES a mis en ligne un manifeste éclairant. Je cite son préambule qui prend une orientation opposée à celle engagée par le gouvernement français :
« Chaque individu est capable de prendre soin de sa santé et de celles de ses proches et de sa communauté. L’enjeu n’est pas de dicter des comportements standards uniques, mais de donner à tous et à toutes une information claire, transparente et compréhensible qui permettra à chacun·e d’agir selon sa situation. Cela suppose qu’ils-elles aient accès aux moyens de prévention, adaptés à leurs comportement et besoins, sans que ne soit juger leurs choix et pratiques individuels. Il faut mettre l’accent sur la prévention et accompagner les citoyens·nes au mieux pour qu’ils-elles aient les moyens de faire face aux risques liés à la transmission du Covid-19 pour lui-elle et ses proches. Cette logique présente un intérêt tant à l’échelle individuelle que collective, puisqu’elle permet de mobiliser la population toute entière. »
C’est à la fois dans la mise à disposition par l’État social des moyens de la sûreté sanitaire des citoyens et par la liberté de chacun, c’est-à-dire l’exercice de la participation des individus singuliers à la puissance collective, que la communauté peut s’émanciper de la crainte de la maladie et de la mort et de celle d’un État orienté à la répression des déviants : « La lutte contre le VIH-sida a pu avancer en considérant les citoyens·nes comme des personnes responsables, capables de comprendre les informations et de saisir des enjeux sanitaires. »
Utopie ? Chiche !