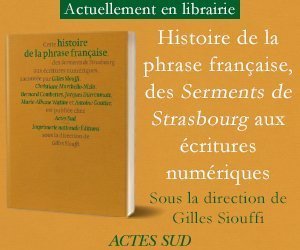Hyperréalité du bouffon – Trump et l’élection de 2020
Il y a quatre ans la victoire de Donald Trump à l’élection avait constitué un « traumatisme » pour l’ensemble des acteurs et des observateurs de la vie politique américaine. Ce n’était pas seulement une défaite électorale démocrate, mais une sorte de catastrophe symbolique qui prenait en défaut tous les systèmes de prévision et d’alerte et ruinait la crédibilité des analystes et des commentateurs.
C’était pour beaucoup de démocrates une anomalie politique, un événement extravagant qui échappait à toute logique à leurs yeux. À la Maison Blanche, le soir du 9 novembre le résultat des élections laissa sans voix Obama et ses storytellers. « C’était aussi inconcevable que l’abrogation d’une loi de la nature » dira l’un d’eux et Obama déclara : « L’histoire ne va pas en ligne droite, elle fait des zigzags. »
Dix fois cent fois on avait parié sur l’élimination de Trump au cours des primaires, puis sur sa défaite face à Hillary Clinton, et il avait surmonté tous les obstacles… Il avait lancé un défi aux médias, à leurs récits de campagne, déniant leur agenda et leur rhétorique, bousculant l’image qu’on pouvait avoir d’un président, imposant ses outrances, sa rhétorique enfantine, son langage onomatopéique et ses mensonges…
« L’une des choses les plus déconcertantes était que personne, quel que soit son degré d’érudition, n’avait une idée de ce qui se passait » se souvenait, un an après l’élection de Trump, Michelle Goldberg dans un article du New York Times, intitulé « Anniversaire de l’Apocalypse ». Dans son désarroi, elle s’était alors tournée vers des journalistes qui vivaient ou avaient vécu sous un régime autoritaire « pour tenter de comprendre comment la texture de la vie change lorsqu’un démagogue autocrate prend le pouvoir. »
Un journaliste turc laïc lui avait dit d’une voix triste et fatiguée, que les gens pouvaient défiler dans les rues pour s’opposer à Trump, mais que les protestations finiraient probablement par s’éteindre et « le sentiment d’une stupeur d’urgence céderait la place à une opposition soutenue ». L’écrivaine dissidente russe Masha Gessen avertissait qu’il était impossible, avec un dirigeant qui assiège le tissu de la réalité, de garder le sens de ce qui est normal. « Vous dérivez, et vous êtes déformé ». Ils avaient tous les deux raison », concluait Michelle Goldberg.
L’événement n’entrait dans aucun récit disponible. Ce n’était pas seulement une surprise électorale, c’était un défi à tous les récits possibles.
« Ma vie a été bouleversée par son élection, c’est un cauchemar national », expliquait Carter Goodrich, l’auteur de la une du New Yorker qui caricaturait Trump en clown maléfique. « Je suis toujours aussi abasourdi maintenant qu’il y a un an, la nuit des élections. » Et il ajoutait “C’est difficile de parodier cet homme… Il marche, parle déjà comme une caricature de lui-même”.
Après la crise de 2008, le décrochage des récits officiels par rapport à l’expérience des hommes a ruiné la crédibilité de tous les récits officiels.
Depuis son élection, Trump loin de se présidentialiser pour devenir le président de tous les américains, n’a pas cessé de multiplier les provocations, signant des décrets grotesques, utilisant twitter comme le canal officiel de sa communication : Muslim ban, défense des suprémacistes blancs après les événements de Charlottesville, guerre de tweets avec la Corée du Nord, tentative de criminalisation du mouvement de protestation qui a suivi le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par la police…
Le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel écrivait avant la Première Guerre mondiale : « Inutile de solliciter les masses dans leur opinion positive ou dans leur volonté critique, car elles n’en ont pas : elles n’ont qu’une puissance indifférenciée, une puissance de rejet. Elles ne sont fortes que de ce qu’elles expulsent, de ce qu’elles nient. » Jamais ce diagnostic n’a été aussi vraie que depuis la crise de 2008.
La crise de 2008 n’est pas seulement une crise financière, c’est une crise de narration. Elle a fait éclater la bulle financière mais aussi la bulle du storytelling et ses récits utiles. Le décrochage des récits officiels par rapport à l’expérience des hommes, a ruiné la crédibilité de tous les récits officiels. Dès lors les gouvernements vont devoir gérer et contrôler une opinion rétive, qui se détourne du grand récit néolibéral. L’accélération des échanges sur les réseaux sociaux crée les conditions et l’environnement nécessaire d’une véritable guerrilla des récits, une agonistique fondée sur la provocation, la transgression, la surenchère bref une culture du clash. S’ouvre alors une ère politique nouvelle, une ère de défiance et de discrédit.
Trump a parfaitement compris ce qu’il pouvait tirer de l’énergétique politique du discrédit. Pendant sa campagne en 2016 il s’est adressé, via Twitter et Facebook a cette partie de la société qui a fait sécession aux États Unis et il a réussi à fédérer en une masse survoltée ces mécontentements dispersés. Et il l’a fait en utilisant les recettes de la télé-réalité – transgression, outrance – car seule la télé-réalité satisfait ce besoin de représentation, bien connu des cliniciens, qui se nourrit de l’impuissance à vivre ; un besoin de représentation que Donald Trump capte et transforme en un capital politique. La télé-réalité s’était jusque-là cantonnée au divertissement. Donald Trump en a fait un instrument de conquête du pouvoir et de son exercice. Il a redonné pour ainsi dire du crédit aux dicrédités.
Trump, c’est la banque centrale de toutes les colères. Il les concentre, les accumule, les estampille. Il émet les signes du ressentiment. Il n’y a pas de contrepartie à cette création monétaire qui repose non pas sur le crédit mais sur le discrédit. Mais le mécanisme est le même que celui de la création monétaire : pour le dire simplement, on fait marcher la planche à billets. Un mensonge efface l’autre. Un tweet gomme le suivant, dans un interminable thread sur lequel aucun fact checking n’a de prise. Ce qui soude la masse de ses supporters, c’est le pouvoir de dire non aux « vérités » établies. L’incrédulité est érigée en croyance absolue. Aucune autorité n’est épargnée, ni politiques, ni médias, ni intellectuels ni chercheurs. Tous sont voués au bûcher trumpiste.
Trump a orchestré le ressentiment des foules, réveillé les vieux démons sexistes et xénophobes, donné un visage et une voix, une visibilité, à une Amérique déclassée tout autant par la démographie et la sociologie que par la crise économique. Il a libéré une puissance sauvage et indistincte qui n’attendait que de se donner libre cours. Et il l’a fait à sa manière, cynique et caricaturale. Il s’est jeté sur les foules en colère et il les a excitées. Il a fait de la haine une bannière et de la colère une marque à son nom.
Avec Trump il ne s’agit plus de gouverner à l’intérieur du cadre démocratique, selon ses lois, ses normes, ses rituels, mais de spéculer à la baisse sur son discrédit.
Le reality show trumpiste rejoue, en le singeant, le renversement du haut et du bas, du noble et du trivial, du raffiné et du grossier, du sacré et du profane, le refus des normes et des hiérarchies instituées entre le pouvoir et les sans-pouvoir, le mépris des formes du beau style du savoir-vivre, au profit d’une vulgarité revendiquée, assumée et conquérante. Il relève d’une forme de carnavalesque renversé, un carnavalesque d’en haut qui installe les valeurs du grotesque au sommet du pouvoir et assoit leur légitimité sur les réseaux sociaux et la téléréalité.
Avec Trump il ne s’agit plus de gouverner à l’intérieur du cadre démocratique, selon ses lois, ses normes, ses rituels, mais de spéculer à la baisse sur son discrédit. Son pari paradoxal consiste à asseoir la crédibilité de son « discours » sur le discrédit du « système », à spéculer à la baisse sur le discrédit général et à en aggraver les effets. Le caractère bouffonesque de son pouvoir sur les foules n’est pas le signe d’un mauvais leadership. C’est la forme d’un leadership infame, basé sur le discrédit.
« La souveraineté grotesque analysait Foucault dans son cours au Collège de France (Les Anormaux 1974/5) n’est pas un accident dans l’histoire du pouvoir, ce n’est pas un raté de la mécanique. Il me semble que c’est l’un des rouages qui font partie inhérente des mécanismes du pouvoir (…) un coin qui est manifestement, explicitement, volontairement disqualifié par l’odieux, l’infâme ou le ridicule. (…) dans sa personne, dans son personnage, dans sa réalité physique, dans son costume, dans son geste, dans son corps, dans sa sexualité, dans sa manière d’être, un personnage infâme, grotesque, ridicule. (…)Le grotesque, c’est l’un des procédés essentiels à la souveraineté arbitraire. » Ainsi, Trump prétend-il que la Constitution américaine lui permet de faire « tout ce qu’il veut ».
Ce fonctionnement du souverain grotesque est renforcé aujourd’hui par la puissance des réseaux sociaux, l’usage stratégique du Big Data et des algorithmes. Partout où elle a réussi à s’imposer, la tyrannie des bouffons combine le pouvoir grotesque et la maîtrise méthodique des réseaux sociaux, la transgression burlesque et la loi des séries algorithmiques.
La pandémie de coronavirus, loin d’atténuer ses outrances en a été le théâtre burlesque. Le ridicule ne connut pas de limites, des postures viriles jusqu’aux formes les plus archaïques de sorcellerie et de pensée magique, un festival de pitreries et de provocations. Dans la pandémie, les traits du personnage de série télé – sa malhonnêteté, son narcissisme, son insouciance – se sont pleinement manifestés dans une sorte de parousie du joker. La gestion burlesque de l’épidémie a conduit le clown du cirque à l’hôpital. Dans sa chambre qui ressemblait à un plateau de TV réalité, Trump jouait la scène finale de sa présidence en s’efforçant de tromper la mort. Il redoubla de sarcasmes, se moquant des consignes de sécurité, faisant mine d’écrire sur une page blanche. Il alla même jusqu’à faire un tour de piste sans autre raison que de saluer ses partisans. Ce n’était pas seulement une mise en scène de télé-réalité mais une mise en abyme de la pandémie qui avait fait déjà 200 000 morts.
Cet épisode fut l’aboutissement grotesque des noces du virus et du reality show. Loin de disqualifier Trump, sa gestion catastrophique de la crise sanitaire a consolidé la base de ses soutiens et surtout lu a permis de manifester une sorte d’impunité, d’arbitraire, la preuve qu’il ne dépend d’aucun jugement politique, scientifique ou moral, et peut donc imposer inconditionnellement sa volonté. «Je me sens si puissant bouffonnait-il après son hospitalisation. Je pourrais marcher dans la foule. J’embrasserais les gars et les jolies filles. Je vous ferais un bon gros bisou.»
Tant que les ressorts de ce pouvoir grotesque ne seront pas analysés et combattus nous serons condamnées à le voir se multiplier sous des formes toujours plus perverses et autoritaires.
Devant cette allure carnavalesque du pouvoir trumpien, l’attitude adoptée depuis 2016 est celle de la sidération : comment est-il possible qu’il ait été élu et qu’il puisse rester au pouvoir ? C’est la question inverse qu’il faut se poser. Quelle est la mécanique qui fait du trumpisme non pas un accident dans l’histoire politique mais un rouage essentiel de la souveraineté arbitraire à l’ère du discrédit de toutes les formes d’autorités ? Le pouvoir grotesque, c’est la continuation de la politique discréditée par d’autres moyens. Comment incarner un pouvoir politique basé sur le discrédit, sinon en mettant en scène un pouvoir sans limite, débridé, qui déborde les attributs et les rituels ?
Trump est l’incarnation d’une série de paradoxes terminaux qui minent les démocraties occidentales : le pouvoir grotesque assoit sa légitimité “non pas sur le crédit qu’inspire la personnalité politique ou son programme et que consacre l’élection, mais sur le discrédit qui frappe le système politique.”
Les « libéraux » n’ont guère su opposer à chaque provocation de Trump que leur indignation morale, qui est toujours un signe d’aveuglement face à un phénomène politique inédit. Ils peuvent bien rouvrir les yeux, maintenant : le phénomène Trump n’a pas disparu. Il bénéficie du soutien de la frange la plus mobilisée de ses électeurs qu’il semble avoir élargie en 2020.
Tant que les ressorts de ce pouvoir grotesque ne seront pas analysés et combattus nous serons condamnées à le voir se multiplier sous des formes toujours plus perverses et autoritaires : un fascisme à visage bouffon.
Trump excelle à jouer les héros négatifs. Il comprend d’instinct la logique narrative des campagnes électorales, sur fond de discrédit des hommes politiques. Hitchcock disait : « Meilleur est le méchant, meilleure est l’histoire. »
Dans un de ses spots de campagne en décembre 2019, le président américain n’incarnait-il pas Thanos, le grand méchant de l’univers Marvel ? Celui qui déclare à Iron Man : « Je suis inévitable »…
NDLR : Christian Salmon vient de publier La tyrannie des bouffons aux éditions Les Liens qui Libèrent