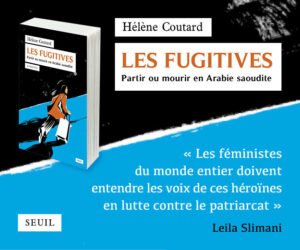Éducation prioritaire : le renoncement
L’éducation prioritaire française pourrait sembler s’inscrire dans une volonté politique unique dite de discrimination positive, celle que résumerait la formule « donner plus à ceux qui ont moins ». Mais une telle formule s’avère des plus ambiguës tant dans les finalités qu’elle ambitionne que dans les réalités qu’elle met en œuvre. Dresser le bilan de l’éducation prioritaire ne peut donc procéder d’un jugement unique qui présumerait une continuité politique depuis 1981.
Récemment annoncée par Nathalie Elimas, secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire, la nécessité d’un changement de modèle n’a rien d’une volonté pragmatique fondée sur l’évaluation d’un espoir déçu. Elle s’inscrit dans des perspectives idéologiques qui, au-delà des affirmations rassurantes de leurs discours, sont loin de faire le choix de l’égalité de la réussite scolaire et constituent un renoncement aux idéaux de démocratisation des savoirs.
Avant de questionner les finalités, il faut remettre à sa juste place l’investissement budgétaire concédé aux écoles de l’éducation prioritaire. Le discours commun semble accréditer l’idée d’une grande générosité, parfois même d’une abondance qui reléguerait les autres territoires à la privation ! La réalité est tout autre.
Plusieurs études ont montré que les financements consacrés aux collèges de l’éducation prioritaire n’étaient pas supérieurs à ceux des autres collèges. La Cour des comptes, elle-même, notait en 2012 « une absence de corrélation entre les difficultés scolaires constatées sur le terrain et les moyens d’enseignement alloués » et observait que, parfois, « des établissements confrontés à un échec scolaire important peuvent être moins bien dotés que des établissements qui ont des taux de réussite plus élevés ».
Un élève parisien, qu’il soit à l’école primaire, au collège ou au lycée coûte plus cher qu’un élève de banlieue. Et les périodes de non-remplacement des enseignants en congé maladie sont plus longues et plus fréque