Brésil : notes d’un retour au pays de la faim
L’affreuse inanité de notre raison d’être, comme disait Aimé Césaire, définit l’esprit vide, l’inanitas de l’esprit qui ne cesse de vider nos corps. Vide comme la terre vidée, le creux de l’estomac, le gouffre du corps et encore, le gouffre insondable de la face, comme l’aurait dit Antonin Artaud ; ce gouffre-corps, le gouffre encore. Gouffre qui traverse ces notes d’un retour – retour au pays natal, retour du pays natal à l’état de la famine, retour à cette espèce de scène primordiale d’un pays conçu pour être un immense territoire des dépenses extrêmes.
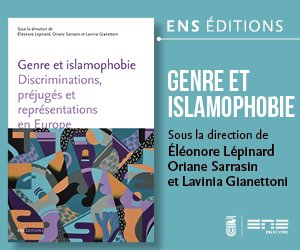
La faim est aussi une de ces dépenses. Pour qu’il y ait de la faim, il faut toujours ceux qui mangent trop, même sans appétit. L’extrême de la faim trace la face insondable du gouffre de « l’humanité » enfin révélée.
Le retour nous impose aussi de regarder en face. Le creux devient donc une surface. Regarder en face, c’est être prêt à voir la fin tracée comme le commencement des évènements passés.
J’ai choisi de regarder en face la fin des deux grands penseurs de la faim au Brésil : Josué de Castro et Glauber Rocha. Que ces notes d’un retour à la famine du pays natal soient l’hommage à ceux qui, avant moi, n’ont pas eu peur de regarder le creux en face – dans la face du creux.
Il s’agit donc du début de la fin. La fin de deux trajectoires de vie. La fin d’une époque aussi. La fin comme principe organisateur de la répétition d’une scène, celle du retour. Dans ce cas le retour de la faim sur leur pays natal. Plus loin encore : la fin comme principe qui tire le fil, poussant les limites d’un pays natal ; pourrait-on dire : la fin qui tisse un pays natal comme le devenir – pour emprunter le terme de l’écrivain Édouard Glissant – d’un Tout-Monde ?
Comme il s’agit de plusieurs fins sur la trace de ce retour, il importera de revisiter l’écriture de l’unique roman – et dernier texte – écrit par Josué de Castro. Après avoir dû quitter le poste d’ambassadeur en chef de la délégation du Brésil à l’ONU, auquel il avait été désigné en 1962 par le président d’alors, João Goulart, et lorsque ses droits furent révoqués le 9 avril 1964, Josué, interdit de revenir au Brésil, s’exile à Paris et écrit en 1965 le livre intitulé Homens e Caranguejos [1]. Les interrogations de l’auteur sur le livre l’annoncent ainsi :
« Mais ce livre est-il vraiment un roman ? Ou est-il bien plus un livre de mémoire ? Peut-être, sous certains aspects, une autobiographie ? Je ne sais pas. (…) Le thème de ce livre est la découverte de la faim lors de mes années d’enfance, dans les marais de la ville de Recife (…). Le phénomène s’est révélé spontanément à mes yeux dans les mangroves du Capibaribe, dans les quartiers misérables de la ville de Recife. (…) Voilà ce que fut ma Sorbonne : la bourbe des palétuviers de Recife bouillonnante de crabes et peuplée d’êtres humains faits de chair de crabes, pensant et sentant comme crabe. Êtres amphibiens – habitants de la terre et de l’eau, moitié homme et moitié bête. »
L’hybridité du genre (roman, autobiographie et mémoire) se sera laissé marquer par l’hybridité de ces corps de la faim, moitié homme, moitié bête. Le rapport littéraire finit par laisser entrevoir, au sein de la mélancolie propre à l’auteur, une manière distincte de montrer ce que son discours de la faim, alors qu’il était homme public, cherchait à consolider.
Une matière boueuse qui subsiste dans le texte, un mélange entre la bourbe du palétuvier et la bave verte que salivait la bouche de la faim et qui ne cache pas les racines mélancoliques de la bile humaine, de cet intérieur distordu et noir, vomi comme frange inhumaine de l’idée même de l’humanité.
N’oublions pas que ni Josué ni Glauber n’ont manqué, dans leurs années d’exil, de continuer d’une manière ou d’une autre à combattre la faim dans le monde.
Une vraie critique de la connaissance en tant que produit de la société civilisée, représentée par la Sorbonne citée ci-dessus, se laisse entrevoir chez cet humaniste ici défiguré par la faim de son pays, par son pays en famine et sa condition d’ordonnance et d’exil forcé.
L’exil de Glauber le cinéaste semble avoir été encore plus radical. Dans une interview à son confrère portugais Manuel Carvalheiro, publiée postérieurement en 1981 dans le Jornal do Brasil, nous lisons : « Tu as sauvé ma vie. Si je n’étais pas venu au Portugal, je serais mort à Paris. » Le cinéaste portugais ne prend pas au sérieux la constatation dramatique de Glauber. Cela doit être de l’exagération. Mais Glauber commence à tousser et, avant même d’arriver à Sintra, près de Lisbonne, demande qu’on lui prête un mouchoir – et tousse du sang.
Toujours dans cette interview, Glauber déclare : « Maintenant, je suis occupé à déflagrer un processus culturel que j’appelle de révolution atlantique – qui se développera par la recherche des racines esthétiques d’un monde nouveau, en séparant le problème politique du problème esthétique et en expliquant clairement que la fonction politique de l’esthétique est l’éducation spirituelle. »
Quelle relation existerait entre la révolution spirituelle, dont Josué de Castro a parlé à plusieurs reprises, et l’éducation spirituelle de Glauber Rocha ? Mais encore : quelle relation subsisterait entre une culture de la faim et une éducation spirituelle ? Nous ne sommes peut-être pas loin de l’idée d’un esprit de catéchisation des peuples originaires des Amériques ainsi que de l’emprise de l’esclavage du peuple noir. L’esprit vidant les corps dorénavant dit « non-civilisés » et affamés.
À propos de l’esthétique de la faim, Glauber déclare, dans cette même interview, de manière catégorique et tragique : « Cela fait cinq jours que je ne mange pas. Cela fait cinq jours que je vomis. Je ne suis pas loin de l’Esthétique de la Faim. » Il ne serait pas loin non plus de cette bile noire que nous évoquions à propos de Josué et de ses hommes-crabes.
Cependant, n’oublions pas que ni Josué ni Glauber n’ont manqué, dans leurs années d’exil, de continuer d’une manière ou d’une autre à combattre la faim dans le monde. La trajectoire de Josué a d’ailleurs suivi cette voie puisqu’il a continué à écrire, à publier et à organiser d’innombrables conférences sur la faim, ayant même été pressenti pour le Prix Nobel de la Paix en 1970. Glauber, selon lui-même, aurait dépassé sa phase volcanique, se penchant sur des recherches esthétiques et littéraires et cherchant ce qu’il dit être, toujours dans cette interview, « la spécificité littéraire ».
En un certain sens, les différences s’accentuent entre ces deux penseurs de la faim. Le discours rationnel semble continuer à faire les bases des initiatives de Josué de Castro tandis que Glauber Rocha est chaque fois plus préoccupé par des forces irrationnelles et inconscientes qui seraient apparues déjà dans le texte de 1971, A Estética do Sonho (« L’Esthétique du Rêve »), texte qui revisite les préceptes de l’Estética da Fome – (« L’Esthétique de la faim » ou L’Esthétique de la violence), et qui assument le premier plan.
Comme disaient les prophètes de la faim, la fin viendra – ou est-elle déjà et toujours là ?
Cependant, presque de manière subreptice, ces deux exilés se tournent vers la « spécificité littéraire ». Du statut de penseurs de la faim, ils se rapprochent davantage, en œuvrant la tâche particulière du littéraire, d’un statut de prophètes de la faim. Abandonnant, momentanément chez Josué et radicalement chez Glauber, la logique en chaîne du langage, la rationalité qui la soutient, les bases qui la configurent mais aussi qui nous enferment dans le modèle toujours hégémonique de l’Occident.
De toute façon, la ressemblance résiderait, dans l’un et l’autre cas, dans le retour au pays natal. Ces deux corps, à presque dix années d’intervalle, reviennent au Brésil pour y mourir ou y être enterrés.
Malgré les différences claires qui semblent avoir fondé de manières très distinctes la prudence révolutionnaire de Josué de Castro, homme qui a investi pleinement la figure de l’État, et la verve volcanique de Glauber Rocha, qui a cherché ardemment la formulation d’une esthétique proprement « tiers-mondiste » et l’investissement d’une imagerie des corps de la faim en rébellion, tout cela rappelle que la fin d’une époque a marqué durement la fin de ces deux penseurs de la faim.
De la même façon, elle se présente et se marque aujourd’hui pour ceux qui survivent dans un retour toujours inachevé au pays natal, au point de les mettre en quête d’une spécificité littéraire qui doit finir à son tour par problématiser les relations, auparavant plus claires, entre la faim et la fin.
Chez Glauber, l’effet est celui de l’incarnation de sa propre esthétique de la faim, puis de la fin de sa propre vie. Mort sans avoir pu manger cinq jours durant, artiste pauvre d’une Europe révolutionnaire, Glauber cherche des sorties spirituelles pour une question auparavant concrète.
Josué, en exil à Paris, se met à perdre sa verve diplomatique d’homme d’État et se rend à cette espèce hybride de mémoire fictionnelle pour questionner la légitimité du savoir qui pourtant l’accueille, « le vieux monde de la Sorbonne ». Son texte navigue entre une mémoire orale, celle des histoires du peuple illettré du Nordeste, et l’impact d’une mémoire visuelle de la faim, dans sa force de défiguration de l’humanité de l’homme – l’homme-crabe.
Mais ainsi, quelle vision prophétique de la faim émergerait de cette fin littéraire ? De quelle façon cette fin appauvrie de l’un et de l’autre marquerait aussi la fin et le fracas d’une idée du Monde, d’un Tout-Monde ? Quel fil cette fin nous oblige-t-elle aujourd’hui à reprendre ?
Ces questions tourmentent celui qui, encore aujourd’hui, se rapproche du désir d’un Tout-Monde, celui qui se rapproche de la certitude que le retour au pays natal n’existe qu’en sachant qu’il n’est pas le territoire d’un seul pays, mais le fulgurant dessin, esquissé dans un cahier perdu, de la fin d’un Monde. La fin s’approche lorsque, à partir d’un moment donné, une grande partie de l’humanité rencontre sa propre faim.
Le retour de la faim, comme un point extrême de la faillite d’un pays, s’annonce comme un virus, sa propagation est scandaleuse mais aussi inévitable. Comme disaient les prophètes de la faim, la fin viendra – ou est-elle déjà et toujours là : « une faim ensevelie au plus profond de la Faim de ce morne famélique » – ou encore : « au bout du petit matin, l’échouage hétéroclite, les puanteurs exacerbées de la corruption, les sodomies monstrueuses (…), les avidités, les hystéries, la perversion, les arlequinades de la misère », comme l’écrivait Césaire.
Je ne pourrai pas revenir aux notes du retour de la faim dans mon pays natal sans avoir mis dans la valise Le Cahier d’un retour au pays natal, sans y savoir que nos propres corps sont maintenant encore offerts à vos faims, à l’indépassable et impitoyable voracité de ce qui est devenu l’insondable gouffre de la face en creux d’un Tout-Monde.
