La dramaturgie « populiste » et ses impasses
Le « populisme » continue de hanter les commentaires politiques, la plupart du temps comme un terme péjoratif disqualifiant celui à qui on l’impute. Des travaux récents[1] engagent à distinguer le populisme, concept de la théorie politique, du « populisme », catégorie de la médiarchie[2].
Le premier est un concept de la politique de la seconde modernité, formé à partir des expériences historiques reconnues par la communauté scientifique ou auto-qualifiées de populistes : il désigne des mouvements démocratiques, interclassistes, proches du courant socialiste, qui imputent la crise sociale, dans laquelle ils voient le jour, à un déficit de démocratie, et prônent l’avènement d’une démocratie effective, contre la dépossession du pouvoir du peuple par ceux qui sont censés le représenter. Historiquement, le populisme ne peut être que de gauche, inutile de le préciser.
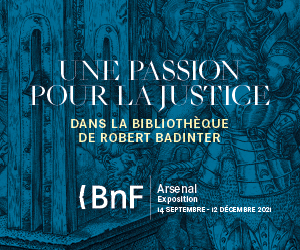
La seconde acception procède de la médiarchie qui met en scène des manières de la politique, contribuant ainsi non pas à la compréhension d’une situation concrète, mais à sa configuration : à la différence d’une analyse théorique qui cherche à rendre compte objectivement d’un état des choses, elle vise à orienter les esprits, donc les affects, dans une direction déterminée.
Il y a solution de continuité de l’un à l’autre, mais certains thèmes du premier peuvent, malgré tout, passer dans la seconde. Les hypothèses que je formule ici ne concernent que le « populisme » dans sa version de gauche : dans la sphère médiarchique le « populisme » peut être capté par un ethno-nationalisme qui prétend parler « au nom du peuple ».
Populisme et nationalisme
Comment rendre raison de cette catégorie dans la conjoncture qui peut expliquer son usage pour nommer une stratégie politique ?
Le « populisme », mais c’est vrai aussi du nationalisme, se déploie sur fond de deux éléments qui se conjuguent.
D’une part, le sentiment d’un affaiblissement de la puissance nationale qui peut être éprouvé sur le mode d’une blessure portée au sentiment de fierté nationale, quelque chose comme : « la nation que nous sommes n’est plus à la hauteur de la grande nation que nous avons été ».
Le terrain de cette situation, fécondé depuis plus de trente ans, est repris sous ce que Balibar a nommé « l’impuissance du tout-puissant »[3], pour réfléchir aux contradictions contemporaines entre l’affirmation de la souveraineté nationale, la globalisation capitaliste, avec ses effets de délocalisation industrielle des entreprises européennes, l’inscription des États dans le jeu de la compétition internationale, y compris sur le terrain de ce qui est nommé « lutte contre le terrorisme », la crise écologique terrestre, et la construction européenne, elle-même affectée par la globalisation.
D’autre part, cet affaiblissement national est imputé à l’accaparement du pouvoir par les élites, c’est-à-dire à un déficit de démocratie. D’où l’opposition peuple/élites, nous/eux qui constitue la colonne vertébrale idéologique du « populisme ». Federico Tarragoni a montré dans L’esprit démocratique du populisme que l’on ne devait pas l’entendre comme opposition entre des personnes ou des groupes sociaux figés et empiriquement décrits, mais entre des « forces de la modernité démocratique » : celle qui pousse à la démocratisation de la démocratie soutenant l’exigence de participation effective des couches populaires aux décisions, et celle qui, à l’opposé, tend à la rationalité technique, à la gestion des flux et à la normalisation bureaucratique et qui œuvre à la dé-démocratisation de la société.
Je prends le concept de « nation » au sens que lui a donné Ernst Gellner[4], non en son sens étymologique qui renvoie à une communauté de naissance partageant des traditions ou une culture communes. Elle se caractérise socialement par opposition à une société de corps : elle est divisée en classes et fractions de classes, société de l’ère industrielle dans laquelle la circulation des informations est nécessaire, et la circulation sociale des individus de droit, même si cette promesse est posée comme horizon à réaliser par l’éducation généralisée. Politiquement, elle est société d’individus, de citoyens-nationaux qui s’accordent sur la représentation souveraine.
En se fondant sur ce concept de nation, on peut soutenir que le populisme est un nationalisme.
La nation est aussi cette forme politique qui voit naître et se développer la presse, et se former autour de la lecture des journaux, un public[5]. Elle ouvre une nouvelle scène politique sur laquelle des acteurs représentent les forces qui visent l’adhésion du public, adhésion qui se marque par les suffrages que le public donne aux figures par lesquelles il imagine être représenté : la représentation-spectacle se conjugue avec la représentation-délégation.
Dramaturgies politiques nationales
Sur cette scène les acteurs se déplacent selon des schémas, des dramaturgies[6] qui rendent sensibles et intelligibles pour le public leurs discours et leurs gestes. Une dramaturgie réalise la figuration ou l’incarnation de rôles qui apparaissent au public comme représentatifs des manières d’agir politiquement et, par-là, contribuent à configurer une multitude ou une masse par reconnaissance ou identification affective, en la distinguant voire en l’opposant à d’autres possibles.
Cette figuration dramaturgique a pour effet une intensification des affects unifiant ainsi une masse en un peuple, de façon telle qu’un peuple, à l’époque moderne, se pose toujours contre un autre peuple[7], une autre manière de faire peuple.
Je peux distinguer au moins trois dramaturgies modernes (auxquelles il faudrait ajouter une dramaturgie conservatrice ou réactionnaire dont l’acteur le plus bruyant aujourd’hui serait Éric Zemmour).
La première est la dramaturgie libérale (ici je prends le terme au sens large, sans distinguer les différents modes de libéralisme ) : le peuple y est défini comme corps des électeurs, individus s’accordant sur la nécessité d’un représentant, s’unifiant par la reconnaissance du représentant légal, souverain qui prend la loi commune. Dans sa forme contemporaine, la figure du représentant soutient que chacune est responsable pour le tout, en même temps qu’il est en compétition avec ses semblables. Ni la domination, ni l’exploitation n’y ont place : chacun se doit d’adopter des comportements responsables pour briser les carcans, notamment bureaucratiques, qui entravent le développement économique et social.
La difficulté à laquelle se heurte cette dramaturgie tient à l’impuissance du souverain, d’autant plus patente qu’il est personnalisé dans la figure du chef de l’exécutif. Son paradigme, que j’appellerais volontiers dramaturgie « Yves Montand »[8], paraît usé sous les effets conjugués du cynisme des dominants et de l’impuissance du souverain.
La seconde est la dramaturgie « lutte des classes ». Dans une filiation principalement marxiste, « peuple » y est dénoncé comme une catégorie idéologique qui sert de masque à la préservation des intérêts bourgeois, le prolétariat devant s’affirmer dans son autonomie afin de révolutionner les rapports de production. La figure qui l’incarne est celle de l’ouvrier qui accède à la compréhension des causes de sa situation, c’est-à-dire la figure du militant ouvrier unissant théorie et pratique politique. Pour rester vintage, on pourrait parler de dramaturgie « Georges Marchais ». Cette figure est devenue fantomatique.
La difficulté qu’elle enveloppe tient à la fois à la question de savoir s’il y a une classe universelle, et si l’exploitation capitaliste concentre en elle la totalité des dominations sociales.
Sous l’effet de l’effondrement du communisme d’État, et de la démultiplication des conflits portant sur les dominations de genre et de race, les conflits sociaux, conflits qui mettent en cause la structure sociale comme telle, qui engagent une modification plus ou moins radicale de la règle de partage, sont concurrencés par des conflits identitaires revendiquant reconnaissance d’une minorité.
Enfin, la dramaturgie « populiste ». La crise de ces deux dramaturgies, en conjonction avec celle de la représentation politique, indûment nommée dans les médias « crise de la démocratie », ouvre l’espace à une autre dramaturgie sur la scène médiatico-politique, la dramaturgie « populiste ». De là le retour de la figure du peuple, d’un peuple-acteur intervenant sur la scène publique, propre à la seconde modernité, et non pas d’un peuple-auteur qui délègue sa puissance au souverain exerçant le pouvoir.
Contre la dramaturgie « libérale » visant le consensus sur la loi assimilée à une règle technique, elle réintroduit la conflictualité essentielle de la politique, entre deux forces : celle du peuple, de ceux qui sont posés comme dépourvus de la maîtrise des leviers de commande, qui sont dominés, face à ceux qui sont donnés comme déconnectés du réel et/ou déterminés à défendre leurs intérêts particuliers, à faire sécession de la nation.
Contre la dramaturgie « lutte de classes », elle réaffirme que c’est le peuple interclassiste qui est l’acteur de la politique démocratique, posant à nouveau frais la primauté de la nation sur la classe, de la solidarité nationale sur la solidarité de classe et sur la solidarité internationaliste. D’où la valse-hésitation des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier prises entre la révolution managériale qui transforme le procès de travail, les luttes identitaires et le soulèvement du « peuple » qui soutient en même temps des revendications de type économique et des revendications politiques touchant au fonctionnement de la démocratie. Le soulèvement des Gilets jaunes en est le dernier exemple français. Elle réaffirme que la notion de « peuple » est ambiguë et l’enjeu d’un conflit idéologique.
Sur la scène médiatique, cette dramaturgie en passe par l’incarnation d’une figure se donnant comme la voix du peuple en lui-même : non pas comme le porte-parole parlant « au nom du peuple », mais comme l’advenue sur la scène politique d’une voix inouïe jusque-là.
Le leader « populiste » se présente comme celui qui « parle peuple » parce qu’il « est peuple » ou est « resté peuple » (Michelet)[9] : il intensifie une parole repoussée ou refusée par la dramaturgie libérale dominante, et expose au public les affects de ce peuple méprisé qui veut se faire entendre.
C’est à ce niveau que joue l’identification au leader, non par bêtise du peuple, mais par désir de reconnaissance, par renversement du stigmate, une part du public prenant plaisir à se reconnaître en un acteur habituellement absent de cette scène. La dramaturgie « populiste » se donne alors comme présence de la parole authentique du peuple, sans les médiations qui la déforment. Le risque encouru, sur cette scène médiatique, la réduction du leader « populiste » à l’état d’histrion qu’il sera facile de ridiculiser et de circonscrire[10].
Impasses
Cette dramaturgie est travaillée par deux contradictions au moins qui la rendent impuissante à déployer une politique d’émancipation populaire.
Tout d’abord, en posant la formation d’un peuple sous le couple catégoriel « nous/eux », elle occulte la complexité de la fabrique moderne du peuple, fabrique qui engage à mon sens trois expériences collectives au moins : celle institutionnelle de la participation à la délibération publique à l’occasion du débat électoral ; celle des conflits sociaux et politiques, de la rue ou de la grève, des solidarités nouées contre la répression et de l’auto-organisation qui rend possible la persévérance dans l’être du mouvement social ; celle, enfin, de l’éducation nationale, et des différentes formes de culture forgeant un imaginaire national populaire (Gramsci), traversé aujourd’hui des contradictions patentes du fait des conflits postcoloniaux.
J’en conclurais que, au lieu de chercher à jouer au mieux le rôle du « populiste » (de gauche), les forces sociales et politiques de l’émancipation auraient avantage à rouvrir le dissensus sur la démocratie.
Rouvrir le dissensus sur la démocratie c’est montrer en quoi la démocratie des modernes ne peut être un régime, ne peut s’identifier au régime représentatif, mais doit être prise comme un processus conflictuelle qui repose sur trois piliers, enveloppant chacun une aporie : la représentation qui tend à la dépossession de la puissance de la multitude ; l’insurrection, ou la manifestation, qui peut être annulée dans les formes d’une protestation polie ou exploser en soulèvement ; la participation ou le contrôle voire la révocation des représentants, qui peut tourner au bavardage poli ou annuler la représentation légitime.
