À propos de l’autonomie des universités, un usage dévoyé de la langue
L’autonomie des universités, au cœur des réformes qui se succèdent et se ressemblent depuis le début des années 2000, est en réalité formelle et vide de tout contenu positif.
Mise en avant dès 2007 par Valérie Pécresse, alors ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour soutenir un vaste projet de réforme de l’Université (Loi relative aux libertés et responsabilités des universités dite LRU), cette autonomie devait permettre aux établissements concernés de réaliser leur indépendance financière et comptable (de fait, il s’agit de compenser un désengagement financier toujours plus marqué de l’État), d’établir d’autres critères de recrutement des enseignants-chercheurs et de modifier la formation des enseignants.
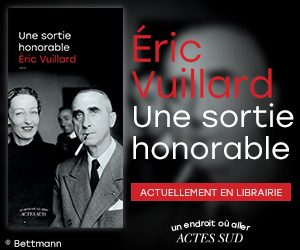
Jusqu’à la dernière réforme de 2020 (Loi pour la Programmation de la Recherche, LPR), brutalement imposée par la ministre actuelle de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ce qui est proposé n’est que l’ajustement du financement de la recherche aux logiques libérales de la concurrence marchande, l’institution de la précarisation et de l’instabilité pour les jeunes chercheurs entrant dans la carrière, l’intrusion administrative, bureaucratique et politique toujours plus poussée de l’exécutif par le biais d’agences de contrôle qui imposent leurs normes d’évaluation et soumettent l’obtention de financements publics à des projets dont le contenu échappe, pour l’essentiel, aux universités et aux établissements de recherche.
Telle est, par exemple, l’une des fonctions principales de l’HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), dont l’actuel directeur, Thierry Coulhon, a été imposé par le président Macron, en dépit de l’opposition quasi unanime de toute la communauté savante et scientifique. Il est possible d’en dire autant de l’ANR (Agence nationale de la recherche) qui soumet l’octroi de financements publics de la recherche à des critères qu’elle détermine.
L’autonomie dont il s’agit est fi
