De l’encerclement des manifestations
À partir de sa création en 2019, l’Observatoire parisien des libertés publiques[1] remarque que les forces de l’ordre (FDO)[2] ont de plus en plus souvent recours à l’encerclement total des cortèges. Les agents forment alors des lignes qui ouvrent et ferment les cortèges, et des colonnes qui en serrent les flancs. En décembre 2021, la deuxième version du « Schéma national du maintien de l’ordre », publiée par le ministère de l’Intérieur, donne aux FDO la possibilité d’encercler les manifestations dès que cela pourrait « prévenir » des violences[3] : autrement dit, même lorsqu’aucune infraction n’aurait été commise, donc n’importe quand.
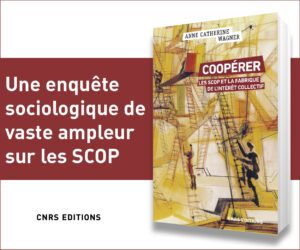
Ces dispositifs, désormais familiers des manifestants à Paris, se transforment parfois, au gré des décisions hiérarchiques et de manière imprévisible, en « nasses[4] » interdisant aux personnes de s’extraire d’un périmètre dessiné par les FDO. Mais même lorsque lorsqu’il ne s’agit pas d’enfermer les personnes, l’encerclement des cortèges constitue une atteinte au droit de manifester, retirant à la manifestation ce qui lui donne son sens et sa raison d’être.
En effet, ces dispositifs portent toujours une logique de répression des manifestations. Nous allons essayer de la mettre au jour, en montrant comment elle réprime certaines des caractéristiques essentielles de la manifestation. L’analyse prendra pour objet ces dispositifs dans leur forme la plus souple, étant entendu que si elle vaut pour ceux-ci, elle vaudra a fortiori pour les encerclements plus fermés, comme la « nasse ».
Si les manifestants peuvent encore se reconnaître comme un « nous », ce n’est plus qu’à partir de leur commune dépossession.
La manifestation de rue est une technique d’expression démocratique découlant du droit de manifester, corollaire de la liberté d’expression, consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et la Convention Européenne des Droits de l’Homme[5]. Elle peut se définir comme « occupation momentanée par plusieurs personnes d’un lieu ouvert public, qui comporte directement et indirectement l’expression d’opinions politiques[6] ».
Le recours à la rue, investie comme terrain d’expression par les manifestants, part généralement du constat d’une défaillance dans le débat démocratique. Des groupes sociaux, des communautés d’intérêts ou des partisans d’une cause, qui se considèrent négligés, cherchent par ce moyen à imposer une voix.
La manifestation est donc souvent le fait de celles et ceux qui estiment que leurs demandes n’ont pas assez d’audience, et aspirent à être entendus. Les manifestants se constituent par leur mobilisation comme une puissance politique, sujets de l’action qu’ils provoquent, pour imposer leur voix dans le débat public. Par la manifestation, un groupe d’individus se constitue donc comme un collectif unifié, c’est-à-dire comme un sujet collectif et politique.
Le concept de « sujet » peut en effet avoir deux sens opposés dans un registre politique. Le sujet peut être celui qui a été assujetti (comme le sujet du roi), mais peut aussi être celui qui agit de son propre fait (comme dans la grammaire, qui rapporte le verbe à un sujet). Une action accomplie en commun peut donc constituer un processus de subjectivation, par lequel des individus deviennent ensemble un sujet collectif agissant (selon le second sens du mot « sujet »).
Avec la manifestation, un groupe prend, comme un seul sujet, possession de l’espace public pendant un temps, pour en faire le lieu d’un événement. Elle devient ainsi un moment fondateur à partir duquel différents « je » vont se reconnaître comme un « nous », pour porter un message et peser dans le rapport de force politique. Elle permet à des individus distincts de se reconnaître comme une communauté (d’intérêts, de valeurs…), et d’en tirer une puissance pour lutter.
Mais lorsque les manifestants sont encerclés – si bien qu’ils ne maîtrisent ni le rythme du cortège, ni son extension sur la voie publique –, le déroulement de l’action leur échappe et passe sous le contrôle de la police. La manifestation perd sa dimension subjectivante, puisque ce sont les FDO qui mènent et dirigent les manifestants. Si ceux-ci peuvent encore se reconnaître comme un « nous », ce n’est plus qu’à partir de leur commune dépossession : sujets d’un pouvoir, représenté par la police, qui les encercle et fait peser sur eux, à chaque instant, la menace de l’enfermement[7].
Les dispositifs d’encerclement accentuent de plus, par la proximité physique imposée avec les manifestants, l’impression intimidante qui peut se dégager des FDO, surtout lorsqu’elles portent leur lourd armement de façon ostentatoire[8] (la police de maintien de l’ordre française est la plus armée d’Europe[9]). Ce matériel de combat ou de guerre fait passer un message implicite, accentué par la proximité des FDO avec les manifestants encerclés, qui au contact des agents, doivent faire attention à chacun de leurs mouvements. Il leur indique en permanence la menace qui pèse sur leurs corps, et montre un rapport de force qui leur est défavorable.
L’inhibition atteint ainsi les esprits et les corps, et la naissance d’un sentiment de puissance collective chez les manifestants devient impossible : la crainte et l’insécurité remplacent l’empouvoirement[10]. Le dispositif d’encerclement prive donc la manifestation de sa dimension subjectivante (être sujet, c’est être en capacité d’action ; la subjectivation implique puissance et pouvoir). Il laisse place à une symbolique de l’écrasement et de l’assujettissement, puisque les manifestants sont dépossédés d’un événement qui, de fait, n’est plus sous leur contrôle, et devient une démonstration de force policière.
L’absence de frontière fixe entre les modes d’action n’est pas le signe d’une imperfection de la manifestation, instable par essence.
Assujettir la manifestation c’est cependant se prémunir contre ce qui pourrait lui donner des airs menaçants. L’encerclement pourrait-il alors apparaître comme un mal nécessaire, qui permettrait à la manifestation de se dérouler tout en assurant la pacification de l’espace public ? Si la démocratie idéale est un régime qui soumet l’exercice du pouvoir à un débat public et pluraliste, équitable et sans rapports de force, la disparition de l’aspect menaçant des manifestations pourrait-elle apparaître comme un progrès démocratique ?
Pourtant, l’ordre politico-social résulte toujours aussi de jeux de pouvoirs, où certains intérêts l’emportent quand d’autres se voient réduits au silence. Le « débat démocratique » peut lui-même être l’occasion d’un rapport de forces, d’autant plus excluant que toutes les catégories de la population n’y ont pas le même accès.
Un régime qui prend l’idéal démocratique pour principe cardinal doit connaître ce risque et laisser jouer des mécanismes qui peuvent le réduire. C’est-à-dire qu’il doit, d’une part, reconnaître comme une éventualité permanente l’occultation injuste des intérêts de certains (autrement dit, le régime démocratique doit se savoir faillible), et doit, d’autre part, prévoir des aménagements pour corriger les situations.
Le droit de manifester est l’un d’entre eux : la manifestation peut contribuer à rectifier le rapport de forces politique et social, au cas où celui-ci écarterait du débat public et de la décision politique les voix faibles ou minoritaires. Tout régime aux prétentions démocratiques doit notamment prévoir le risque que le gouvernement devienne lui-même partial, et le droit de manifester apparaît comme un signe de cette prudence.
La manifestation part donc du principe selon lequel le débat démocratique réel n’est pas soustrait à des rapports de force. Elle permet à des individus de se constituer collectivement comme force politique, en investissant ensemble la rue pour peser, et redonner à des intérêts potentiellement méprisés la place qui leur revient.
Ainsi, la première revendication, implicite, des manifestants, est d’abord de se faire écouter. Il ne s’agit alors pas tant de demander l’attention, que de faire du bruit pour s’imposer aux oreilles des concernés. Ce qu’expriment les manifestants, c’est donc d’abord qu’il faudra compter avec eux. C’est pourquoi ce n’est généralement pas tant le contenu des revendications qui importe en premier lieu, que le nombre des participants ou leur pugnacité. La manifestation cherche moins à convaincre immédiatement, en déployant un argumentaire, qu’à instaurer un nouveau rapport de force, pour débattre peut-être ensuite, dans des conditions plus équilibrées.
Toute une symbolique de la mise en garde adressée au pouvoir accompagne donc les manifestations. Elles convoquent – par des références souvent explicites, mais aussi par leur seule existence – le souvenir de mobilisations qui, par le passé, ont tenté ou réussi à renverser des régimes ou des gouvernements[11]. La manifestation se situe ainsi entre la prise de parole et l’action directe : c’est une action symbolique, car elle tire sa valeur de ce qu’elle exprime, évoque ou représente. C’est-à-dire qu’elle vise à faire passer un message plutôt qu’à produire des effets concrets de manière directe[12].
Une action directe peut être pacifique, et un affrontement viser des effets de sens. Mais la dimension symbolique de la manifestation est ce qui lui permet toujours de prendre une forme pacifique, car il ne s’agit, au sens strict du terme, que de manifester quelque chose (et non faire quelque chose).
Les distinctions théoriques peuvent toutefois s’obscurcir dans la réalité. Ainsi, par exemple, des manifestants qui refusent de céder à la police qui veut les déloger ajoutent une action directe à leur action symbolique initiale : résister à l’intervention policière, non pour faire passer un message, mais pour continuer à occuper le terrain à partir duquel le message est produit.
Dans ce cas, les participants restent manifestants, mais mènent en même temps une action directe pour tenir le terrain. Il est donc parfois difficile de tracer une ligne d’épure entre différents modes de revendication ; les répertoires d’action de la manifestation et de l’émeute ou de l’insurrection peuvent dans certains cas se chevaucher.
Pourtant, l’absence de frontière fixe entre les modes d’action n’est pas le signe d’une imperfection de la forme manifestation. Elle la caractérise au contraire : instable par essence[13]. La manifestation risque toujours de glisser vers autre chose, et c’est justement pour cela qu’elle peut avoir des effets.
En effet, cette instabilité et le risque qu’elle implique peuvent constituer l’une des significations sous-jacentes des manifestations, qui portent avec elles la menace (donc : un message) de l’action directe. Les mouvements sociaux qui, n’obtenant pas l’audience souhaitée, se tournent parfois vers des actions de blocage voire de destruction, mettent à exécution cette menace implicite.
C’est ainsi que l’historienne des mouvements sociaux Danielle Tartakowsky analyse dès 2018 la casse dans les manifestations de Gilets jaunes : « Ce mouvement intervient là après les échecs répétés des syndicats contre la loi El Khomri, les ordonnances Pénicaud, la réforme de la SNCF, qui ont inscrit l’idée que les moyens traditionnels – la manifestation et la grève – ne suffisent plus. D’où la casse qui ne semble pas seulement le fait des activistes d’extrême gauche et d’extrême droite, mais aussi de certains « gilets jaunes ». Et il faut noter que les violences de ce samedi n’ont pas provoqué de basculement de l’opinion qui soutient encore majoritairement le mouvement[14]. ».
Ainsi s’explique la symbolique menaçante qui se dégage parfois des manifestations. Même lorsque les cortèges revêtent un aspect festif se lit toujours un message implicite : nous sommes pacifiques, mais nombreux, résolus, et en colère : il faut maintenant que nos revendications soient entendues. La manifestation n’a donc de sens, comme forme d’action pacifique, qu’à condition qu’elle puisse, sans recours à la violence, être perçue comme une démonstration de force[15].
Elle doit donc pouvoir donner l’impression qu’elle représente une menace, car des manifestations qui se répéteraient, sans que le mouvement social qu’elles incarnent ne paraisse susceptible de se tourner vers d’autres formes d’action, auraient peu de chances de finir par se faire entendre. La menace ne serait pas prise au sérieux, et la manifestation resterait sans effet. L’encerclement policier, s’il fixe la manifestation dans son registre pacifique, retire donc en même temps son sens à ce pacifisme, car il empêche les cortèges de déployer une symbolique menaçante, et neutralise ce-faisant les manifestations.
Ce qui constitue l’essence des manifestations, telles que nos régimes démocratiques les ont vues apparaître, est donc réprimé par les dispositifs d’encerclement. Elles ne peuvent, en effet, jouer leur rôle de garantie démocratique que si elles peuvent prendre la forme de l’avertissement, susceptible d’imposer une modification du rapport de force. Ceci est impossible avec les dispositifs d’encerclement, qui montrent un assujettissement des manifestations, dont le sens est même renversé, puisque c’est la présence policière qui devient intimidante.
De ce fait, l’exécutif répond à la manifestation, action symbolique, par un autre symbole : celui de l’écrasement policier d’une action qui ne se déroule que parce que le pouvoir l’accepte, que parce qu’elle ne présente plus aucun danger pour lui, symbole d’un cortège rendu inoffensif, menacé pour ne plus être menaçant, dont les participants ne déploient que le symbole de leur propre domination. Le rapport de force politique, souvent défavorable à la cause des manifestants, est reconduit dans la rue par le contrôle total de l’événement par les FDO.
Les dispositifs d’encerclement, qui prétendent laisser les cortèges se tenir, les privent de raison d’être. Ils répriment la dimension expressive des cortèges, et s’en prennent ainsi au droit de manifester lui-même[16].
La pratique de l’encerclement criminalise les manifestants car, aux yeux du public, ces dispositifs font appel à un imaginaire de l’escorte policière.
Le message manifestant, en tant que démonstration de force, est directement destiné à des pôles de pouvoir (gouvernements, institutions, grandes firmes, groupes politiques…). Mais les cortèges s’adressent aussi, en même temps et surtout, à un public spectateur (passants ou spectateurs médiatiques), que les manifestants cherchent à rallier à leur cause, sensibiliser ou prendre à parti.
Si les manifestations se veulent menaçantes pour le pouvoir visé, elles cherchent souvent en même temps à s’attirer la sympathie du public, et sont « destinée[s] à « rendre manifeste » un problème donné au-delà de la seule sphère de ceux qu’il implique directement[17] ». Cette adresse se traduit par l’investissement de la rue, « lieu éminemment politique » où, au XIXe siècle, « on s’attroupe pour lire les journaux placardés ; c’est là que l’affiche politique, bientôt illustrée, apparaît […] ; mais c’est surtout là que les sans voix, ceux qui ne disposent pas d’un accès routinier aux autorités, peuvent désormais se faire entendre par l’envahissement et le blocage des espaces réservés à la circulation[18]. » Manifester consiste donc à investir l’espace public, pour ne pas rester « sans voix ». Certains cortèges mêlent donc le registre de la colère avec celui de la parade festive, notamment pour solliciter passants, et spectateurs médiatiques.
Les dispositifs encerclants rendent cependant impossible la tenue de festivités dans les cortèges : ils imposent une atmosphère délétère, peu encline à donner à la manifestation les faveurs du public, dont les manifestants sont délibérément maintenus à l’écart.
La séparation est d’abord physique, avec les lignes de FDO. Toute porosité entre manifestants et public est alors impossible : les rues sont divisées, de telle sorte qu’une place soit attribuée à chacun.e, et que l’on puisse saisir d’un coup d’œil qui est manifestant.e et qui ne l’est pas. L’espace ainsi aménagé somme ses occupants de choisir et afficher leur « camp », sans pouvoir se rencontrer[19].
Les dispositifs d’encerclement policier ne permettent donc plus aux manifestants d’investir l’espace public : une partie de la rue leur est « attribuée », afin que le reste puisse leur être refusé. La manifestation devient occupation d’un espace qui lui a été exclusivement dédié et a ainsi, d’avance, perdu sa publicité.
Cette séparation physique s’accompagne d’une mise à distance morale, car la surprésence policière donne à la manifestation et ses participants un air inquiétant. Les passants sont parfois effrayés au passage de tels cortèges : la surprésence policière peut en effet être interprétée comme le signe d’une situation prête à dégénérer et de la présence de personnes dangereuses. La pratique de l’encerclement criminalise donc les manifestants car, aux yeux du public, ces dispositifs font appel à un imaginaire de l’escorte policière qui accompagne un coupable ou un suspect dangereux, et donnent donc une image négative de l’événement. Ceci empêche les manifestants de s’attirer les faveurs d’un public qui pourrait à son tour faire pression sur le pouvoir.
•
L’encerclement, qu’il soit ouvert ou fermé, renverse donc complètement les rapports traditionnellement établis par les manifestations : elles ne peuvent plus se montrer sous un air menaçant pour le pouvoir, ni susciter la sympathie et la solidarité du public. Elles se montrent au contraire menacées par le pouvoir, et menaçantes pour le public.
L’encerclement, qui permet généralement au cortège de suivre son itinéraire, l’empêche d’être la manifestation de son message.
