Zelensky, héros iconopolitique
« Quand on réfléchit aux conquêtes diplomatiques et autres de cette puissance, naguère encore comptée pour peu dans les affaires du monde civilisé, on se demande si ce qu’on voit est un rêve. »
Marquis de Custine, Lettres de Russie, 14 juillet 1839
Le 24 février 2022, l’invasion militaire de l’Ukraine par l’armée russe aux ordres de Poutine a semblé surprendre le monde, comme si l’événement avait fait effraction dans la bonne conscience irénique de l’homme occidental moderne. Mais cette guerre correspond pourtant à un scénario très conventionnel, très ancien, intégré de longue date à notre imaginaire politique : un scénario étatico-militaire, territorial et annexionniste. Les chars, les démonstrations de force, les bataillons, les missiles : tout cela donne une impression de déjà-vu.
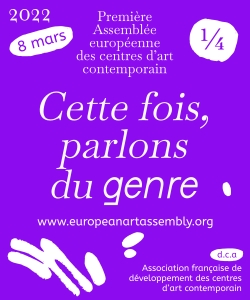
Les exercices balistiques effectués à la frontière de l’Ukraine avant l’invasion ont répété des formes d’images familières à un citoyen du XXe siècle, et dont l’inquiétante étrangeté a été précisément proportionnelle à cette familiarité, comme quand on revoit, des années après, un vieux film qui nous avait marqué dans notre jeunesse. Répété comme la possibilité la plus propre de l’ordre mondial pendant la guerre froide, ce scénario est tellement usé que nous ne le pensions plus possible, et l’avions remisé parmi les clichés et les rengaines d’une époque révolue. Ce qui cause la surprise, ce n’est donc pas l’événement actuel en lui-même, comme si sa possibilité ne l’avait pas déjà précédé. Si la conscience peine à assimiler ce qui arrive, c’est plutôt en raison d’un décalage anachronique entre cette guerre et nos scénarios possibles et disponibles, nos scripts, nos imaginaires.
Un événement ne réalise jamais que ce qui est possible. Par définition, le possible est plus large que le réel et le conditionne. Or, le possible n’est pas seulement une catégorie abstraite, logico-idéelle, c’est aussi une catégorie concrète de l’imaginaire. Les corps sont des images matérialisées. Ainsi l’imaginaire, avec ses formes d’images, conditionne-t-il toujours l’événement qui lui emprunte sa forme et y puise son influence. Le char, le missile : ce ne sont pas seulement des réalités locales, mais aussi des images ubiquitaires « rayonnantes ». Une bombe explose non seulement à Kyiv ou à Kharkiv, mais dans le monde entier, en images. L’immeuble est troué et s’effondre dans notre conscience iconique fascinée, en même temps que dans la ville où l’on meurt.
À la différence d’un dessin ou d’une peinture, une image vidéo est certes toujours indexicale : elle implique l’existence de l’objet qu’elle montre, et semble dire « voici ce qui arrive », comme un index pointé sur le réel. Mais l’image vidéo est aussi une icône. En tant que telle, elle vaut en elle-même en tant qu’image, et non seulement en tant qu’indice de son objet. Elle exerce un charme scopique et produit des affects à distance, des affects mondialisés par la diffusion quasi-synchrone qui régit désormais l’information.
Toute politique est aujourd’hui en partie une iconopolitique : l’image est un instrument de pouvoir, non seulement un pouvoir sur l’opinion, mais un véritable conatus. Une image peut augmenter ou diminuer notre puissance d’agir. Or, Poutine a sûrement cru pouvoir fasciner l’Occident et figer les pays de l’OTAN dans une position d’attente immobile, par le charme de Méduse de la guerre qu’il a déclenchée. Et c’est là que réside l’une de ses erreurs massives : non pas une erreur de stratégie militaire ou de calcul politico-économique, comme s’il n’avait pas prévu la riposte de l’Occident, mais une erreur de calcul iconopolitique.
Telle est la logique iconopolitique : le réel se met à solliciter la validation de nos images pour devenir visible et actif. Fin février, Poutine a déjà perdu la guerre iconopolitique.
Les images de la guerre engendrées par le gouvernement de Poutine appartiennent à un régime iconique périmé. Car le possible, lui aussi, naît, vit et, parfois, meurt. On voit bien que les images de la force armée font système avec la mise en scène du pouvoir russe : le président autoritaire qui entre en scène et s’installe seul à sa table ; la table de six mètres, laquée blanche et ornée d’or, où il reçoit Macron le 7 février, etc. Il s’agit là d’une imagerie théâtrale, isomorphe avec la guerre territoriale de positions. Le théâtre est astreint à l’unité de lieu de la scène physique, comme la guerre d’invasion est rivée à la géographie du territoire.
Le marquis de Custine, en 1839, avait été frappé par le caractère théâtral de la cour de Russie ; il disait de l’Empereur Nicolas Ier : « Il s’attend toujours à être regardé, il n’oublie pas un instant qu’on le regarde : même vous diriez qu’il veut être le point de mire de tous les yeux ». Or, un tableau de Nicolas Ier, essence pure du tsarisme, orne le bureau présidentiel du Kremlin. S’il semble évident que Poutine est encore inspiré par le vieil impérialisme russe dont l’effondrement de l’Union soviétique a brisé l’élan, il l’est tout autant par la dimension théâtrale de cette forme de pouvoir.
Custine écrit encore que la cour de Russie lui « fait de plus en plus l’effet d’un théâtre où les acteurs passeraient leur vie en répétitions générales ». Ainsi l’armée russe en février 2022 semble-t-elle à son tour répéter un scénario voué à sa propre exténuation. Que peut en effet le théâtre dans un monde où le virus est le nouveau paradigme de l’information, un monde où l’image fuse et se réplique en vidéos sur les réseaux mondialisés ?
Le modèle médiatique de l’action politique au XXIe siècle, ce n’est ni le théâtre, ce n’est même plus le cinéma, mais la télévision en streaming et, plus encore, la vidéo, le post, l’action directe de journalisme citoyen. En ce sens, cette guerre est peut-être l’un des derniers soubresauts retardataires du XXe siècle. L’isolement de Poutine sur la scène internationale ne s’explique pas par une « hégémonie » économique américaine, mais par la monition plus diffuse d’un régime dominant de signes, par l’aura silencieuse de ce que j’appellerais une « police iconique ».
Il y a un ordre du visible, comme il y a un « ordre du discours ». Comme disait Foucault, on peut très bien dire le vrai pour lui-même, dans le vide, mais on n’est « dans le vrai » qu’à condition d’obéir aux règles d’une « police discursive », avec ses formes, ses protocoles, ses appareils. De même, il y a pour nous aujourd’hui des conditions iconiques d’existence, qui rendent le visible visible et efficace, c’est-à-dire capable d’agir sur nos consciences et sur nos corps. Telle est la logique iconopolitique : le réel se met à solliciter la validation de nos images pour devenir visible et actif. Fin février, Poutine a déjà perdu la guerre iconopolitique.
C’est ce que prouve par contraste l’ascension iconopolitique fulgurante de Volodymyr Zelensky. Ancien comédien jouant dans une série télévisée un homme ordinaire accédant à la présidence de l’Ukraine, puis réalisant ce scénario avec un parti politique qui porte le nom de la série, « Serviteur du peuple », Zelensky est la créature iconomorphique de son propre rôle fictionnel. Marx disait que l’histoire se répète toujours deux fois, « la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce » ; aujourd’hui, il nous faudrait dire que c’est la comédie elle-même que l’histoire répète en tragédie.
Mais le comique de la fiction passe aussi dans le réel, car Zelensky oppose à Poutine l’ironie de l’icône. Iconique, il est hors d’atteinte des commandos qui le visent. Zelensky n’est pas seulement l’opposant politique improbable à Poutine, promu à la présidence de l’Ukraine par une opportunité électorale, il est plus que cela : l’anti-Poutine, sémiotiquement parlant, son adversaire idéal, parce qu’il pèse contre lui de tout le poids d’une forme mondiale de visibilité, dont il est l’émanation et la concrétion personnelle.
Entre Zelensky et Poutine a lieu une véritable bataille d’acteurs, qui reflète la lutte entre des appareils médiatiques anachroniques. En régime iconopolitique de pouvoir, les séries télévisées deviennent des machines électorales, des agents politiques à part entière, plus puissants que les partis. Le parti de Zelensky reprend le nom de la série, « Serviteur du peuple », et reprend en même temps son aura médiatique pour la convertir en réalité.
En régime iconopolitique de pouvoir, l’image a cessé de représenter la réalité, elle en est au contraire la puissance intime, l’énergie motrice, la substance même. Poutine a méprisé Zelensky, juif russophone, comme une sorte de petit Trump ukrainien, qu’il croyait pouvoir destituer sans peine. Quand Poutine parle de « dénazifier » l’Ukraine, il désigne certes certains intérêts dans la révolution de Maïdan de 2014, qu’il juge être opportuns aux intérêts des États-Unis et de l’OTAN, mais il n’avait pas calculé ce que Zelensky, en tant qu’émanation iconique, ajoute de résistance à cette équation politique.
Zelensky parvient à s’imposer comme homme de la situation, fédérant la démocratisation de son peuple, non pas seulement en raison d’un courage individuel héroïque, mais parce que son action coïncide avec les conditions de la visibilité. D’une part, la télévision est un médium domestique ; grâce à elle, la fiction entre dans nos vies, à travers des personnages familiers qui nous accompagnent et nous éduquent. Ainsi Zelensky président et chef de guerre est-il contraint de se faire à l’image de son image, de continuer à faire vivre son personnage fictionnel en actes et en symboles. Son courage lui vient en partie de ce double fictionnel, qu’il matérialise. D’autre part, les vidéos « horizontales » que Zelensky a postées sur les réseaux sociaux avec son téléphone portable, dès les premiers jours de l’invasion, ont été un contre-pouvoir efficace à la désinformation russe.
Zelensky produit ses propres images comme les ukrainiens produisent leurs armes de fortune, en se préparant à combattre l’armée russe : il fabrique ses vidéos comme on fabrique des cocktails Molotov. Ainsi est-il un président-citoyen, accusant par contraste le caractère anachronique ridicule du faste et de l’appareil d’Etat dont se pare Poutine.
Zelensky montre la voie d’une nouvelle diplomatie, distancielle ; il parle en visioconférence au parlement européen et agite les cœurs.
Ce dispositif de lutte médiatique est une mise en abyme de ce qui arrive dans la série télévisée. Vassili Goloborodko, professeur d’histoire, y est en effet filmé à son insu par un de ses élèves, en train de critiquer les autorités et la corruption. La vidéo passe sur YouTube et devient virale. L’enseignant reçoit alors de l’argent par l’intermédiaire d’un financement participatif de ses étudiants et s’inscrit comme candidat aux élections présidentielles d’Ukraine. Tous les appareils qui permettent l’ascension de Goloborodko au pouvoir sont des appareils démocratiques : capture vidéo, image virale, financement participatif.
La démocratie n’est pas essentiellement une forme de gouvernement, c’est d’abord une forme de vie. La manière dont on échange, dont on se relie dans la société civile, dont on s’informe, dont on relaie et partage l’information : voilà des marqueurs démocratiques sûrs. Ainsi Zelensky précipite-t-il l’Ukraine dans une forme de vie démocratique, dont la guerre est l’occasion involontaire et la cristallisation.
D’une manière générale, les personnalités politiques sont des produits et d’habiles usagers des appareils du pouvoir médiatique. De Gaulle est un personnage radiophonique, dont la voix a publiquement précédé l’image lors de l’appel du 18 Juin. Kennedy était typiquement un président de l’ère du cinéma, et le Zapruder (le film de sa mort, filmé par hasard par Abraham Zapruder) s’inscrit dans l’histoire du cinéma américain. Il y a quelque chose de cinématographique dans le destin même des Kennedy, comme une sorte d’étrange cinémorphisme. Berlusconi, Sarkozy, Trump sont tout autre chose, des présidents de l’ère de la télévision. Ronald Reagan était un ancien acteur de cinéma, Trump un ancien personnage d’émission de téléréalité. Mais la télévision a cessé d’être le média dominant. Macron est déjà un autre type de personnage médiatique, certes télégénique, mais surtout transmédia, philosophe et banquier, à cheval sur plusieurs plateformes. Zelensky est, pour sa part, le kairos d’une démocratisation de l’Est.
Face à Zelensky, Poutine est sûrement un dirigeant historique, au sens où sa psychologie du pouvoir est entièrement façonnée par le récit historique, celui de la Russie, de son empire et de son prestige culturel. Mais les peuples ne sont pas que des entités historiques. Un peuple peut aussi se dresser dans et par l’événement. Le peuple russe historique rêvé par Poutine est un peuple-zombie, dont les poches réactionnaires dans le Donbass ne sont que des rejets sans vie. Au contraire, le peuple ukrainien vivant de 2022 est un peuple en action, qui se constitue par et dans l’affrontement.
Dans la constitution de ce peuple actif, la vidéo opère une action à distance positive. On a vu la misère de la diplomatie traditionnelle, présentielle, face aux nouvelles distributions du pouvoir : Macron se déplace à Moscou en vain. Au contraire, Zelensky montre la voie d’une nouvelle diplomatie, distancielle ; il parle en visioconférence au parlement européen et agite les cœurs. Il est déjà européen, non par le droit, mais par la média-démocratie qu’il promeut et la forme de vie qu’elle implique. Dans un scénario où, face au danger imminent de son assassinat, Zelensky serait exfiltré et exilé en Europe, il continuerait d’agir à distance en tant qu’icône démocratique, avec un pouvoir légitime accru par sa distance même.
Poutine est un vieux prince, dont l’armée cache la misère iconique. Le pouvoir iconique est toujours ambivalent. D’un côté, Donald Trump avait déjà transféré à la Maison Blanche les images de téléréalité de The Apprentice, et cette matérialisation du spectacle a transformé réellement l’exercice du pouvoir institutionnel. Elle a installé une gouvernementalité par tweets et par ordonnances. De l’autre côté, au contraire, la blondeur iconique pop de Ksenia Sobchak, lunettes noires et rouge à lèvres vif, a été l’adversaire médiatique choisi par lequel le vieux pouvoir étatique russe s’est inoculé lui-même le charme féminin des images télégéniques, pour s’immuniser contre une contestation authentique. Mais Zelensky marque un tournant, un renversement des rapports de forces iconiques dans lequel le gouvernement russe est le perdant. L’icône est une entité machiavélique, toujours polyvalente et réversible.
Ce que Poutine a sous-estimé, c’est peut-être, plus encore que la résistance physique de l’armée et du peuple ukrainiens, le poids des forces iconiques dans l’action politique au XXIe siècle, ce nouveau machiavélisme qui est un machiavélisme de l’image. Aujourd’hui, l’image a ses caprices, ses tours, ses ruses ; elle se retourne contre le prince qui croyait pouvoir l’utiliser à son profit.
