L’Europe, les Juifs, le XXIe siècle
Modernité juive
Le long XIXe siècle fut le siècle de l’émancipation des Juifs en Europe. Le mouvement eut plusieurs foyers et se diffusa dans toutes les directions. Des Lumières françaises, de leur version allemande qu’est l’Aufklärung en passant par la Haskala – les Lumières juives qui prirent leur essor en Allemagne et s’étendirent à l’Est – les barrières commencèrent à s’abaisser, puis finirent par tomber. C’est ainsi que les Juifs se sont engouffrés dans le tournant moderne de l’histoire européenne. Ce processus finit par les intégrer au sein des États modernes en formation, à l’Ouest de l’Europe d’abord, puis au Centre. Le coup d’envoi fut donné par la Révolution française qui émancipa abruptement les Juifs, avant que l’émancipation ne s’impose aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, puis progressivement en Italie, dans les pays germaniques, l’Empire austro-hongrois et l’Allemagne en voie d’unification. Plus à l’Est, dans le grand espace dominé par l’Empire des Tsars, de la Baltique à la Mer Noire – Pologne, Pays Baltes, Ukraine, Biélorussie, Roumanie – là où la population juive était la plus nombreuse et la plus dense, le chemin fut considérablement entravé. Il prit une trajectoire bien plus sinueuse, alternant les amorces timides et les régressions brutales, jusqu’à ce que la donne soit modifiée par la révolution soviétique.
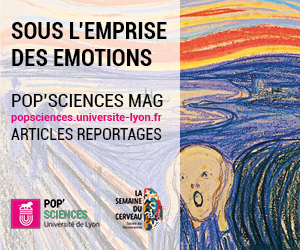
Sur un temps assez long, qui coïncide pour eux avec le fait de devenir modernes, la condition des Juifs en Europe était donc disparate. Elle l’était à la mesure des divisions du continent, où coexistaient des Monarchies constitutionnelles, des Républiques, des Empires en voie de réforme, ou bien obstinément figés à un stade semi-féodal. Plusieurs figures se détachaient dans cet espace bigarré. D’un côté, on comptait des Juifs nationalisés, c’est-à-dire des « individus juifs », citoyens intégrés dans leurs États et disposant de droits civils, politiques et sociaux à égalité avec les autres citoyens. A l’autre pôle, on trouvait des Juif
