Le courage de « prendre une position »
S’exprimer sur l’invasion de l’Ukraine ? Ajouter un mot de plus à tous ceux qui circulent ? J’hésite…
J’observe déjà beaucoup de gens s’exprimer à partir de leur savoir technique (géopolitique, historique, militaire, etc.) ou de leur autorité (morale, artistique, biographique, etc.). À quoi bon en rajouter ? Ne faut-il pas céder la parole aux savants, aux éveillés, aux premiers concernés ?
Mais précisément : j’observe aussi beaucoup de tentatives d’intimidation, d’appels à se taire. On oppose aux gens leur ignorance, leur inexpertise. On dénonce aussi l’indécence de tous ces mots qui sortent de certains corps quand des bombes déchirent d’autres corps. Obscénité du bavardage… J’observe enfin une augmentation impressionnante de la violence verbale. Les insultes pleuvent : « munichois », « collabo », « poutinophile » d’un côté, « va-t-en-guerre », « agent de la CIA », « raciste » de l’autre… Ces mots trahissent une tendance à inculper l’opinion des autres, à la considérer en somme comme un élément de la guerre elle-même, une arme, avec laquelle il ne s’agit plus de débattre mais de combattre.
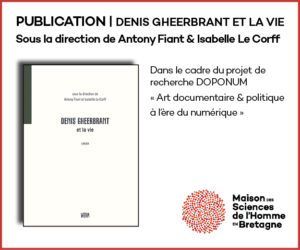
Bien sûr, on peut comprendre cette agitation : la violence crée une urgence impérieuse, l’urgence de la faire cesser, selon les voies que chacun croira les meilleures. Elle crée chez celles et ceux qui ne la subissent pas directement à la fois un sentiment d’insécurité et un sentiment de culpabilité. On rendra complice qui s’oppose à la voie qui nous semble la meilleure pour la faire cesser et mettre un terme à l’insupportable.
Pourtant, je crois que s’il est une situation où il faut supporter le désagrément des paroles contradictoires, y compris du bavardage, c’est précisément une situation comme celle dans laquelle nous nous trouvons – c’est-à-dire : une situation où l’hypothèse d’une effraction de la guerre dans nos vies cesse d’être une possibilité théorique qu’on peut déléguer à des professionnels, où elle devient un point à l’horizon qu’on guette pour savoir s’il s’éloigne ou se rapproche. Car l’invasion de l’Ukraine signifie ceci : la politique de Poutine a désormais pour conséquence que la guerre est devenue, redevenue, une hypothèse envisageable pour nous. Et cette situation crée des obligations, et d’abord des obligations qui relèvent de ce que j’appellerais l’éthique de la parole publique.
Commençons par le premier point, d’où tout le reste suit, à savoir que la guerre est désormais réinscrite dans notre horizon, car je ne suis pas sûr qu’il soit bien compris. Pour ma part, j’ai pris conscience du caractère concret de cette possibilité le jour où j’ai lu que le président Volodymyr Zelensky appelait les pays de l’OTAN à établir une zone d’exclusion aérienne. Malgré la réponse réitérée des dirigeants de l’OTAN, rappelant qu’une telle opération risquait de déclencher une guerre entre la Russie et l’OTAN, deux puissances nucléaires, un très grand nombre de responsables ukrainiens ont depuis réitéré cet appel. Des personnalités intellectuelles de premier plan l’ont relayé à leur tour, comme le grand cinéaste Sergei Loznitsa, qui dit de manière quelque peu équivoque que « l’OTAN et l’Europe doivent accepter l’idée qu’ils ne vont pas pouvoir éviter une guerre plus large », qu’elle est « inévitable ».
Je lis aussi des interventions sur les réseaux sociaux et, plus rarement, dans la presse, de personnalités intellectuelles de qualité qui ne défendent rien d’autre qu’un engagement militaire de la part de l’OTAN. Le fait même que j’ai un très grand respect, à divers titres, pour certaines de ces personnes a produit sur moi un effet de réel : donc ce qui se jouait en Ukraine n’était autre que l’éventualité que nos sociétés se retrouvent entraînées de nouveau dans une guerre mondiale ?
Comment peut-on oser demander à des gens de voir leurs vies mises en péril par des décisions lointaines, tout en leur intimant en même temps de se taire et de laisser les experts ou les images leur dicter ce qu’ils doivent en penser ?
C’est du point de cette question que je souhaite m’exprimer. Cette question est d’abord un effroi, une surprise, une sidération, avant d’être un problème bien cadré et froidement posé, et je crois qu’il faut qu’il en soit ainsi, qu’il faut tenir le plus longtemps possible ce point d’effroi, avant – et même afin – d’être capable de réfléchir la situation. Il ne faut pas juger de ce qu’il « faut faire » ou « ne pas faire », de ce que dit l’un ou l’autre, comme s’il s’agissait d’un problème théorique sur lequel nous appliquerions de grands principes abstraits ; il ne faut construire son jugement qu’en assumant le fait que nous sommes pris dans cette situation d’abord de manière affective, vitale, concrète.
Ensuite, une telle situation crée une urgence paradoxale : celle de résister à toutes les opérations rhétoriques qui, volontairement ou involontairement, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, intiment au silence, que ce soit en nous invitant à laisser ces questions qui nous dépassent à des experts ou en faisant comme si la violence des images de violence dictait clairement la conduite à suivre, court-circuitait tout jugement, tout bavardage, traçait en toute clarté la voie du juste et de l’injuste.
Il faut y résister pour une raison bien simple. La guerre signifie qu’un nombre indiscriminé de gens voient leurs vies exposées à la destruction. Et par « vie » il faut entendre non seulement leur existence biologique, mais aussi tout un ensemble d’habitudes, d’habitations, de régularités. Car on ne vit pas en général : toute vie est qualifiée. On vit d’une certaine vie. C’est d’ailleurs une des manières de comprendre que des gens soient prêts à risquer leur vie biologique pour sauver autre chose que des valeurs abstraites : une certaine manière de vivre. Si on détruit mon quartier, si on oblige à me séparer de mes proches, que ce soit parce qu’on les force à l’exil ou parce qu’on me force à la conscription, si on m’interdit de m’exprimer dans ma langue, si on m’enlève ce qui constitue l’axe de ma vie (par exemple enseigner la philosophie), on ne se contente pas de porter atteinte à des valeurs abstraites, on détruit ma vie, réellement, ma vie ordinaire, cette vie que je vis.
Or parler de guerre, c’est parler d’un engrenage d’actions qui pourrait conduire à mettre en danger la vie d’un nombre indiscriminé de personnes, du seul fait qu’elles se trouvent sur un territoire ou qu’elles appartiennent à une certaine collectivité juridique (nationale).
Dès lors, la question s’impose : comment peut-on oser demander à des gens de voir leurs vies mises en péril par des décisions lointaines, tout en leur intimant en même temps de se taire et de laisser les experts ou les images leur dicter ce qu’ils doivent en penser ?
La philosophie consiste à exercer les outils du raisonnement ordinaire, de cette espèce de discours sans garantie ultime, sans terrain solide, qui ne cesse de se produire en nous à propos de ce que nous vivons.
Si donc la guerre exige quelque chose de nous, de nous, gens à qui on donne la parole, c’est d’abord de donner à tout le monde le courage d’entrer dans la discussion, de s’informer, de réfléchir, de « prendre une position ». Tout simplement parce que ce qui se joue ici les concerne de la manière la plus vitale qui soit.
Est-ce à dire qu’on doit encourager chacun et chacune à dire n’importe quoi et parler à tort et à travers ? Non bien sûr, on doit encourager à s’informer, à mettre à l’épreuve la cohérence de son propos, et surtout à éviter les deux écueils symétriques de l’abstraction (qui pose les problèmes comme si le problème n’était pas précisément que d’autres n’ont pas le loisir de réfléchir abstraitement) et de l’émotion (qui fait comme si l’horreur de la réalité dictait la conduite à suivre) : il faut rendre justice à la fois au particulier et au global, au perceptible et au pensable. Nous ne pouvons rien faire de mieux que donner l’exemple d’un discours qui fasse passer le réel dans le langage sans céder à l’illusion de croire que ce réel est univoque. Il faut enfin donner l’exemple de la nuance, refuser l’évidence des camps, reconnaître une certaine complexité de la situation, faire droit aux passions et aux angoisses.
Mais malgré tous ces efforts, on arrivera toujours à ce point où il faut reconnaître que, quel que soit le poids que nous serons capables de donner à nos paroles, nous sommes en train de parler de quelque chose qui nous dépasse, sur lequel nous ne pouvons pas avoir de position juste. Nous sommes en train de redécouvrir ce que Sartre appelait l’Histoire : cette étrange réalité à laquelle je ne peux participer qu’en reconnaissant que je ne m’y inscris jamais de la manière dont je le crois, qu’il y a quelque chose à la fois de disproportionné, presque de ridicule, et en même temps de nécessaire, à la prétention d’y prendre part.
Le nom de Sartre résonne aujourd’hui pour moi singulièrement. Il est un des rares à avoir compris le lien étroit qu’il y a entre l’Histoire et une discipline particulière, la philosophie. Car avant d’être un ensemble de doctrines, la philosophie est une pratique qui consiste précisément à exercer les outils du raisonnement ordinaire, de cette espèce de discours sans garantie ultime, sans terrain solide, qui ne cesse de se produire en nous à propos de ce que nous vivons. La philosophie c’est l’art paradoxal d’apprendre à penser comme tout le monde, c’est l’entraînement spécialisé d’une faculté qui paradoxalement ne saurait être spécialisée : la faculté de penser. Or bizarrement, rien mieux que la guerre ne montre la pertinence de la philosophie. Ma vie, avec ses intérêts les plus précis, les plus concrets, les plus vulgaires, ne peut pas totalement ignorer le monde – précisément parce que le monde ne la laisse pas tranquille –, mais en même temps ce monde n’est jamais à sa mesure, il n’existe que dans un décadrage vertigineux, une bascule sur un espace de coordonnées totalement inhabitable, incommensurable, quelque chose à quoi je n’ai accès que sur un mode spéculatif.
C’est précisément cette exigence paradoxale (il faut accepter de se prononcer sur ce à propos de quoi nous n’avons aucune mesure pour nous prononcer) qui s’impose particulièrement en situation de guerre et c’est elle que la philosophie a, mieux que d’autres discours, le pouvoir de nous rappeler. C’est en tout cas de cette position, de la position du raisonnement ordinaire, assumé au risque de l’erreur, du bavardage, du ridicule, mais pourtant travaillé en tant que tel, que pour ma part je souhaiterais m’exprimer sur cette situation. Ce que j’en dirai, on le verra en temps utile. Mais il me semble important que chacune et chacun clarifie la position d’où il parle, et l’éthique de sa prise de parole. C’est précisément parce que la philosophie déploie un discours sans autorité, sans titre, qu’elle a un titre paradoxal à intervenir dans cette situation terrible qui est désormais la nôtre : celle où la guerre est redevenue une possibilité concrète dans notre horizon.
