Écrire, décrire, faire rire :
les « petits gestes »
de Bruno Latour
Si les grandes idées de Bruno Latour ont été amplement discutées, on n’a que peu parlé de ses « petits gestes ». Pourtant ce sont ces gestes qui montrent comment il enseignait et pratiquait la recherche au quotidien. Face à la théorie de Latour, dressons le portrait de la pédagogie de Latour.
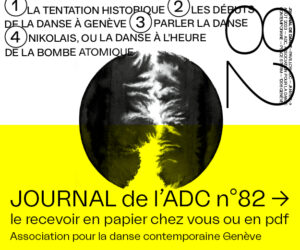
Voici quatre choses que je ne vais donc pas faire dans ce qui suit : résumer sa pensée en citant quelques-uns de ses livres et de ses concepts ; mentionner les prix qu’il a reçus ; retracer les différentes étapes de sa carrière ; situer sa posture et ses contributions par rapport à la sociologie, la philosophie, l’écologie, les sciences politiques ou l’anthropologie.
Car résumer, mentionner, retracer, et situer, de nombreux commentateurs l’ont déjà très bien fait. Cet article pose une autre question : qu’est-ce que Bruno Latour a fait faire à ses étudiants, à ses collègues, à ses lecteurs, à ses critiques ? Réponse en trois gestes.
Écrire
Écrire semble être un geste banal. Tous les chercheurs écrivent des textes. Tous les chercheurs lisent et relisent des textes. Et si l’écriture n’allait pas de soi ? Et si elle devenait, tout comme les matériaux et l’analyse, une préoccupation en soi ?
Dans sa thèse de doctorat, un des anciens thésards de Latour le remercie pour lui avoir « donné des conseils utiles pendant ces cinq années, non seulement sur la façon de mener mes recherches, mais surtout sur la façon de m’asseoir devant mon ordinateur et d’écrire cette thèse ».
Latour prenait l’écriture très au sérieux : « C’est là où je suis en total désaccord avec la façon dont on forme les doctorants en sciences sociales. Écrire des textes a tout à voir avec la méthode […] Ne pas apprendre aux doctorants à écrire leur thèse, c’est comme de ne pas apprendre à des chimistes à faire des expériences. C’est pourquoi, désormais, je n’apprends plus rien d’autre qu’à écrire[1] ».
Pour le séminaire doctoral qu’il animait au Centre de sociologie de l’innovation à l’École des Mines, Latour a
