De la nullité du débat sur les retraites
La grande affaire de la fin 2022 et du premier semestre 2023, la bataille des retraites n’aura été ni une bataille rangée, ni une suite d’escarmouches. Pas même une course de chevaux à Longchamp pour parieurs avides de sensations. Tout juste une course à l’échalote pour savoir qui allait porter le bonnet d’âne. Et encore, car elle s’est faite en sac de pommes de terre à cloche-pied.
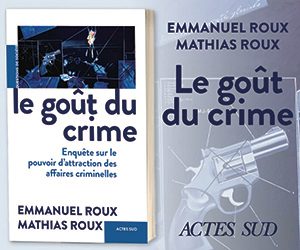
Il faut dire que tout est parti du mauvais pied dans tous les camps, à tous les étages.
Sur le fond, de la démographie, au-delà
Un problème général touche pratiquement tous les pays du monde, de la vieillissante Chine à la déjà vieille Europe ou future vieille Amérique du Nord. Une répartition des classes d’âge qui passe de la pyramide mexicaine avec une base très large de jeunes générations et un sommet très rétréci du fait d’une espérance de vie faible, à un parfait cylindre de population stable (autant de jeunes, que d’adultes et de vieillards) voire à une pyramide renversée très malthusienne (très peu de naissances et de plus en plus de vieux vivant de plus en plus longtemps).
Quel que soit le type de système de retraite (par répartition, par capitalisation ou mixte) vous avez un problème structurel destiné à s’aggraver toutes choses égales par ailleurs, car nul nouveau baby-boom (comme celui qui a commencé en France en 1943) ne se profile à l’horizon. Dans un système complètement par capitalisation (chacun épargnant sur son salaire ou ses revenus de quoi payer sa propre retraite) il faut mettre de côté une part croissante de son revenu immédiat pour augmenter son revenu permanent, celui qui comprend aussi le montant de sa retraite.
Dans un système par répartition où le prélèvement par cotisations retraites de la génération active sert à payer directement les retraites de la génération précédente quitte à ce que la génération suivante fasse de même (on a souvent nommé ce système le « pacte de solidarité intergénérationnelle »), le problème apparait plus directement sans les coups de gomme toujours partiels de la capitalisation individuelle où l’inégalité transversale masque l’inégalité longitudinale.
On voit très bien que l’adoption par la France après la Seconde Guerre mondiale du système par répartition ne posait aucun problème car quelle que dût être l’évolution des autres facteurs décisifs (le taux d’emploi et le taux de productivité du travail) l’assurance de générations futures beaucoup plus nombreuses garantissait un financement plus aisé de la protection des retraites. Depuis le retour d’une diminution de l’accroissement naturel de la population (ce qui fut le cas, hors immigration, dans la France de la Belle Époque), le modèle de répartition part avec un handicap net. D’où l’idée des libéraux de réaliser l’ajustement du coût des pensions sur les ressources par une privatisation partielle ou totale des cotisations en les rapprochant des régimes d’assurances complémentaires de retraite. Ce qui n’ôte rien de la perspective inévitable de devoir épargner une part croissante de la richesse créée. L’inconvénient de la solution de la privatisation étant de renforcer les inégalités intra générationnelles.
Le vieillissement de la population, l’allongement de la durée de vie comme celui de la durée de vie en mauvaise santé (morbidité et non plus mortalité), avec par conséquent un alourdissement des dépenses de santé, ont un impact sur le système institutionnel de financement des retraites : que ce soit dans un système bismarckien reposant sur les cotisations sociales payées par les employeurs et les salariés, dans un système beveridgien financé par l’impôt au Royaume-Uni, ou dans des systèmes mixtes (État / Sécurité Sociale / Assurances complémentaires privées) comme en France.
La question est mondiale. Et plus concrètement pour nous, Européens, elle nous concerne particulièrement en raison, d’une part, de notre vieillissement accéléré (l’Allemagne, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie plus encore que la France) et en second lieu, et c’est un aspect totalement oublié par les sympathisants du raisonnement hémiplégique de Rassemblement national, en raison du rôle de rééquilibrage de la natalité que les migrations internationales ont longtemps joué. Tirons-en tout de suite une première leçon : poser le problème du financement des retraites indépendamment d’une réflexion intégrée au sein de l’Union européenne et de sa relation avec les pays qui alimentent sa propre force de travail est absurde.
Dans la course aux âneries généralisées, on remarquera qu’aucun des partenaires sociaux, pas plus que le gouvernement qui n’a pourtant que l’Europe à la bouche, n’a risqué un mot sur la situation européenne, sur l’idée d’un régime de retraite européen. Au lieu de citer l’Union européenne comme un père-fouettard-la-Rigueur (tout le monde à 67 ans, ce qui n’est pas loin d’être le cas de facto), on aurait pu proposer une retraite minimum garantie dans l’Union européenne (une retraite de base fonction du PIB de chaque pays membre, complétée d’un mécanisme redistributif pour les pays les plus pauvres, financé directement à niveau européen), comme pour un salaire minimum ou un revenu de base.
Naturellement, la démographie n’est pas tout, heureusement. Le principal facteur dans la progression des retraites et la possibilité de la financer, y compris pour compenser le facteur démographique, c’est la productivité du travail et en deuxième lieu, mais très loin derrière, le taux d’emploi. Quand la productivité du travail progressait de 5 %, soit un doublement (100 %) en quinze ans, elle était capable d’absorber facilement un choc démographique, une inflation modérée ainsi qu’une revalorisation des retraites.
Dans le cas de progrès de productivité beaucoup plus faibles (entre 0,5 et 1 % par an par exemple, comme c’est le cas de la France), il existe encore des marges de financement quel que soit le système adopté.
Toujours sur le fond : la productivité du travail, parlons-en !
On voit que la question du financement des retraites débouche moins tant sur les comptes d’apothicaires dans lesquels se perdent tant le gouvernement, les cours des comptes spécialisées comme le COR (Conseil d’orientation des retraites) que les syndicats, que sur la question de la productivité réelle du travail et celle non moins fondamentale de la définition du travail.
La première a longtemps reposé sur une version travailliste et socialiste (la valeur travail mesurée par le nombre de salariés ou d’actifs générant un revenu direct) au dénominateur, avec le PIB marchand au numérateur.
C’est cette vision qui est commune à Mélenchon, à Roussel, à Hollande en passant par Sarkozy, Ciotti (espérons que les Verts sont moins bêtes) et ne parlons pas du RN qui en est resté à l’exaltation du travail du national-socialisme. Elle inspire des politiques de maximisation de l’emploi (salariés ou indépendants dépendants du marché). Si la productivité réelle du travail se résume à la productivité apparente de ce dernier, soit le PIB marchand au numérateur et le nombre de « travailleurs » au dénominateur, on est engagé dans une autre course à l’échalote : on élimine les sources de hausses de bien-être et de productivité comme les services non marchands (santé, éducation, recherche publique) et on augmente artificiellement le travail salarié ou dépendant. Donc on dégrade le rapport de la productivité apparente du travail.
Il faudrait à l’inverse comptabiliser un PIB non marchand et le rapporter au travail véritablement productif sur le plan social, par exemple le travail d’élevage de la population comme disent les démographes, celui du care ou soin de cette dernière souvent pris en charge par des bénévoles, qui compte pour du beurre, mais aussi et surtout comme l’écologie logique nous l’enseigne, décompter du travail productif ce qui dans les actifs est improductif pour la planète, la société des humains et celle des vivants. Réviser sévèrement les frontières du travail vraiment productif signifie probablement amputer de la moitié ou d’un bon tiers les effectifs du travail officiellement comptabilisé comme productif.
On conçoit qu’un tel programme qui est le véritable rasoir d’Ockham de la productivité réelle et verte du capital terrifie autant les syndicats que les gouvernements enfermés depuis 40 ans, comme le souligne Philippe Askenazy[1], dans des politiques contradictoires d’austérité publique et de laxisme à l’égard de la rente privée et du domaine des communs numériques, le tout couronné par une politique de promotion de l’emploi à tout prix qui a fabriqué du précariat à une échelle digne d’une « économie de pousse-pousse » avec les Amazon, Uber, Deliveroo. Le tout dans une diminution drastique du périmètre des CDI dans les métiers non cadres, d’externalisation du service public.
Le résultat global pour le marché du travail est connu : accentuation des inégalités au sein des salariés et des travailleurs formellement indépendants, entre les jeunes d’un précariat qui n’ouvre aucun droit à des retraites, à de plein-droits sociaux comme le chômage, le RSA ; creusement des inégalités structurelles entre travailleurs âgés bénéficiant d’une retraite à taux plein et travailleurs qui, s’il partent aujourd’hui à 62 ans et demain à 64 ans, n’auront pas le nombre de semestres suffisants. D’ores et déjà, l’âge moyen des Français qui prennent leur retraite à taux plein est de 67 ans !! La ligne des 62 ans est une vraie ligne Maginot !
De l’anémie des luttes aux cautères sur une jambe de bois
Ne parlons pas de deux facteurs aggravants pour les inégalités de montant des retraites que sont la multiplication depuis plus de dix ans des politiques gouvernementales stupides d’encouragement pervers des entreprises à embaucher des jeunes à tout prix en les exonérant de la part patronale des charges sociales portant sur les cotisations de retraites de sorte que l’État en France doit abonder de la bagatelle de 30 milliards par an le régime des retraites.
Venons-en au pompon du bonnet d’âne, le compromis État/Syndicats/Patronat : devant l’anémie des luttes salariales due à des effectifs squelettiques des syndicats (11 % dans le secteur public, 6 % dans le secteur privé), le système d’augmentation de salaire à l’ancienneté a été adopté comme une solution de pis-aller par les trois partenaires. Sauf qu’avec le vieillissement de la population active, les entreprises, face à la charge considérable de la masse salariale et pour diminuer leurs coûts, ont eu tendance depuis vingt ans à diminuer l’ancienneté moyenne de leur main-d’œuvre en se débarrassant d’elle dès qu’elle a dépassé 55 ans.
Des économistes pour une fois l’ont dit et crié sur tous les toits : réforme inutile tant qu’on n’a pas essayé d’augmenter le taux d’activité effectif des seniors. Cela ne résout pas tous les problèmes en particulier la question du précariat de 18 à 40 ans. Mais cela contribuerait puissamment à éviter un naufrage. Car la conséquence la plus claire a été un taux de chômage de longue durée des seniors de plus en plus élevé donc la multiplication des départs à la retraite sans les 43 années de cotisations, donc trop de retraites faibles complétées par des travaux précaires pour les vieux. In my end is my beginning comme dit T. S. Eliot dans The Waste Land.
Aux deux bouts de la chaîne de l’emploi, le système de répartition est en crise. De sorte que la variable d’âge de départ est complètement surdéterminée et déduite (elle l’aurait été également dans un système de retraite à points voulu par E. Macron en première mouture).
S’étant enferrés dans le piège grossier de l’âge de départ à la retraite comme figure totem de la réforme, gouvernements et syndicats ont refusé d’emprunter les voies d’une réforme possible et acceptable.
Il faut ajouter que la réforme Touraine, en se fixant sur le nombre de semestres de cotisation, s’était déjà largement fourvoyée.
Fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe
Quand la productivité de la population globale est en train de subir une transformation digne d’une nouvelle révolution industrielle (capitalisme cognitif, économie de la connaissance, importance de la productivité globale des facteurs, de tous les facteurs), quel sens y a-t-il à se fonder – comme indicateur de la contribution au bien-être collectif – sur des semestres de travail salarié ou indépendants, comptabilisés de façon aussi fantaisiste, arbitraire, et à visée sottement disciplinaire comme les rodomontades sur l’obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA, comme si on reprenait les bêtises du RMI sans en avoir tiré aucune leçon ?
Ne parlons pas de la déclaration scandaleuse d’un ministre (et non des moindres) qui s’est darmanisé (entendons radicalement dévalué) en dénonçant comme frauduleux les transferts de migrants après une vie de travail en France, vers leur pays d’origine où ils sont retournés vivre. Car la retraite, c’est du salaire différé dont nul ne saurait être privé.
Le fil d’Ariane de ce mauvais labyrinthe où s’est déroulée cette course en sac de pommes de terre à l’ère de l’économie verte et immatérielle, c’était la garantie du revenu universel de base pour les précaires, pour la population dans son ensemble. C’était aussi de mettre fin par une retraite minimum égale pour tous à ce tamisage insupportable du dernier tiers de la vie en ajoutant à la loterie personnelle de la vie professionnelle, qui n’est jamais un long fleuve tranquille, celle du maquis impénétrable des myriades d’administrations des différents systèmes de prise en compte des états de service (dernier salaire, six derniers mois, dix dernières années, vingt meilleures années).
À quand un système d’équivalent de la carte vitale enregistrant toute prestation de service marchand ou pas, de stages de formation payants ou gratuits, venant éventuellement s’ajouter à une retraite minimale d’existence ? Le travail des bénévoles devrait être pris en compte (par exemple en demandant aux associations de bénévoles de verser la part patronale des cotisations retraites). Que dire aussi du travail domestique et maternel alors qu’on a disserté gravement sur l’inégalité entre les salariés des deux sexes?
Tant qu’on ne suivra pas le fil conducteur de la garantie de revenu d’existence de la population dans son ensemble, première dépense et devoir de l’État, au début de la vie, en son milieu et dans son dernier tiers, on fabriquera de nouvelles corporations de plus en plus misérables, de moins en moins unies par un intérêt commun, de moins en moins aptes à s’attaquer au défi de la transformation radicale de l’appareil productif, du travail, de TOUT le travail. Et d’un travail productif pour la planète et le monde commun des humains et des non-humains.
Mesdames et messieurs les Verts, au travail. On ne vous a pas beaucoup entendus (Nupes ou pas, révolutionnaires tout en noir ou pas, en blocs ou en batterie de cuisine ou pas, de gauche « en marche » ou pas). La course à la nullité gouvernementale, syndicale, théorique et politique, ça suffit.
