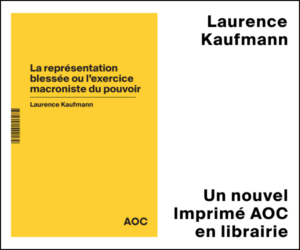Pour des enseignements systématiques sur les enjeux écologiques dans le supérieur
La nécessité d’enseigner les enjeux socio-écologiques de manière systématique dans l’enseignement supérieur est devenue évidente depuis la parution du rapport du think tank The Shift Project en 2019 dans la lignée du Manifeste étudiant pour un réveil écologique.
Très rapidement s’est posée la question de comment instruire simultanément des dizaines de milliers d’étudiant·es. Les établissements et les enseignant·es-chercheur·ses se sont emparé·es de cette question pour expérimenter différentes solutions compte tenu de différentes contraintes : des cours massifs sous forme de vidéos ou à distance qui regroupent des cohortes de plusieurs centaines ou milliers d’étudiant·es, des enseignements optionnels, des enseignements obligatoires inclus dans des mentions plus ou moins disciplinaires, etc. Aucun n’est parfait pour atteindre les objectifs fixés notamment par le rapport Jouzel-Abbadie de février 2022, à savoir former 100 % des étudiant·es de licence d’ici 2027.
La solution en apparence la plus simple, celle de MOOC (Massive open online course – des cours en ligne généralement sous forme de vidéos) ou SPOC (Small private online course) ou d’enseignement à distance qui s’est vu concrétiser pendant la pandémie du Covid-19, pour enseigner à un grand nombre d’étudiant·es avec peu de moyens humains, est à proscrire au maximum : l’enseignement de ces enjeux est susceptible de générer de l’anxiété suite à la prise de conscience de l’état de la planète. Il serait inhumain de laisser les étudiant·es seuls face à eux/elles-mêmes devant ce constat. La présence d’un·e (ou plusieurs) enseignant·e est donc un nécessaire accompagnement. Les enseignements optionnels ne résolvent pas la question de la massification, ils ne touchent qu’une partie des étudiant·es, volontaires.
Une proposition d’application réaliste[1] dans les universités, compte tenu des moyens limités, serait la suivante.
Un cours d’introduction sur les enjeux socio-écologiques peut durer de 20 à 30 h, soit 1 à 2 % du