Le sens de la philosophie ne se réduit pas à créer des concepts
Le mot concept est d’usage dans de nombreux domaines où il prend des significations très différentes. Entre le conatus de Spinoza, la gravitation pour Newton et la même pour Einstein, l’impression pour Monet et la tonalité pour Messiaen, le moins à dire est qu’il s’agit d’usages différents. C’est ce qui avait poussé Deleuze et Guattari à distinguer les percepts et les affects (artistiques et littéraires), les prospects (scientifiques) et les concepts (philosophiques).
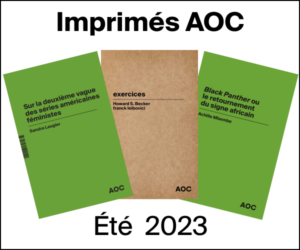
Malgré tout, cette distribution des rôles n’empêche ni les interférences, ni surtout un usage bien ancré du concept dans l’exigence non seulement de définition rigoureuse, cohérente, rationnelle, mais surtout susceptible de vérification contrefactuelle, expérimentale, objective. Ce qui rapproche le concept de son usage scientifique. Sans que son usage philosophique se confonde avec lui, entre autres motifs du fait de son ancrage expérienciel, lié à l’existence humaine, singulière et en commun, qui ne justifie cependant pas, comme le souligne Jocelyn Benoist dans Concepts (éditions du Cerf), sa dissolution dans le « vécu » … Mais alors de quoi est-il question en philosophie ?
L’aptitude aperceptive au « sens de »
Se pose en effet la question récurrente de la place de la philosophie dans l’activité intellectuelle. N’est-elle pas débordée, voire remplacée par les sciences, y compris les sciences humaines et leurs objets respectifs ? La dérive essayiste, psychologisante et moralisante, de la philosophie (du bonheur, des valeurs…) paraît bien en ressortir, confirmée par l’abondance des publications à la rigueur évanescente, hormis les ouvrages universitaires de commentaires des philosophies historiques dont la pertinence dépend précisément de cet ajustement ou pas à l’enjeu incertain de la philosophie. D’un côté, il y aurait les savoirs déterminables avec leurs concepts référés à des objets dans des domaines spécifiés, de l’autre… Quoi ? des non-savoirs indéterminables avec leurs notions sans références… La caricature positiviste de la philosophie se rencontre sur ce point, suscitant au mieux la philosophie analytique comme thérapeutique de son propre langage.
Bien entendu, l’exigence philosophique apparaît tout autre : de traversée des savoirs et des expériences, non pas pour y contribuer par le seul ajout d’un concept, mais par la mise en tension conceptuelle pour donner le sens de la chose même, de ce qui est en question dans nos existences. Le concept « savant » y devient non pas une signification fixe, mais une signifiance qui ouvre à l’aperception du sens de ce qui est en jeu. Image courante de cette expérience humaine du « sens de » qui n’est pas un sens signifié : de l’enfance au vieillissement, le sens de l’équilibre ne se dépare pas du sens du déséquilibre, jamais fixé et acquis, mais qui peut être joué en danse ou même en sport. Et il en va de même lorsque nous disons d’un tableau qu’il témoigne du « sens de la couleur » de l’artiste : ce qui ne veut assurément pas dire qu’il reproduit correctement le prisme des couleurs ou qu’il obéit à on ne sait quelle règle préétablie d’harmonie.
En philosophie, le « sens de » prend alors les sens multiples de l’orientation (« vers la chose même », exigence de Husserl, le phénomène) qui n’est pas une direction, du goût (du savoir comme de l’imprévisible), du talent (d’enquêteur et d’aventurier) et de l’aptitude (à se donner sens par une forme résistant au modèle) qui ne négligent ni les connaissances ni les expériences, mais les mobilisent dans leurs tensions. En travers des concepts et des expériences, la philosophie cherche à donner un sens de la forme du phénomène (les deux sont indiscernables : pas de phénomène dans un monde humain sans langage… au sens des langues et des langages, du logos dans toutes ses implications, logique comprise), de ce qu’il implique sans présumer de sa signification définitive, dans le devenir de la « dépense » humaine (Georges Bataille). Ce mot de « dépense » ne renvoie à aucun calcul, mais à ce que tout sens humain de l’existence excède l’utilité comme la déterminité. Tels apparaissent les sens du désir, de la connaissance, de la création, de la fête et de la guerre, de l’amitié et de l’inimitié, de la justice face à l’inégalité, la servitude et la domination, de la liberté, entre création et destruction…
À quoi s’ajoute que pareil « sens de » met en jeu une forme. Dans Études (Galilée), le phénoménologue Gérard Granel remarquait que toute forme de monde humain transparaît comme forme du perceptible – la lumière, l’ombre, la perspective, le trait, la tâche, l’espacement, le rythme… – et comme forme des existentiaux – « la puissance, la liberté, le désir, la tendresse, la folie, l’être-ensemble, etc. » – . Toutes formes qui ne s’instituent que grâce à un sens de la forme ouverte du monde auquel elles prennent part autant qu’elles lui donnent consistance.
Le sens de la démocratie
L’exemple le plus manifeste de cette démarche philosophique en quête (en question) du « sens de » (de l’aptitude au sens de quelque chose) est donné dans l’expérience démocratique. Les concepts de la théorie politique – comme ceux d’État et de société, de nation, de droits humains, de division des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire, d’information…), d’élection des représentants et des délégués… – et les expériences historiques et subjectives – de révolutions républicaines, démocratiques, dictatoriales et totalitaires, de modes de production et de classes ou de groupes, de soumission volontaire comme de désir (inconscient) et de jouissance entre réel, imaginaire et symbolique… – deviennent des signifiances qui sans cesse remettent en question le ou la politique.
Le sens de la démocratie implique alors la reconnaissance de son phénomène toujours en devenir, des divisions pour les relations, de la tension entre égalité et liberté, de l’écart entre légitimité et efficacité, de la différence du langage et de l’action. Il transparaît de la sorte philosophiquement des formes aperçues du « vide du pouvoir » (pensé par Claude Lefort), de la division du peuple, des équivoques de l’ « égaliberté » (expression forgée par Étienne Balibar), des alternances horizontales et verticales de tout pouvoir et des mises à l’épreuve de tout savoir qui aurait voulu en rendre compte de façon définitive. Et il justifie l’exigence politique décisive de la démocratie, celle de la ré-institution constitutive. Faut-il souligner combien les résistances actuelles des pouvoirs verticaux, arc-boutés sur les élections des représentants et plus encore du représentant présidentiel, ont perdu tout sens de l’alternance aux formes verticales des formes de démocratie horizontale – les formes, toujours renaissantes dans les luttes sociales, des conseils et de leurs conditions de délégation provisoire, limitées et récusables ? Pire encore, ils pervertissent cette exigence, au nom de l’efficacité sans légitimité, empiétant au contraire sur les pouvoirs législatifs et judiciaires tout autant que sur les corps intermédiaires.
Le sens de l’événement
Deleuze et Guattari mettent bien en relation le concept et l’événement dans le devenir. Mais, paradoxalement, multiple et intense, à la fois coupé et inséparé, sans corps, sans référent et sans reprise dialogique d’autres discours, le concept « au sens strict », tel qu’ils le voient, dresse dès lors un événement qu’il s’auto-crée dans une immanence absolue. Ils reconnaissent néanmoins la dépendance de la trinité philosophique – tracer (le plan d’immanence dans le chaos – autre nom du réel), inventer (les personnages conceptuels, tels Socrate) et créer (des concepts par l’entendement – mais encore ne faut-il pas oublier son intrication aux potentialités du langage, savoirs, conflit d’opinions et art de la conversation comprises) – à un « goût » de « co-adaptation » qui accompagne cette activité trinitaire. Mais ce goût (et son envers, le « dégoût » des concepts « répulsifs », telle la race) ne devient un sens de l’événement que si celui-ci est aperçu dans son hétérogénéité qui appelle la traversée philosophique de nos savoirs et de notre (in)expérience.
Le sens de la philosophie n’advient que dans cette appréhension, ni simplement conceptuelle ni simplement expériencielle, de la dépense du « sens » dans l’existence dont la pensée ne se réduit pas au cerveau, à la production ou à la grammaire – art, étude, fête, rire, érôs, action, création, paresse, poésie, joie, fiction… Et leurs envers. Car le sens des formes du monde ne se sépare pas du sens de ses déformations – viols, violences, guerres, injustices, passivités, inégalités, oppressions, fiction… Au risque de l’indétermination, le risque même de notre liberté.
