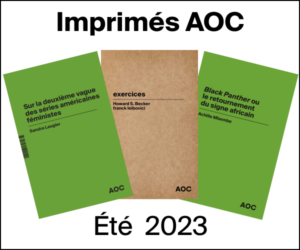Penser l’autonomie des élèves contre l’obsession autoritariste
Pour le nouveau ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal, il semble clair qu’une notion est particulièrement centrale dans sa conception de l’éducation : l’autorité.
Lors de sa nomination ce 20 juillet, il a ainsi promis de « remettre le respect de l’autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l’École ». Ce discours s’inscrit dans le cadrage des « émeutes » de l’été 2023 par le gouvernement : celles-ci seraient le fait de jeunes en manque de repères et d’autorité au niveau de la famille et de l’école. Il trace également un inquiétant parallèle avec les discours d’extrême-droite sur l’école, le programme de Marine Le Pen en 2022 appelant également à « restaurer l’autorité du maître et de l’institution scolaire ». L’extrême-droite et l’extrême-centre se rejoignent également dans la proposition phare pour poursuivre cet objectif : l’uniforme.
Les impasses de l’autorité scolaire
Au-delà du caractère individualiste de ce cadrage, le gouvernement privilégie une conception de l’autorité scolaire qui ambitionne essentiellement l’intériorisation de « valeurs républicaines » par les élèves et s’incarne dans la figure de l’enseignant·e. Sous couvert de « respect », elle attend de l’élève une soumission à des valeurs qu’il doit intégrer sans discussion. L’autorité est ici fondamentalement répressive et orientée vers l’apprentissage d’un modèle de pensée et de comportement (adulte) déjà défini. Elle correspond donc à ce que le chercheur en sciences de l’éducation Bruno Robbes[1] nomme l’autoritarisme.
Plus largement, cette vision s’inscrit dans une conception déficitaire de l’enfant, clairement exposée par Hannah Arendt dans le fameux texte « La crise de l’éducation » (1961) qui inspire encore la pensée conservatrice sur l’éducation de nos jours. Celui-ci est conçu non comme un sujet à part entière, mais comme un objet de développement passif devant avant tout intégrer les valeurs de la société dans laquelle il naît. Toute tentative de conférer de l’autonomie aux enf