Harcèlement scolaire : les risques d’une politique-spectacle
On apprenait par les médias, le 19 septembre dernier, l’interpellation, la veille, en plein cours, au collège Henri-Barbusse d’Alfortville, d’un adolescent de 14 ans suspecté d’être l’auteur d’insultes transphobes et de menaces de mort sur un réseau social. Placé en garde à vue, où il a reconnu les faits, l’adolescent a été déféré au parquet, qui lui a notifié une mesure de réparation pénale. Toujours selon la presse, la victime est une adolescente de 15 ans en transition de genre, scolarisée dans le lycée Maximilien-Perret d’Alfortville.
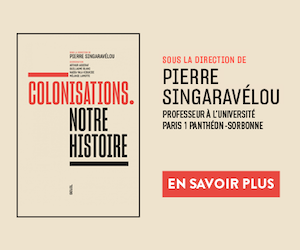
Si l’on a peu de recul sur les événements, leur contexte, leur histoire et leur déroulement factuel, on dispose néanmoins à travers la médiatisation d’un ensemble d’informations, qui conduit à s’interroger, à travers ses choix de mise en scène, sur les ressorts et le sens de cette « affaire » : dans cette opération spectaculaire, que révèle le casting ? Et à quoi ou à qui s’agit-il d’envoyer quel message ? Replacé dans le contexte des politiques scolaires et de la communication ministérielle, cet épisode peut faire craindre à la fois une régression sécuritaire et une racialisation des problèmes scolaires, notamment concernant la stratégie ministérielle en matière de lutte contre le « harcèlement ».
Le choix du cadrage : une question de « harcèlement scolaire » ?
La situation a été opportunément présentée par le gouvernement comme une question de « harcèlement scolaire ». Opportunément, car selon les médias le ministre de l’Éducation Nationale, Gabriel Attal, serait « sous pression depuis les révélations samedi [dernier] du « courrier de la honte » ». L’expression, forgée par quelques médias spécialisés dans la mise en polémique, vise un autre drame survenu à Poissy, révélé une dizaine de jours plus tôt : celui d’un adolescent qui avait « fait état de brimades et d’injures répétées de la part de plusieurs élèves » et a fini par se suicider. Suite à quoi l’on a appris que, en réponse aux pressions des parents qui menaçaient
