La tyrannie de l’histoire –storytelling (1/2)
Dans ses éditions des 10 et 17 juillet 2023, le New Yorker a publié un essai passionnant sur le storytelling sous le titre : « La tyrannie de l’histoire » (« The Tyranny of the Tale »). Le chapeau de l’article en donne le ton « On nous dit que l’histoire nous libérera.
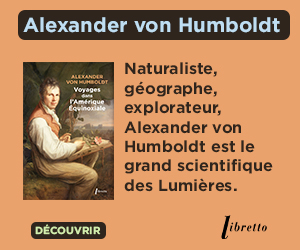
Mais si le format narratif était aussi une cage ? » Cette critique ne peut que réjouir l’auteur de ces lignes qui a apporté il y a quinze ans sa pierre à la critique du storytelling. Mais que cette critique trouve un écho dans les pages du New Yorker, qui est considéré comme le temple du journalisme narratif, voilà qui est plus étonnant et constitue en soi un évènement.
Parul Sehgal, l’autrice de l’article, définit ainsi (et non sans ironie) le champ de son analyse : « Le « storytelling » – tel qu’il est actuellement déployé de manière confuse – : comprend la fiction (mais aussi la non-fiction). C’est le royaume de la fantaisie ludique (mais aussi le mortier même de l’identité et de la communauté) ; il piège (et libère) ; il définit (et obscurcit). Le marqueur le plus fiable est peut-être ce petit halo qu’il a pris l’habitude de brandir au-dessus de sa propre tête, son aura insistante de piété. La narration est ce qui sauvera le royaume ; nous sommes tous des Shéhérazade désormais ».
Depuis les années 2000, le storytelling s’est répandu comme une trainée de poudre ; il est apparu comme une recette miracle pour convaincre, communiquer, résoudre les crises, construire son image et son identité. Cette nouvelle méthode de communication basée sur le récit est devenue un moyen de séduire et d’influencer un public, des électeurs, des clients. Mais aussi : partager des informations, configurer des pratiques, des savoir-faire. Formaliser des contenus, formater des discours, transmettre une expérience sur les réseaux sociaux.
Loin d’être une simple technique de communication, le storytelling s’est hissé au rang d’un véritable paradigme narratif qui s’impose à tous à l’exclusion de toute autre forme de
