Le droit d’être adulte
En 2021, l’ONU épingle l’État français pour non-respect du droit des personnes handicapées. Le 17 avril 2023, le CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux) enfonce le clou[1] en réagissant à la réclamation portée par plusieurs associations et admet que l’État viole certains articles de la Charte sociale européenne, notamment l’article 15.3 « en raison du manquement des autorités à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable » concernant l’accès aux services d’aide sociale et aux aides financières ou encore le développement d’une politique visant à promouvoir l’intégration sociale des personnes handicapées.
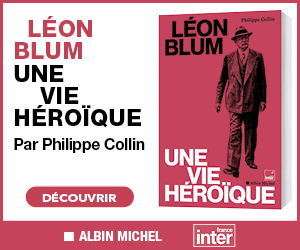
Un manque de solutions pour les adultes, des existences souterraines
Aujourd’hui, en France, de nombreux adultes handicapés mentaux autistes, polyhandicapés, ou trisomiques avec des troubles du comportements demeurent sans solution de prise en charge adaptée. Ils vivent chez un proche (un parent, un frère ou une sœur) ou sont hébergés et accompagnés loin du domicile familial, dans un autre département ou encore en Belgique. Au 31 décembre 2019, 8 233 personnes en situation de handicap (6 820 adultes et 1 413 enfants) étaient ainsi prises en charge dans 227 établissements wallons (chiffres handicap.gouv). Si depuis janvier 2021, l’État a suspendu les nouveaux départs en dehors du territoire et s’est engagé à développer des réponses « de proximité », les solutions concrètes se font attendre.
La centrifugeuse étatique répartit les adultes handicapés en fonction de leur degré d’autonomie. Celles et ceux qui peuvent travailler le font en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) dans le milieu dit « protégé » et sont hébergés en foyer d’hébergement (FH). Celles et ceux qui ont besoin de soins et d’une aide dans tous les actes de la vie quotidienne peuvent obtenir une place en foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou en maison d’accueil spécialisée (MAS). Enfin, les foyers de vie (FV) ou foyers occupationnels (FO)[2] accueillent les personnes qui ne peuvent pas travailler et n’ont pas besoin de soins.
Tous les adultes n’ont pas accès à ce type de structures du fait d’une inégalité territoriale durable de l’offre médico-sociale. Des départements, notamment ruraux, sont particulièrement bien pourvus du fait d’héritages historiques (Lozère, Corrèze, Creuse) tandis que d’autres ne proposent pas assez de places au regard des besoins (les départements franciliens par exemple)[3]. La difficulté à accéder à une réponse appropriée s’explique aussi par un engorgement de certains établissements médico-sociaux, à l’instar des ESAT dont la population accueillie change.
Les ESAT embauchent de plus en plus de personnes avec des difficultés sociales (grande précarité, carence affective dans l’enfance, etc.) qui ne parviennent pas à trouver un emploi dans le monde du travail « ordinaire ». Ces personnes devancent les ouvriers handicapés qui tiennent moins la cadence (certaines personnes trisomiques ou encore autistes) dans un contexte où le travail protégé n’échappe pas à la course à la productivité et à la rentabilité[4].
À ces problèmes structurels s’ajoute la difficulté des familles à avoir recours à leurs droits. Les proches sont mal accompagnés si bien qu’ils deviennent par la force des choses « spécialistes par obligation »[5], aussi bien de l’accompagnement concret du handicap que du champ médico-social. Pour sortir de structures spécialisées destinées aux enfants, les familles doivent obtenir une notification de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ce qui prend plus ou moins de temps selon le département. Les parents doivent ensuite démarcher eux-mêmes les associations médico-sociales et les établissements pour adultes ce qui demande une connaissance du champ mais aussi une connaissance de la géographie de l’offre locale. Ce démarchage inclut appels téléphoniques, visites et constitutions de dossiers.
Face à ce qui s’apparente à l’ascension de l’Everest, nombreuses sont les familles qui abandonnent la quête, a fortiori lorsqu’elles sont en situation de précarité et d’isolement, qu’elles ne maîtrisent pas bien la langue française ou ne possèdent pas de réseau d’interconnaissance dans le champ associatif.
Une politique d’inclusion par l’habitat qui ignore les personnes les moins autonomes
Depuis les années 2000-2010, l’État ne finance plus la création de structures médico-sociales et a pour objectif de transformer l’offre existante pour la rendre plus inclusive. L’idée est de proposer des lieux d’hébergement intégrés à la cité en opposition aux structures spécialisées considérées comme ségrégatives. Derrière l’expression « transformation de l’offre », l’État amalgame en fait deux réalités qu’il convient de démêler.
En France, quelques solutions d’habitats inclusifs[6] émergent. Celles-ci sont financées par l’État et prennent la forme de colocations ou d’appartements supervisés situés dans les centres des villes. La particularité de l’« habitat inclusif » est qu’il se développe en dehors du champ médico-social et relève du droit commun. De fait, « il s’agit de formes d’habitat qui rompent avec les prises en charge soumise à « décision d’orientation » [de la MDPH] : les personnes sont locataires, ou sous-locataires d’un lieu de résidence qu’elles occupent librement »[7].
Cette dynamique de création d’habitats inclusifs, si elle parait porteuse, se heurte à plusieurs limites. La première est la complexité administrative qu’il faut affronter pour mener un projet d’habitat inclusif à son terme. Le travail d’élaboration et de recherche de logements vacants dans le parc social et privé échoit aux parents et aux associations. Ils doivent convaincre les collectivités du territoire concerné de valider le projet qu’ils ont construit, ce qui prend souvent des années. L’État n’intervient que dans un dernier temps pour financer l’accompagnement quotidien des personnes (fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et des ARS).
La deuxième limite est la modalité de gouvernance de ce type de projet. Si l’élaboration part du terrain et des associations (logique bottom-up), la démarche vient renforcer les inégalités existantes. De fait, toutes les familles n’ont pas les ressources pour élaborer de tels projets ou s’y greffer. Les personnes handicapées mentales n’ont donc pas les mêmes chances d’accéder à ce type d’habitat. Enfin, ces solutions s’adressent aujourd’hui en majorité aux personnes autonomes. Les personnes plus vulnérables qui sollicitent une aide importante au quotidien restent en marge de la dynamique.
À côté de l’élaboration de cette politique parallèle, la transformation de l’offre médico-sociale stricto sensu – soit le passage de places en établissements avec une forte dimension collective à des petites unités de vie en centre-ville – est très lente. Plusieurs associations médico-sociales gèrent des appartements supervisés pour les ouvriers d’ESAT mais rares sont celles qui s’engagent dans la création de micro foyers de vie ou d’unités de MAS ou FAM incluses dans les pôles urbains.
La transformation de l’offre médico-sociale dépend en partie des départements qui ont la tutelle du volet hébergement de la prise en charge, ce qui explique de grandes disparités territoriales. Certains conseils départementaux développent un réel intérêt pour des formes d’accompagnement plus inclusives tandis que d’autres peinent à établir des lignes politiques claires sur le sujet. La lecture de certains schémas départementaux de l’autonomie montre d’ailleurs une grande méconnaissance de la question du handicap dans certaines collectivités et au demeurant une absence totale de consultation des personnes concernées.
Plus globalement, les changements organisationnels et structurels du champ médico-social impulsés par l’État vont à l’encontre de l’émergence de formes d’habitats inclusifs ou de microstructures pour les personnes les plus vulnérables. Depuis quelques années, l’État accélère au contraire les fusions associatives sous couvert d’économies d’échelles, ce qui met à mal l’existence d’initiatives d’accueil à taille humaine[8].
En France, la démarche de désinstitutionalisation ou sortie des institutions, semble se faire « par touches » et non de façon globale comme c’est le cas dans d’autres pays européens comme en Finlande, en Irlande ou encore en Italie, pays qui ont amorcé une véritable transition en la matière[9]. Sans avoir été pensée avec tous les acteurs du champ médico-social du handicap, la désinstitutionalisation à la française est un processus à deux vitesses qui ne dit pas son nom, avec d’un côté, la création déléguée aux associations de solutions d’habitat de droit commun pour les personnes les plus autonomes (financées par l’État et les ARS via des fonds spécifiques), et, de l’autre, le maintien des plus vulnérables en institutions sans réelle transformation de l’offre (toujours sous la tutelle des conseils départementaux et des ARS).
Du domicile familial comme lieu de vie exclusif à l’exclusion de la société
Le ralentissement de la création de nouvelles places d’accueil en structures spécialisées a pour corollaire le développement de services médico-sociaux qui s’apparentent à des services d’accompagnement en ambulatoire (en dehors des établissements). Cette politique est adaptée aux besoins des personnes autonomes mais renforce l’isolement des plus dépendantes et transforme le domicile familial en un lieu de vie unique et exclusif.
Pour les travailleurs d’ESAT et les personnes les plus autonomes, la « démarche service » s’incarne dans le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ou encore le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), tous deux matérialisés par des bureaux externalisés en centre-ville où ils peuvent recevoir des soins ou encore une aide administrative.
Pour les personnes les plus fragiles et sans solution d’hébergement qui sont au domicile de leurs proches, la « démarche service » prend la forme de la venue d’un éducateur quelques heures par semaine. Si ce soutien ponctuel permet à la famille de trouver un peu de répit, il ne s’agit pas d’une solution pérenne. Les liens qui unissent la personne handicapée à ses proches sont essentiellement réduits aux soins et à l’accompagnement, faisant de ceux-ci des liens quasi professionnels. Au-delà de la transformation des rapports familiaux, le maintien de la personne handicapée au domicile d’un proche (et donc pas chez elle) tend à l’exclure un peu plus, ainsi que son entourage, de la communauté.
L’État français mise sur la solidarité familiale pour accompagner les personnes les plus vulnérables. En proposant des « solutions » qui s’apparentent plus à des pansements (quelques heures de présence d’un éducateur, un week-end en structure de répit) pour que l’entourage tienne le reste du temps, et en maintenant le care dans la sphère privée, l’État nie la vulnérabilité des familles (détresse, fatigue, vieillissement).
Au-delà de l’absence criante de solutions, c’est l’absence de réflexion autour des parcours de vie des adultes handicapés mentaux qui interpelle. Si les politiques publiques se développent autour de l’enfance (école inclusive) ou encore du vieillissement (création de foyers à destination de travailleurs d’ESAT retraités), l’âge adulte en tant qu’âge intermédiaire est absent des calendriers politiques. Une fois dans une structure destinée aux adultes, la personne est considérée comme « casée » et poursuit le cours de sa vie au même endroit. Son avenir est étudié à date fixe lors de l’évaluation de son « projet d’accompagnement personnalisé » (PAP), rendez-vous annuel qui semble d’ailleurs obsolète (quand il a lieu), tant les rythmes et besoins des personnes peuvent changer rapidement.
En somme, il est temps de dépasser la vision réductrice qui veut que les personnes handicapées mentales passent directement de l’enfance à la vieillesse (et à la mort). Par son absence d’engagement, l’État participe à la négation d’un droit fondamental, celui pour les personnes handicapées mentales de prétendre à une vie digne[11] et de pouvoir choisir leur lieu de vie.
