Invisibles mosquées de France
Étrangère. C’est ainsi que l’Islam fait, depuis toujours, partie de l’Histoire de France. Des croisades aux colonies d’Afrique du Nord, l’identité française s’est construite en contrepoint d’une religion perçue dans sa différence fondamentale, incarnation de l’autre.
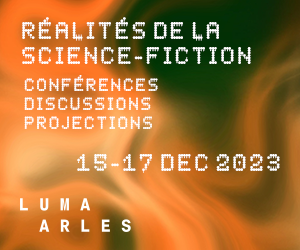
On compterait aujourd’hui près de cinq millions de citoyen.nes musulman.nes en France. Pour cette communauté, l’accès à des lieux de culte est une nécessité ordinaire, relevant du quotidien. Mais pour l’État français, leur gestion relève du ministère de l’Intérieur et de son bureau central des cultes.
Le nombre et la capacité des mosquées françaises sont notoirement sous-dimensionnés[1]. Leur construction reste un processus long et difficile, dans le contexte si particulier de la pratique des religions en France et des restrictions concernant leur financement public. L’imaginaire même des fidèles reste tributaire des lieux d’origine des parcours d’immigration, consolidant l’image d’un Islam étranger au paysage national. Pour l’architecte, le constat est d’autant plus amer qu’il relève de l’évidence : l’architecture publique des mosquées françaises ne reflète ni la diversité de la communauté musulmane française, ni ses besoins.
Les mosquées les plus visibles du pays transposent en France les codes de l’architecture islamique d’Afrique du Nord. C’est le cas, par exemple, de la Grande Mosquée de Paris, ou de celle de Strasbourg. Les débats entourant cette architecture et la nature exacte des éléments censés la caractériser se focalisent d’ordinaire sur sa capacité à s’intégrer au paysage national. L’Islam étant perçue comme étrangère, la visibilité de ses fidèles vient heurter la plupart des discours politiques.
La visibilité de la prière, celle de la religion peut-être, sont présentées au public comme l’échec d’un processus d’intégration. En particulier, les responsables locaux semblent partager l’objectif de réduire la visibilité de la prière musulmane, privilégiant l’établissement de « salles de prière » discrètes à la construction de bâtiments de capacité suffisante. En conséquence, les fidèles sont parfois contraint.es d’utiliser la rue comme espace de pratique, fournissant des arguments supplémentaires aux critiques d’un supposé problème de visibilité. Ainsi posée, la question des lieux du culte musulman en France occulte systématiquement la question des besoins et des usages, tant des communautés musulmanes que des villes françaises dans leur ensemble.
Des lieux sous tension
Un projet de mosquée en France représente davantage que la simple construction d’un bâtiment. Il s’agit de surmonter un contexte politique qui, par essence, lui est fondamentalement hostile.
Depuis l’époque coloniale, la religion musulmane constitue un enjeu de contrôle stratégique pour l’État français. Si la loi de 1905 consacre le principe de laïcité en métropole, celle-ci n’est pas appliquée dans les trois départements clés de l’Algérie française, où la République encourage explicitement une pratique « officielle » de l’Islam[2]. Imposée d’en haut par des fonctionnaires coloniaux peu au fait des populations qu’ils contrôlent[3], celle-ci ne s’enracine pas dans la société algérienne.
Après-guerre, lorsque le recours massif à l’immigration entraîne des millions de musulmans à s’installer sur le territoire métropolitain, ceux-ci y importent un Islam populaire, pratiqué de manière marginale et autonome. Vingt-cinq ans après l’inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926, les premières salles de prière sont créées par les travailleurs eux-mêmes en marge des villes, dans les usines, lieux de travail ou d’hébergement des migrants.
Deuxième religion du pays, bien que perçue depuis des siècles comme antithétique de la civilisation française, l’Islam est également celle à laquelle l’appartenance est la plus visible : population majoritairement racisée, tenues parfois distinctives des fidèles, communautés rassemblées dans des espaces urbains ségrégués par l’urbanisme d’après-guerre. Dans ce contexte, les manifestations visibles – ou audibles – de la foi islamique, comme les activités et les esthétiques plus largement associées à la culture « arabe », sont perçues comme les indicateurs d’une menace sécuritaire généralisée. Les mosquées en sont le point focal, symboles physiques d’une religion perçue comme une menace, soupçonnée de « radicalisme », de « communautarisme » et d’écarts aux valeurs laïques de la République.
La pratique des religions en France reste aujourd’hui subordonnée aux intérêts de l’État. Si la loi de 1905 garantit également la liberté de culte et le droit d’établir des lieux de prière, elle conditionne ces libertés à son contrôle. Espaces accueillant du public, les lieux de culte musulmans sont soumis aux normes administratives de sécurité et d’aménagement, ainsi qu’à la menace toujours possible d’un arrêté de fermeture.
Espaces rares et presque toujours sous-dimensionnés, leur contexte les rend d’autant plus vulnérables que la religion qu’ils accueillent est a priori suspecte. Parfois improvisées, souvent précaires, les salles de prière musulmanes échouent régulièrement aux inspections de sécurité administratives. Quant aux fidèles, le manque de capacité d’accueil les contraint parfois à déborder sur la rue, ce qui peut perturber le fonctionnement normal de la ville et justifier la présence croissante de la police à proximité des lieux de culte. La ville entière partage ainsi le double problème de la rareté et de la capacité des mosquées, sans jamais y apporter de réponse structurelle.
La Grande Mosquée de Paris
Inaugurée le 16 juillet 1926 en présence du président Gaston Doumergue et du sultan du Maroc Moulay Youssef, la Grande Mosquée de Paris est encore aujourd’hui la plus importante de France, et probablement la seule qui incarne un projet architectural distinctif. Elle occupe une vaste parcelle dans le cinquième arrondissement de Paris, à côté du Jardin des plantes. Construit dans un style hispano-mauresque par Maurice Tranchant de Lunel, architecte des monuments historiques au Maroc durant l’occupation française, le bâtiment peut accueillir un millier de personnes sur plus de 7 000 mètres carrés. Il comporte un minaret de trente-trois mètres de haut, une salle de prière, une madrassa (école coranique), une bibliothèque, une salle de conférence, de vastes jardins, un restaurant, un salon de thé, un hammam et des boutiques.
En raison de son architecture, la Grande Mosquée de Paris est relativement contradictoire de la stratégie d’assimilation à la française. Pour Gilles Kepel, le bâtiment constitue le point de départ d’un paradigme national, la transformation progressive de « l’Islam en France » en un « Islam de France »[4]. L’inauguration du bâtiment incarne un compromis architectural et politique, aboutissement de près d’un siècle de projets sans suites.
Dès 1842, un premier projet propose de construire une mosquée dans le quartier Beaujon, au nord-ouest de la capitale. Un autre est envisagé sur le quai d’Orsay en 1847, et un autre encore autour des années 1880, en annexe de l’ambassade du Maroc à Paris[5]. C’est la déflagration de la Première Guerre mondiale, et les 100 000 combattants musulmans morts pour la France, qui finissent par convaincre les autorités françaises du bien-fondé de l’initiative.
Projet parisien, la Grande Mosquée n’est pourtant pas une mosquée française. Le béton armé en est le matériau principal, mais sa conception mélange plutôt les styles traditionnels du Maghreb – almohade et ibéro-andalou, spécifiquement. Son esthétique est une transposition directe de celle de la mosquée El-Qaraouiyyîn de Fès, l’une des plus anciennes mosquées du monde et des plus connues au Maroc.
La plupart de ses décorations sont d’importation marocaine, notamment les carreaux de mosaïque zelliges, fabriqués par des artisans de Fès et de Meknès à partir de matériaux traditionnels. Le minaret lui-même s’inspirerait de la mosquée Zitouna, en Tunisie, de style almohade[6]. Aujourd’hui, le lieu est plus connu pour son thé à la menthe fraîche que pour ses espaces de prière. Les choix effectués dans sa conception, notamment l’extraction directe de caractéristiques architecturales des colonies françaises d’Afrique du Nord, confirment l’idée d’une mosquée fondamentalement étrangère à l’identité nationale française.
Les mosquées invisibles de Bordeaux
Les mosquées de France sont rares. Elles sont surtout invisibles. Loin de la capitale, force est de constater que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L’agglomération bordelaise compte près de 800 000 habitant.es, dont quelques 50 000 fidèles de confession musulmane. Rien, pourtant, ne permet de distinguer leur présence dans le paysage urbain. Dans la septième ville de France, on ne trouve que six petites mosquées, pouvant accueillir au total moins de six mille personnes. En comparaison, une ville comme Marseille, qui en compte dix fois plus, peine à accueillir confortablement les 200 000 membres de sa communauté musulmane.
Pour la plupart, ces mosquées s’insèrent dans des bâtiments existants, sans qu’aucun élément n’indique leur fonction ou leur qualité d’espaces sacrés. Dans le centre-ville historique, près de la basilique Saint-Michel, la seule indication de la mosquée Nour El Mohamadi est une bannière en plastique, qui semble aussi temporaire et précaire que le bâtiment qu’elle signale. Dans les banlieues est, la « Grande Mosquée » de Cenon, d’une superficie d’à peine 300 mètres carrés, occupe un immeuble de seulement trois étages, plus petit que les bâtiments résidentiels qui l’entourent. Au nord, la « Mosquée du Grand Parc » s’insère dans une tour résidentielle comme il en existe tant dans les banlieues françaises. Elle y occupe une partie du rez-de-chaussée habituellement dévolue aux commerces de proximité (snack, salon de coiffure…) typiques des quartiers populaires.
Cette invisibilité générale est peut-être le résultat du principe de la laïcité française, qui interdisent à l’État de financer la construction de nouveaux bâtiments religieux. En conséquence, la majorité des mosquées de France sont soutenues par des campagnes de dons, récoltés au cours d’un processus long et précaire. Leur construction est à l’initiative des communautés locales, commanditaires le plus souvent dépourvus d’expérience et de moyens, manquant à la fois des compétences et des qualifications indispensables aux projets architecturaux de ce type.
On attend des musulman.nes qu’ielles pratiquent leur foi dans l’intimité de ces bâtiments, même lorsque les murs peinent à les accueillir. Au début de l’année 2023, la Grande Mosquée du Parc demande ainsi à la commune l’autorisation d’installer des bâches sur son parking, pour protéger les fidèles de la pluie anticipée durant les prières nocturnes du Ramadan. La demande est refusée. La mosquée est pourtant nettement sous-dimensionnée : en temps normal, plus de 1 500 personnes assistent à la prière du vendredi, dans un espace prévu pour 300.
Pendant le Ramadan, la plupart des fidèles sont forcé.es de prier sur le parking. Rien n’y fait. Laurent Guillemin, adjoint au maire de Bordeaux, déclare que la mosquée a « répondu [au] problème de surpopulation par une extension en extérieur, ce qui n’est pas la bonne réponse »[7]. Pas d’informations, en revanche, sur ce qui constituerait une bonne réponse.
Lorsque les mosquées parviennent à s’étendre, c’est aussi discrètement que possible. La Grande Mosquée de Cenon, qui compte une communauté similaire à celle du Grand Parc (plus de 1 000 personnes les vendredi), a entamé des travaux d’extension pour doubler sa surface en 2019, pour atteindre 600 mètres carrés[8]. Cette extension restera invisible depuis la rue : la mosquée s’étendra vers l’arrière de son terrain, en y ajoutant des salles de classe, une bibliothèque et une salle de conférence. En l’absence de subventions, la collecte de fonds est toujours en cours. Quatre ans plus tard, 186 000 euros ont été récoltés auprès de la communauté, sur un budget total d’un million d’euros. Il est probable que les travaux se poursuivent encore longtemps.
En mars 2005, le conseil municipal votait la création d’une Grande Mosquée de Bordeaux, grâce à laquelle la Fédération Musulmane de Gironde espérait pouvoir accueillir 5 000 personnes supplémentaires, doublant presque la capacité d’accueil régionale. Sur une superficie de 12 000 mètres carrés, la future Grande Mosquée prévoyait un lieu de prière, des salles de classe, une bibliothèque, un restaurant et des salles d’exposition, l’espace de prière n’occupant que 20 % de la surface totale. L’agence d’architecture portugaise Aires Mateus remportait le concours, en collaboration avec l’architecte français Martin Duplantier et la paysagiste Anouk Debarre. Le projet proposait une vision intéressante, loin du pastiche, en s’orientant vers une interprétation plus abstraite d’un lieu de culte. Le budget de construction était estimé à 24 millions d’euros.
En septembre 2014, les travaux n’avaient pas encore commencé. Le conseil municipal annonçait que la future Grande Mosquée de Bordeaux ne sera pas située, comme initialement prévu, dans le quartier résidentiel de Benauge : les riverain.nes s’étaient plaint.es de possibles perturbations sur la circulation et les espaces de stationnement. Un nouvel emplacement était négocié avec les représentant.es de la communauté musulmane locale. On proposait alors une parcelle sur la zone industrielle du quai de la Souys sur la rive droite de la Garonne, dans le cadre du projet de régénération urbaine Euratlantique.
En 2015, une enquête de Mediapart révélait que le projet constituait un « problème trop sensible pour les élus », que le changement de localisation ne semblait pas résoudre. Enfin, en 2016, une décision finale semblait être prise par Alain Juppé, alors maire et figure tutélaire de la ville. L’ancien premier ministre déclarait : « cette mosquée n’existe pas et n’existera pas ». Sept ans plus tard, le projet est toujours au point mort.
Pour vivre heureux.ses, ne vivons plus caché.es
Les mosquées françaises subissent aujourd’hui un déni d’architecture. Un déni de leur capacité d’invention, de leur visibilité, de leur existence. Sans subvention, sans capital et confrontées à une quasi-interdiction de constructions à la fois nouvelles et ambitieuses, la communauté musulmane française doit se battre pour préserver ses espaces de l’atrophie.
Pourtant l’architecture est une opportunité. Par la cristallisation des usages, des flux, des exigences techniques et réglementaires, des désirs et des climats, c’est une discipline de l’équilibre, du dialogue, du consensus. Le sacré offre un médium extraordinaire d’expansion au-delà d’une expression matérielle, pour porter l’invisible, pour faire communauté. Son appauvrissement est une perte pour nos villes. Face au rendez-vous manqué du vivre-ensemble, on ne peut que s’interroger : la première mosquée française, c’est pour quand ?
NB : Cet article a été précédemment publié en anglais dans le cadre de la série In Common, commandée par arc en rêve, centre d’architecture, en collaboration avec e-flux Architecture, le College of Architecture, Design and the Arts de l’université de l’Illinois et la Biennale d’architecture de Chicago.
