Écologie radicale dans les organisations
A propos des mouvements écologistes contestataires, le grand sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) rappelait ce paradoxe : il est étonnant de lutter pour un objectif valable pour tous en s’attaquant à certaines composantes de la société.
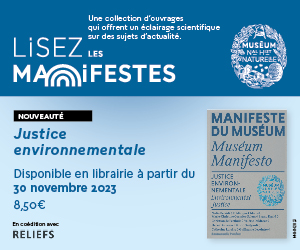
Ou, dans une autre version : la protestation écologiste consiste à lutter pour préserver l’avenir de la société mais comme si elle choisissait pour cela de se situer à l’extérieur de la société. L’engagement climatique, et le choix de certaines actions radicales, nous remettent aujourd’hui devant un problème théorique qui n’a pas changé. Personne au sein de la société, pas plus un secteur d’activité particulier qu’un groupe de militants, ne peut prétendre prendre pour tous la responsabilité du destin climatique de la planète.
Si on garde cette référence théorique en tête, on peut comprendre que le moyen de la contourner soit, comme le voudrait Andréas Malm (Comment saboter un pipe-line), de politiser enfin la lutte climatique. Pourquoi cette notion de politisation paraît-elle judicieuse ? Parce qu’elle fait d’un clivage interne à la société la forme que prend le combat pour l’environnement planétaire. Il ne s’agit pas seulement d’en appeler à la réduction des émissions de GES en invoquant l’éco-conscience de chacun. L’action climatique politisée devient un combat contre des ennemis et contre des responsables. Les cibles sont claires : ceux qui émettent le plus de GES et ceux qui continuent à investir dans le capitalisme fossile.
Les actions politisées gagnent aussi une certaine cohérence. On ne se contente plus de maculer une toile prestigieuse dans un musée ni de stopper une course cycliste, dans le but d’augmenter le niveau de l’alerte. L’action politisée perturbe matériellement le business as usual, par exemple en dégonflant les pneus des SUV ou en sabotant un pipe-line.
Évidemment, ce qui rappelle l’intérêt de la théorie de Luhmann, la politisation climatique produit ses propres paradoxes dès qu’il s’agit de désigner les coupables. Les riches émettent incroyablement plus d’émissions de gaz à effet de serre, c’est un fait. Mais les Chinois ou les Américains, dans leur ensemble, sont aussi responsables des plus grosses quantités mondiales d’émissions de gaz à effet de serre. On peut en vouloir aux quelques riches qui passent leur vie dans des jets privés. Mais que penser des millions de touristes qui, pour des centaines d’euros, se font le plaisir d’un voyage en avion à l’autre bout du monde, en dépit de ce qu’ils savent du changement climatique ?
En fait, la politisation climatique présuppose un premier jugement politique, et moral, sur la différenciation sociale. Le changement climatique est à la fois l’effet, le révélateur et l’amplificateur des injustices sociales qui caractérisent le capitalisme fossile. En détournant les yeux du seul thermomètre climatique, dont on attend désespérément qu’il convainque tout le monde de manière rationnelle, pour lui substituer la revendication d’une valeur (la justice), la politisation climatique ne renouvelle pas seulement une dispute à propos de ce qu’est la justice sociale, elle encombre en outre son souci de radicalité pratique d’une casuistique inévitable : pourquoi toucher quelques propriétaires de SUV (en Suède ou à Paris) et non les autres ? En sabotant une infrastructure pétrolière, ne menace-t-on pas aussi, même temporairement, l’emploi de personnes qui ne sont pas des riches ? Comme l’ont montré les grèves dans les raffineries françaises, toute perturbation dans la distribution de l’énergie n’a-t-elle pas des impacts que peuvent considérer comme injustes ceux qui les subissent dans leur vie quotidienne ?
La politisation climatique rencontre de plus le même problème que toute politisation radicale. Tant que l’action peut présenter la forme d’un combat, elle se nourrit d’une polarisation légitime : il y a ceux – et nous n’en sommes justement pas – qui continuent à émettre sans vergogne, c’est-à-dire sans égard pour la vie des autres, les quantités de gaz à effet de serre dont ils tirent profit. Mais, si elle ne doit pas simultanément se nourrir de son impuissance, la politisation climatique doit être en mesure de dessiner les contours d’une promesse. Elle doit être en mesure de dire à quoi ressemblera une société, et plus précisément « toute une société », qui aurait atteint le « zéro carbone ».
Or c’est précisément ce que personne n’est capable de dire, sinon (retour à Luhmann) d’un point de vue qui est extérieur à la société et qui est, généralement, celui du sujet moral. Il est toujours facile, et sans doute utile, de répéter qu’on ne déviera pas de notre trajectoire climatique actuelle, déjà catastrophique, sans sortir du capitalisme. Qui sait cependant aujourd’hui à quoi ressemblerait « une sortie du capitalisme » – « ce monde d’après » que tout le monde s’est empressé d’oublier dès que le covid a relâché son étreinte. L’idée de révolution, dont Andréas Malm déplore la disparition, peut-elle vraiment nous servir d’idéal régulateur pour nous orienter dans cette situation ?
La politisation climatique accroche la lutte climatique à une cible interne à la société. C’est une façon de déplacer le paradoxe que Luhmann soulignait. Le paradoxe n’en est pas supprimé pour autant. Comment changer toute une société (sortir du capitalisme pour freiner le changement climatique !) en faisant porter l’action sur les seuls « coupables climatiques » ?
Dans la réflexion sur les objets ou sur les lieux sociaux auxquels on devrait arrimer une action climatique, il est très peu question des organisations. Certes, les organisations (entreprises, collectivités, administrations, associations) font l’objet d’une comptabilité environnementale (bilan gaz à effet de serre, empreinte écologique) qui est obligatoire pour les plus importantes. Elles se dotent de plans d’actions, de stratégies, de programmations qui visent à réduire les émissions de GES issues de leurs activités. La politisation climatique dénonce à juste titre l’irresponsabilité ou le cynisme de certaines banques, de certaines entreprises. Ce ne sont pourtant pas les organisations en tant que telles qui sont ici dans le viseur mais des organisations de « riches » ou des organisations que leurs dirigeants « capitalistes » mobilisent pour l’exploitation des énergies fossiles.
Or, à la façon dont on privilégie politiquement la cible des « riches », on pourrait socialement se focaliser sur l’empreinte climatique des organisations. C’est là que les résultats les plus importants devraient pouvoir être attendus. Pourquoi ne pas en faire l’objectif numéro 1 de l’action climatique ? Cela garantirait un effet de levier extraordinaire par rapport à toutes les campagnes qui s’adressent aux individus consommateurs. Au lieu de cela, il faut bien convenir que les organisations, en tant que telles, semblent épargnées par les appels à « éco-réagir » et ne contribuent certainement pas, comme elles le pourraient, à la trajectoire bas carbone. Comment le comprendre ?
La première raison est que nous n’accordons pas une réalité suffisante aux organisations dans lesquelles nous sommes actifs. On y fait référence dans le discours, on peut leur imputer des effets dans notre vie ou dans notre travail, on peut se plaindre de leur lourdeur ou de leur rigidité, on peut éventuellement promouvoir une culture propre à telle organisation, mais les organisations restent pour ainsi dire des milieux à la disposition des individus plus ou moins habiles, investis ou énergiques.
Au pire, les organisations sont les individus hypertrophiés dont nous avons à craindre la surveillance ou les manœuvres anonymes. Les théories des organisations conçues in fine comme des manuels de pilotage favorisent ce rapport individuel à l’organisation. Une organisation demeure toujours à nos yeux la projection des individus qui y évoluent. Et s’il est possible de calculer l’empreinte climatique d’une organisation, il revient toujours aux individus d’essayer de la réduire.
Or une organisation est peut-être tout autre chose que le résultat de nos interactions individuelles. Pour reprendre une thèse de Luhmann, on peut faire l’hypothèse qu’une organisation est un système qui se reproduit lui-même grâce à des opérations qui lui sont propres et qui sont récursives (pensons simplement aux procédures de l’administration, au cadre juridique qui conditionne la politique d’une collectivité, au business plan d’une entreprise).
De ce point de vue, la notion d’organisation fait en quelque sorte le plein de réalité, en tout cas au plan théorique, mais avec une conséquence qui est embarrassante au plan climatique. Sitôt qu’on décrit une organisation selon sa réalité spécifique, c’est-à-dire selon les opérations par lesquelles elle assure la pérennité de son fonctionnement, on laisse s’éloigner jusqu’à disparaître la réalité environnementale du climat. La conception luhmannienne est ici précieuse. L’organisation ne se reproduit qu’en se différenciant de tout ce qui relève de son environnement. Il y a une sorte de solipsisme de l’organisation, autrement dit une cécité à l’égard de ce qui se trouve à l’extérieur. Cela ne signifie pas qu’elle n’y réagit pas. Elle n’en saisit toutefois les changements que selon sa propre structuration.
On peut se servir pragmatiquement d’une telle perspective théorique « forte » pour reconnaître au moins deux choses : premièrement les organisations sont en principe indifférentes au changement climatique (le pire de cette indifférence arrive peut-être quand elles récupèrent le thème pour leur affichage) ; deuxièmement, les individus contribuent au sein des organisations à ce fonctionnement qui est en principe indifférent au climat.
Le rapport entre l’individu, lui-même une sorte de système, et le système de l’organisation, qui s’autoproduit, est un casse-tête théorique, comme le montrent les nombreux développements que Luhmann y a consacrés. Mais la référence à ce rapport n’en a pas moins un intérêt critique. Il est des situations où il apparaît manifestement que l’individu, par ses paroles ou ses décisions, renforce l’indifférence de l’organisation à son environnement, et plus spécifiquement au climat.
On a déjà beaucoup glosé sur la formule de Patrick Pouyanné en réponse à l’intervention de Jean Jouzel : « j’assume de poursuivre mes investissements pétrogaziers car la demande croît. Je respecte l’avis des scientifiques mais il y a la vie réelle ». On peut imputer au PDG de TotalEnergies la position d’un riche, d’un capitaliste, et le ranger automatiquement dans les cibles du combat politique théorisé par Andréas Malm. Les choses sont claires dans son cas.
Mais derrière l’expression « vie réelle » on peut déceler en vérité « l’organisation réelle » que Patrick Pouyanné contribue à faire fonctionner et dont il est lui-même dépendant. Parler de demande, comme il le fait, revient donc à opérer pour l’organisation la sélection « de l’environnement » à partir de laquelle elle active les opérations de reproduction (décisions d’investissement, construction, exploitation, distribution, communication, etc.). Or cette sélection pourrait très bien varier et mettre au cœur de la communication de l’entreprise « le respect de l’avis des scientifiques ». Cela engagerait l’organisation à se reproduire sur la base d’une tout autre « différence-indifférence » à l’égard de son environnement.
Pour défendre notre avenir climatique, il semble évidemment plus radical de dénoncer la position du PDG de TotalEnergies en la politisant. L’inconvénient de la politisation est d’ignorer les innombrables points d’attaque que l’écologie radicale peut et doit identifier au sein des organisations. Tous les directeurs de service, tous les élus locaux, tous les chefs d’entreprise, les ministres, leurs conseillers, ne sont ni des riches, ni des capitalistes au même titre que Patrick Pouyanné. Et pourtant, ils jouent tous un rôle, par leurs paroles, par leurs décisions, dans l’indifférence climatique des organisations – et pourraient sans doute jouer un autre rôle.
On parle toujours d’autre chose dans une organisation avant d’aborder l’écologie. Le terrain est toujours déjà occupé par d’autres préoccupations
Le drame, ici, est que les discours ou les plans d’actions en apparence conformes aux impératifs écologiques sont souvent aussi les premiers moyens pour l’organisation d’entretenir son indifférence à l’environnement climatique et de privilégier un business as usual fait de procédures, de budgets, de réunions, de communication interne, de planifications, de stratégies sur papier. La prétendue transversalité qui semble être la condition de tout engagement climatique (« l’écologie est partout, on peut en parler », dixit Emmanuel Macron, pour expliquer que le climat n’était pas à l’ordre du jour de ses échanges avec les responsables des différents partis le 30 août dernier à Saint-Denis), n’est qu’une façon pour l’organisation de répéter le primat de sa structuration sectorielle par rapport à la préoccupation climatique globale.
On parle toujours d’autre chose dans une organisation avant d’aborder l’écologie. Le terrain est toujours déjà occupé par d’autres préoccupations. On peut donc bien parler d’écologie mais après les sujets plus sérieux (plus réels, dirait Patrick Pouyanné).
Comme l’expliquait le spécialistes des organisations, Nils Brunssonn, dans les années 80, il y a ainsi une hypocrisie structurelle des organisations dès qu’il s’agit pour elles de se projeter vers un objectif unique, prioritaire et extérieur à elles. La question est de savoir si l’urgence climatique n’exige pas aujourd’hui, malgré tout, de travailler cette hypocrisie, de réduire l’indifférence environnementale qu’elle entretient dans les organisations, c’est-dire aussi dans la communication des individus qui y sont actifs.
Les révolutionnaires communistes se posaient une question analogue au XXe siècle, et certains se la posent encore puisqu’ils estiment qu’on ne luttera pas contre le changement climatique sans sortir du capitalisme (Frédéric Lordon, Vivre sans ?) : comment ne pas laisser la révolution se pétrifier dans les institutions nécessaires à sa mise en œuvre ? Comment éviter que le fonctionnement d’une organisation révolutionnaire ne finisse par épuiser le mouvement constituant de la révolution permanente ?
Pour établir le principe de la reviviscence possible contre la dégénérescence, on a cru pouvoir recourir à une dialectique énergétique, et douteuse, entre entropie et néguentropie. Une écologie radicale dans les organisations n’a pas besoin de remonter à ce genre de principe métaphysique. Elle perdrait aussi trop à en « saboter » le fonctionnement. Son enjeu est plutôt de réduire et de redécrire, chaque fois qu’elle se manifeste, l’hypocrisie de l’organisation à l’égard du changement climatique. Cela consiste d’abord à répéter qu’une organisation est exposée au climat, tel qu’il change, comme à ses autres environnements (pourquoi la demande, par exemple, primerait-elle sur le climat ?).
Mais cela revient aussi à repérer les moments, les lieux, les propos qui donnent aux individus l’occasion d’en faire « trop » pour l’organisation. Il est ici d’abord question de langage. Les deux exemples mentionnés (parole de PDG, parole de Président de la république) sont explicites. Dans les deux cas, l’individu se fait en quelque sorte porte-parole de l’indifférence climatique de l’organisation pour laquelle il travaille. Dans le premier cas, l’hypocrisie est à son comble – on dissimule la logique propre à l’organisation derrière une référence à la vie en dehors de l’organisation. Dans le deuxième cas, l’hypocrisie n’est pas moindre : pour dire que l’écologie est un sujet de premier plan, on dit qu’elle est partout, manière de dissimuler le fonctionnement différencié de l’organisation au sein de laquelle « partout » équivaut à « nulle part ».
Il n’y a pas besoin de sabotage ni de révolution contre l’hypocrisie des organisations. Il convient plutôt de ne jamais relâcher un simple travail de redescription. De cette mission interne, les individus sont toujours capables puisqu’ils prennent eux-mêmes, à certains moments, en certains lieux, par certaines formulations, la responsabilité d’organiser et de communiquer l’indifférence de leur organisation au climat. Vous dites que l’écologie est partout ? Pourrions-nous commencer par dire ce que désigne ce « partout », pour décrire par la suite si et comment l’écologie est en chaque lieu de l’organisation (du gouvernement, de l’Etat, des secteurs de la fonction publique) ?
Et sur la base de cette redescription, pourrions-nous mesurer selon quelles modalités (avec cette tendance inéluctable à l’indifférence) l’organisation prend en compte son environnement climatique ? Qu’en dites-vous ? Une question à laquelle n’importe quel responsable, à chaque instant, peut commencer à répondre sans avoir pour cela à réciter les mots qui disent l’indifférence et l’hypocrisie climatiques de l’organisation.
