Face à l’union des droites : plaidoyer pour une gauche résolument minoritaire
La tripartition du champ politique français a vécu. Née de l’essor du Front National dans les années 1980, elle semblait durablement installée lorsque Emmanuel Macron a débuté son premier mandat, même si le candidat de La République en Marche prétendait lui substituer une opposition d’un nouveau type, entre « progressistes » et « populistes ».
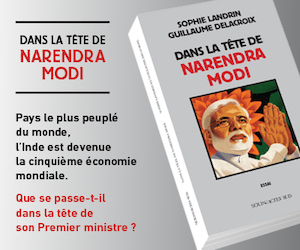
La rhétorique du « en même temps », qui avait animé la première campagne du chef de l’État, visait en effet à remiser la polarité de la droite et de la gauche – mais aussi leur détermination partagée à traiter l’extrême droite en tiers exclu – au profit de l’opposition entre un juste milieu capable d’attirer les gens raisonnables d’où qu’ils viennent et deux extrêmes également portés à la démagogie irresponsable.
Cependant, une fois au pouvoir, l’ancien protégé de François Hollande a rapidement renoncé, sinon à invoquer l’alternative entre progressisme et populisme, du moins à escompter qu’elle oriente le choix des Français. Conscient que la politique qu’il entendait mener ne lui accordait plus aucune marge de progression sur sa gauche, il s’est adonné à une forme de sarkozysme 2.0 jamais démenti par la suite – comme l’atteste aujourd’hui la composition et les priorités du gouvernement de Gabriel Attal – et destiné à capter le reliquat du vote Les Républicains (LR).
Revu à la baisse, l’objectif poursuivi ne consistait plus à forger une majorité absolue d’amis du progrès. Emmanuel Macron se proposait seulement de rassembler un nombre suffisant de voix de droite pour figurer au second tour de la présidentielle suivante et, une fois qualifié, de mobiliser le principe du moindre mal pour convaincre les électeurs de gauche de lui accorder leurs suffrages. Sans doute lui importait-il encore de traiter sa rivale de 2017 comme la principale représentante de l’alternative populiste à son progressisme, et non comme la cheffe d’un parti d’extrême-droite distinct d’un centre droit libéral et d’une gauche éco-socialiste. Pour autant, la division de la demande politique en trois grandes sensibilités demeurait bien l’attendu sur lequel reposait sa stratégie.
Propre à assurer sa réélection, le procédé utilisé par le Président sortant s’est ensuite retourné contre lui. Aussi incapable de conjurer le dépit de tous les Français qui avaient voté pour lui à contre-cœur que d’appréhender les conséquences électorales de son acharnement à privilégier sa concurrence avec Marine Le Pen, il a surtout occulté l’apparition d’un nouvel état d’esprit, tant chez Les Républicains que sur le flanc droit de sa propre coalition. Jusqu’à une date récente, les membres de la majorité présidentielle et de l’opposition conservatrice s’accordaient à miser sur l’adoption de la rhétorique et de larges pans du programme lepénistes pour persuader l’électorat d’extrême droite de préférer une copie policée à un original trop cru. Toutefois, l’évolution du paysage politique européen convainc à présent nombre d’entre eux qu’il est temps de renoncer à un infructueux braconnage pour envisager une alliance en bonne et due forme.
Depuis longtemps déjà, des lanceurs d’alerte émargeant au monde de la recherche répètent à l’envie, et chiffres à l’appui, que les emprunts au logiciel du RN sont aussi vains sur le plan de la stratégie électorale que honteux au regard de l’éthique. Loin de ramener des brebis égarées par la colère ou le désarroi dans le giron républicain, les compromissions auxquelles se livrent les apprentis sorciers issus des partis dits traditionnels ne parviennent qu’à légitimer la formation qu’elles singent – au point d’aider les hésitants à sauter le pas – sans susciter le moindre transfuge à leur profit. Longtemps sourds à de telles mises en garde, les praticiens de l’appropriation décomplexée des thèmes frontistes semblent avoir enfin reçu le message – à l’exception notable d’Emmanuel Macron. Cependant, les enseignements qu’ils en tirent ne sont pas ceux qu’espéraient les émetteurs de l’avertissement.
Si les Gérald Darmanin, Bruno Lemaire, Laurent Wauquiez et autres Édouard Philippe renoncent désormais à l’illusion d’un rapatriement des électeurs lepénistes, ce n’est certes pas pour renouer avec la tradition du « cordon sanitaire » conçu pour frapper l’extrême droite d’ostracisme. Bien au contraire, assumer l’inébranlable loyauté des millions de Françaises et de Français qui offrent leurs voix à Marine Le Pen implique pour eux de se résoudre à un rapprochement avec le parti qu’elle dirige.
Sans doute la formation d’un pareil attelage n’ira-t-elle pas sans difficultés, en particulier sur le plan symbolique. La nébuleuse Ensemble ! se présente en effet comme un rempart contre les populismes, Les Républicains se sentent toujours obligés d’honorer les mânes du Général de Gaulle et, de son côté, le RN, même dûment dédiabolisé, continue de puiser son attractivité dans la dénonciation du « système » et le renvoi dos à dos de la droite et de la gauche. Reste que leurs désirs respectifs de se maintenir, de revenir et d’accéder au pouvoir commandent aux ambitieux des trois familles d’en rabattre sur l’entretien de leurs images de marque.
À défaut de se sentir menacés par une Nupes déliquescente, les candidats de droite à la succession d’Emmanuel Macron redoutent que les électeurs de gauche cessent de faire la différence entre eux et le RN, y compris au moment de glisser un bulletin dans l’urne, et assurent par leur abstention la victoire de Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle de 2027. De son côté, la cheffe du parti d’extrême droite ne nourrit pas seulement la crainte inverse, à savoir celle d’une persistance du « réflexe républicain » qui la tiendrait, une fois encore, à l’écart du pouvoir. Désireuse de l’emporter, elle n’en est pas moins anxieuse à l’idée de gouverner avec ses seules troupes – dont elle redoute l’incompétence et déplore le manque de notoriété. Pour elle comme pour ses concurrents post-macronistes et Républicains, il paraît donc prudent de chercher un terrain d’entente en amont de l’échéance
Objectera-t-on qu’outre les blessures narcissiques occasionnées – perte de respectabilité antipopuliste pour les uns, de radicalité antiélitiste pour les autres – l’élaboration d’un accord de gouvernement se heurte également à de sérieux obstacles programmatiques ? Même si la victoire idéologique du RN est actée en matière de légitimation de la xénophobie et de fustigation du wokisme, ne demeure-t-il pas des incompatibilités insurmontables entre l’européisme néolibéral de la droite et le nationalisme illibéral de l’extrême droite ? Porter le regard au-delà des frontières permet de constater qu’il n’en est rien.
Qu’elle soit déjà au pouvoir – en Italie, en Suède ou en Finlande – ou seulement en gestation – aux Pays-Bas, en Espagne, au Danemark – l’union des droites s’impose comme une formule d’avenir à l’échelle de l’Union Européenne. Hier paria, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, apparaît chaque jour davantage comme un éclaireur. Même les Chrétiens-Démocrates allemands (CDU) ne s’interdiront plus très longtemps de négocier avec l’Alternative pour l’Allemagne (AFD). Aussi ne voit-on pas pourquoi la France ferait exception : il faut avoir encore un pied dans l’ancien monde pour ne pas comprendre qu’entre le RN et les formations de traditions orléaniste et bonapartiste, les relations relèvent aujourd’hui bien plus de la complémentarité que de la substituabilité.
Le lepénisme, dit-on, est un euroscepticisme. Mais le demeurera-t-il longtemps dès lors qu’au sein d’une Union toujours plus perméable à ses antiennes, le libre-échange cesse d’être un dogme et la phobie de l’immigration irrégulière cimente la solidarité ? Convertir le vieux continent en une maison de retraite fortifiée où les populations de souche pourront cultiver leur nostalgie acrimonieuse et poursuivre leur dépérissement à l’abri des regards importuns : tel est bien le dessein fédérateur qui transcende les étiquettes partisanes et auquel les instances communautaires apportent volontiers leur contribution. En témoignent les agissements de Frontex en Méditerranée ainsi que les accords de sous-traitance conclus avec les pays dits de transit et conçus pour externaliser la gestion du refoulement des exilés[1].
Sans doute, en France comme ailleurs, les politiciens issus du moule néolibéral demeurent-ils fermes sur leur cœur de métier – à savoir la défiscalisation des plus-values et la libre circulation du capital. Mais pour le reste, leur souci d’ouverture à un camp naguère taxé de populiste connaît peu de limites. Il passe notamment par l’introduction d’une dose de protectionnisme en matière de biens et de services non financiers, mais aussi par la promesse de prémunir les bourgs et les campagnes des méfaits de l’« écologie punitive » et enfin par la poursuite d’une politique d’immigration équilibrée, entre mesures dissuasives à l’encontre des candidats au séjour et procédures de harcèlement des étrangers déjà sur le territoire.
Conséquence de ces assauts de bonne volonté, l’offre électorale se résumera bientôt à une alternative entre adhérents et réfractaires à la coalescence des bleus et des bruns que l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin qualifie déjà de nouveau Front républicain. S’agit-il alors d’avancer, comme le font Julia Cagé et Thomas Piketty, que la résurgence d’une bipartition du champ politique est à l’ordre du jour ? Les deux économistes considèrent en effet que l’épuisement du macronisme annonce le retour de l’affrontement entre la droite et la gauche d’avant la mondialisation néolibérale. Reste qu’à leurs yeux, c’est l’essor d’un bloc « social-écologique » qui constitue l’élément moteur de la polarisation à venir[2].
Pour les auteurs d’Une histoire du conflit politique, tant l’ascension d’un bloc « national-patriote » que l’autonomisation d’un bloc « libéral-progressiste » ont procédé des renoncements de leurs adversaires : en s’interdisant de redistribuer les richesses et d’investir dans les services publics, expliquent Cagé et Piketty, la gauche a successivement perdu la confiance des milieux populaires et instillé la tentation du « en même temps » au sein de son électorat bourgeois[3]. Inversement, et pour autant que le changement de cap constitutif de la Nupes se confirme, sa récente détermination à sortir du carcan néolibéral pour réduire les inégalités serait de nature à ramener les classes salariées dans son orbe, au point de ne laisser de place que pour un seul rival de droite.
Dans cette vision étrangement optimiste du futur proche, le bloc « national-libéral » qui prendrait la place des blocs « libéral-progressiste » et « national-patriote » actuellement concurrents échouerait à récupérer l’ensemble de leurs électeurs – les pertes se situant à la fois chez les patriotes du bas et chez les progressistes du haut de l’échelle socio-économique. Le poids électoral de cette famille conservatrice imparfaitement recomposée n’excèderait donc pas celui du bloc social-écologique regonflé par son refus du fatalisme et leur duel retrouverait le parfum des quatre premières décennies d’après-guerre[4]. Or, force est de constater que la bipartition du champ politique qui se profile relève d’une dynamique bien différente.
Loin de répondre à la pression exercée par une gauche rassemblée autour d’un programme ambitieux, l’union des droites se construit sur la convergence idéologique entre ses diverses composantes mais aussi sur la faiblesse des résistances que rencontre leur proximité croissante. Ainsi n’est-ce pas tant la crainte de susciter des remous dans l’opinion qui retient encore ses futurs artisans d’entamer des pourparlers en vue de l’établissement d’une plateforme commune, mais plutôt l’espoir de pouvoir négocier dans des conditions plus favorables une fois que les élections européennes auront confirmé la droitisation du continent et que Donald Trump sera revenu à la Maison Blanche.
Les conséquences de l’intersectionnalité
Exposée à la perspective d’une marginalisation inédite si des coalitions à l’italienne ou à la suédoise voient le jour en France, la gauche se divise sur le choix de l’orientation susceptible de conjurer le sort. D’aucuns gagent que l’affichage de la défiance est propice à la mobilisation des abstentionnistes – en particulier au sein de la jeunesse urbaine – dont l’appoint contribuerait de manière décisive à modifier le rapport de force électoral. D’autres prétendent que c’est en recentrant le propos sur la question sociale – aux dépens des diversions que constitueraient les « guerres culturelles » – qu’il deviendra possible de desserrer l’emprise du RN sur les populations rurales et périurbaines. Enfin d’autres encore spéculent sur le sursaut des libéraux sincères que provoquerait la coalition des droites pour procéder à la réfection d’une social-démocratie capable de les attirer.
Difficilement conciliables, les trois options semblent plus grosses de scissions et d’anathèmes que d’union dans l’adversité. Mais même en imaginant que l’importance de l’enjeu incite leurs avocats respectifs à présenter un front commun, il y a fort à parier que celui-ci ne réunira guère plus d’un tiers des votants. Car là réside le fond du problème : fracturé ou rassemblé, le peuple de gauche n’est pas très nombreux. Pour rendre compte de la faiblesse de ses effectifs, les observateurs qui s’en désolent pointent volontiers les errements de ses représentants politiques – alternativement jugés trop compromis ou trop sectaires – mais invoquent surtout les biais des media dominants et l’incidence de la désindustrialisation sur l’organisation du travail.
Que la gauche souffre à la fois des carences de ses mandataires, de l’hégémonie culturelle de ses détracteurs et de la corrosion des solidarités d’antan est peu contestable. Cependant, s’en tenir là revient à occulter qu’elle a, pour ainsi dire, de bonnes raisons d’être minoritaire. Sauf à se renier en choisissant de fermer les yeux sur certaines injustices, nombreux sont en effet les engagements qu’elle réclame. À cet égard, les six dernières décennies ont été particulièrement riches puisque, sans rien perdre de leur acuité, les luttes contre l’exploitation du travail ont dû apprendre à cohabiter avec les combats féministes et anticolonialistes, mais aussi à s’accommoder de la visibilité croissante des revendications portées par les minorités sexuelles et racisées ainsi qu’à ménager la place qu’il leur revient aux résistances suscitées par les ravages du productivisme.
Si l’intolérance aux inégalités de traitement et d’accès inspire l’ensemble de ces mobilisations, elle ne suffit pas, tant s’en faut, à assurer leur convergence. Y font obstacle les tensions objectives entre les causes – « fin du monde, fin du mois » est l’énoncé d’un problème plutôt que la formulation d’un programme – mais aussi les propensions de leurs défenseurs à subordonner, à négliger, voire à récuser les questions dont ils ne s’occupent pas en priorité.
Ainsi arrive-t-il que certains s’autorisent du primat qu’ils accordent aux rapports de classes pour déceler une ruse de la raison néolibérale dans les critiques du racisme et du sexisme structurels ; que d’autres, qui se proclament féministes, traitent l’émergence de la question trans en affront à la cause des « vraies » femmes ; ou que d’autres encore excipent de leur préoccupation principale – qu’il s’agisse de l’impérialisme occidental ou de l’antisémitisme – pour refuser de reconnaître la nature d’une agression – en Ukraine ou en Palestine. Parfois, l’hostilité à un engagement supposément concurrent devient tellement obsédante qu’elle efface toute autre préoccupation et convertit ses proies en bateleurs réactionnaires. Mais même reconnaître que le tort auquel on s’attache n’est pas le seul qui mérite de soulever l’indignation ne protège pas toujours du sentiment que le temps et l’énergie consacrés aux autres empiètent sur l’attention qui devrait lui revenir.
La pluralité des axes qui la sollicitent ne condamne pas nécessairement la gauche à l’échec. Reste que les frictions générées par leur articulation perturbent les horizons d’attente de ses partisans. Ceux-ci demeurent en effet tributaires de la représentation d’une société divisée en deux où les dominants, qui ont pour eux le pouvoir des armes et de l’argent, exercent leur emprise par les voies de la répression et de l’idéologie, mais où l’aptitude des dominés à prendre conscience des ressorts de leur condition commune ne constitue pas moins l’émancipation en promesse. Si les mésaventures du socialisme d’État et l’évidement progressif de la social-démocratie ont quelque peu entamé la foi des militants dans le sens de l’Histoire, demeure néanmoins la conviction que la réduction d’inégalités préjudiciables au plus grand nombre est un objectif qui a vocation à emporter l’adhésion de toutes celles et de tous ceux qui y ont intérêt.
Fondée sur l’hypothèse d’une homogénéité des formes de domination, la confiance en l’existence d’une majorité sociale favorable à leur élimination se heurte pourtant au constat que la gauche est aujourd’hui « intersectionnelle », au sens où elle se situe au croisement d’une multiplicité de luttes dont la congruence n’est pas assurée. Quiconque est familier des diagrammes de Venn a pu observer qu’en dehors des rares cas de superposition parfaite, la surface de l’intersection entre plusieurs ensembles est inférieure à celle de leur réunion. L’écart entre elles tend même à se creuser à mesure que le nombre d’ensembles augmente. Autrement dit, plus la rétivité aux inégales libertés devient profuse, plus elle risque d’entraîner des défections.
Pour autant, on n’assistera pas à un retour en arrière : n’en déplaise au secrétaire général du Parti communiste, le temps où il suffisait de réclamer un partage de la croissance moins défavorable aux salariés nationaux pour se dire de gauche semble irrévocablement révolu. Dans un registre différent, le « choc de simplification » imaginé par les promoteurs de l’« union populaire » n’a guère plus de chances de se produire : expressions d’un attachement à des avantages jusque-là indiscutables, les résistances à l’apparition de nouvelles revendications sont difficilement solubles dans une aversion partagée pour la collusion des élites.
Tant la singularité des mouvements impliqués que l’hétérogénéité des questions soulevées font que demeurer à gauche ne se résume plus à défendre des conquis de classe et ne revient pas davantage à s’élever contre les privilèges d’une caste. S’y sentir chez soi – non pas en dépit mais en raison des audaces et de la détermination des militants antiracistes, féministes, LGTBIA+ et écologistes – suppose désormais d’être spontanément enclin à se réjouir de la réduction de toutes les inégalités systémiques : celles dont on pâtit comme celles dont on bénéficie. Or, à la différence d’un calcul rationnel ou d’un engagement moral, une telle disposition ne se laisse pas aisément fixer par des arguments ou de la discipline : précaire et volatile, elle est susceptible de déserter ceux-là mêmes qui s’en réclament. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elle peine à cimenter un bloc majoritaire.
Se rassurera-t-on en rappelant que la gauche n’est pas la seule à connaître des problèmes d’intersectionnalité ? Telle est, on l’a vu, la raison principale de l’optimisme dont font preuve Cagé et Piketty : le souverainisme et le protectionnisme des « nationaux-patriotes », espèrent-ils, ne sauraient faire bon ménage avec le mondialisme et le libre-échangisme des « libéraux-progressistes ». Si d’ordinaire il en va bien ainsi, force est de reconnaître que les droites vivent ces jours-ci un rare moment de grâce : la convergence de leurs programmes semble en effet s’effectuer sans plus de frictions rédhibitoires au niveau des appareils que de pertes conséquentes parmi leurs électeurs potentiels.
Après la dissipation du mirage de la startup nation – avec ses « premiers de cordées » fiers de tirer la société derrière eux et ses jeunes des quartiers désireux de saisir leur chance – le ressentiment s’est rapidement imposé comme un affect formidablement rassembleur. Il n’a certes pas fallu attendre la fin du « en même temps » pour que des entrepreneurs politiques comprennent qu’il est plus aisé d’engranger les soutiens en incitant les gens à éprouver les aspirations des autres comme une menace qu’en s’appuyant sur leur propension à les accueillir comme une stimulation. En la matière, la gauche est loin d’avoir toujours résisté à la facilité. Toutefois, dans un pays vieillissant et au rayonnement déclinant, seules les droites sont en mesure de capitaliser sur le sentiment d’être « remplaçables » qui hante nombre de leurs concitoyens.
Loin de chercher à conjurer l’amertume – que ce soit en insistant sur les vertus régénératrices de l’ouverture et du partage ou au contraire en appelant chacun à se prendre en main – leurs publicistes s’accordent à l’investir dans une panoplie d’objets phobiques : de l’immigré envahissant à l’intellectuel militant, et de l’assisté usurpateur au bureaucrate liberticide. Or, imputer les malheurs du peuple français aux intrusions qu’il subit invite aussitôt à imaginer qu’une meilleure immunisation suffirait à lui rendre son lustre – alors que la redistribution des ressources et l’allocation de nouveaux droits seraient quant à elles susceptibles de profiter aux différentes catégories de parasites. Parce qu’une pareille vision n’a guère besoin d’être validée par des faits pour demeurer populaire, mais aussi parce qu’elle rencontre un large écho dans toute l’Europe et même au-delà, l’union des droites a manifestement de beaux jours devant elle.
À gauche, par conséquent, l’enjeu n’est pas de convertir une majorité sociale supposée en majorité politique avérée : ses champions auront beau hausser le ton, s’ouvrir au centre, convoquer un passé vénérable ou opter pour la verticalité populiste, aucune potion ne transformera le ressentiment épurateur en indignation émancipatrice[5]. Aussi, plutôt que de dénier qu’elle sera durablement minoritaire, on avancera qu’il appartient à la gauche de s’y résoudre, mais afin de l’être résolment.
La résolution requise n’est pas tant affaire de radicalité ou au contraire de retenue que d’intransigeance : elle appelle à se tenir fermement au croisement des causes, sans céder à la tentation de les trier ou de les hiérarchiser, mais aussi sans nier les problèmes que pose leur coexistence. Encore une fois, rien ne laisse présager qu’une gauche, si résolue soit-elle, parviendra à abolir la différence entre une intersection et une réunion de mouvements sociaux. En revanche, de son refus de sacrifier le foisonnement et la complexité de ses engagements au vain espoir de former une majorité dépendra l’aptitude des siens à supporter le long hiver dans lequel nous sommes entrés.
