La Recherche au kinescope
– sur « Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre » à la BNF
En notre époque qui aime à sacraliser la personne de Marcel Proust pour mieux occulter les puissances de son œuvre, comme en témoigne à nouveau l’écrasante majorité des articles de presse publiés à l’occasion du centenaire de sa mort ce 18 novembre, l’exposition proposée par la BNF jusqu’au 22 janvier a une qualité inestimable : elle permet au visiteur d’appréhender la matérialité du travail d’écriture à partir du cas limite que constitue le geste de Marcel Proust.
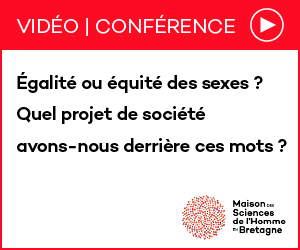
La réussite est double : par son gigantisme et l’abondance des manuscrits qui nous sont parvenus, l’œuvre de Proust offre évidemment un éclairage passionnant sur la notion même de travail d’écriture, tandis qu’en miroir cet accent mis sur la fabrication matérielle d’une œuvre, y compris au plan éditorial, éclaire d’une manière nouvelle À la recherche du temps perdu.
On le sait : relativement récent, le désir d’exposer la littérature reste un exercice difficile, souvent décevant lorsqu’il se réfugie soit du côté de la biographie de l’auteur soit du côté du contexte socio-historique, les œuvres elles-mêmes devenant paradoxalement l’illustration de ce que l’exposition met en scène en leur nom. C’est ici l’inverse qui se produit.
L’exercice se révèle en effet d’autant plus fructueux qu’il se veut immersif, grâce à la mise en scène savamment pensée des manuscrits eux-mêmes par les trois commissaires, Antoine Compagnon, Nathalie Mauriac-Dyer et Guillaume Fau (responsable du département des manuscrits de la BNF). Œuvre monumentale laissée inachevée et qui sans doute ne pouvait que le rester, inachevée, tant elle n’a cessé de grossir de l’intérieur au long des années jusqu’à engloutir son auteur, À la recherche du temps perdu s’y prête d’autant mieux que d’innombrables traces du travail d’élaboration, d’écriture puis de publication nous sont parvenues, des premiers carnets de notes jusqu’aux dernières épreuves surchargées de corrections de chacun des volumes publiés du vivant de l’auteur, et bien sûr le
