Parcoursup, l’égalité devant le juge
La date du 21 Septembre dernier a marqué la fin de la phase complémentaire de validation des vœux sur la plateforme d’orientation « Parcoursup ». À l’heure où de nombreux médias se lancent dans le « bilan » de cette réforme qui fait de la sélection le mode routinier de l’accès à toutes les filières de l’enseignement supérieur, la dernière phase de Parcoursup rappelle surtout que la loi Orientation et Réussite des Etudiants (ORE) refonde en profondeur le rapport entre l’institution universitaire et les étudiants au travers du principe de transparence, tout comme elle marque l’émergence d’un acteur dont on peut penser qu’il deviendra rapidement central dans les controverses liées à l’accès dans l’enseignement supérieur : le juge.
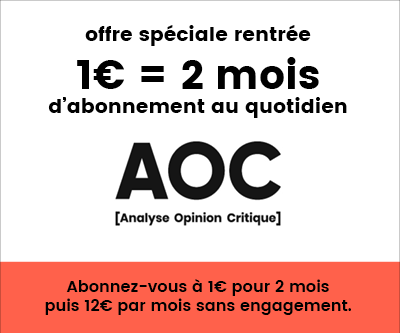
En effet, la loi Orientation et Réussite des Etudiants (ORE) prône une culture de la transparence et prévoit l’ouverture de différents recours qui visent à justifier et à éclairer les décisions des établissements, en particulier dans le cas des candidats qui auraient fait l’objet d’un ou de plusieurs refus dans les filières de leurs choix.
Au-delà des commissions rectorales, dont le rôle est, dans chaque académie (ou groupes d’académies), d’« accompagner les lycéens » sans proposition, il est possible, au titre de l’article 612-3 du code de l’éducation, de saisir le chef d’établissement demandé dans le but de connaître les motifs justifiant de la décision individuelle de refus d’admission. Il s’agit également d’éclairer les critères et les modalités d’émission de la décision. A l’heure de sa présentation, cette mesure semblait alors incarner l’avènement d’un principe de transparence comme une norme régulatrice dans l’enseignement supérieur, alors qu’il s’imposait comme valeur centrale du rapport entre l’État et les citoyens, notamment dans le cadre de la loi du 15 Septembre 2017 relative « à la confiance dans la vie politique. »
Cette demande de transparence repose sur une fiction, selon laquelle les critères de sélection et les modalités de
