Réforme du Bac : le lycée en mal d’orientation
Pierre Mathiot a rendu le 25 janvier dernier un rapport sur la réforme du baccalauréat qui implique des changements substantiels au lycée : assouplissement des séries, semestrialisation, logique plus modulaire, ouverture pluridisciplinaire et préparation à l’expression orale, choix plus important pour les élèves, introduction de doses de contrôle continu… L’accueil plutôt favorable qu’il a reçu montre qu’il se situe dans l’épure des réflexions majoritaires de ces dernières années. On peine en revanche à distinguer, dans ce rapport, la conception du lycée qui organise ces propositions. Prudence politique bienvenue quand on touche à ce « monument national » qu’est le bac ? Peut-être. Il n’en reste pas moins que les réalités éducatives sont têtues : si l’on ne sait pas quel rôle on veut faire jouer au lycée au sein du système éducatif, il y a peu de chance que l’on inverse les logiques qui posent aujourd’hui problème.
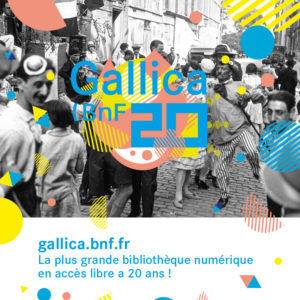
Comment ne pas rappeler en premier lieu l’importance prise par les stratégies sociales qui organisent une grande partie des parcours des lycéens ? La plupart des efforts pédagogiques et didactiques s’en trouvent aujourd’hui limités. De nombreuses recherches ont montré combien la massification de l’enseignement secondaire a pu être synonyme d’une démocratisation ségrégative. Du choix des options au collège à celui du « bon » établissement, en passant par les redoublements stratégiques en seconde, le système hexagonal est parcouru par des processus de différenciation. Il en est évidemment ainsi du choix des séries qui, pour les plus convoitées, fonctionnent comme un signal à l’intention des familles et des filières susceptibles de recruter les futurs étudiants.
La question que pose une nouvelle architecture en majeures et mineures est dès lors triviale : dans quelle mesure permettra-t-elle ou non la reconstitution de parcours à même de cultiver un certain entre-soi scolaire et social ?
Choisir la série S aujourd’hui c’est moins choisir une série s
