Amour et preuves d’amour dans la recherche
Gagnons du temps. Ne reprenons pas les innombrables arguments qui plaident en faveur du financement de la recherche.
Vous les connaissez probablement. De même que vous savez vraisemblablement qu’en général, ils sont accompagnés de mots immenses et magnifiques comme « émancipation », « Lumières », « frontières des connaissances » qu’il s’agit de « repousser », « avenir du pays ».
Vous n’ignorez pas non plus que la recherche est présentée comme une condition indispensable, de la transition écologique pour les uns, de la compétitivité, de l’emploi et de la croissance pour les autres, et de progrès dans le domaine de la santé, pour tous. L’ « impérieuse nécessité » de « faire barrage aux fake-news » est venue récemment, avec « la bataille de l’intelligence artificielle », compléter la longue liste des arguments mobilisés dans les vibrants plaidoyers de la cause de la recherche et de son financement.
Cause qui, il faut le souligner, réussit d’ailleurs l’exploit de faire la quasi-unanimité dans le paysage politique, tous les gouvernements, depuis des décennies, entonnant le refrain de la « priorité » — autre tour de force, elle parvient presque à faire l’union sacrée parmi mes collègues économistes.
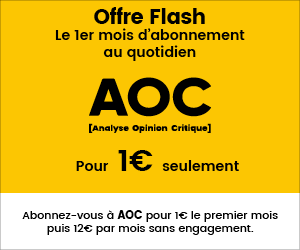
Comment dès lors ne pas se réjouir de l’annonce faite par le Premier ministre, le 1er février, à l’occasion des 80 ans du CNRS. Rien de moins qu’une « loi de programmation pluriannuelle pour l’enseignement supérieur et la recherche ». Devant une telle nouvelle, passée pourtant presque inaperçue dans la crise politique et démocratique dans laquelle le gouvernement a conduit le pays, la première réaction serait de s’écrier « Enfin ! ». Certes, les plus critiques diront d’emblée qu’attendre près de deux ans pour faire un exercice que l’on aurait pu imaginer lancé en début de mandat est un peu « étonnant ». Mais, admettons : et mieux vaut tard que jamais.
Et puis, on y regarde de plus près. Et là, difficile de ne pas décolérer.
Car que nous annonce-t-on véritablement ? En fait,
