Les drôles d’enjeux pédagogiques de la réforme du lycée
Dans une interview donnée en décembre 2018, à L’Obs et plus récemment dans Libération, Pierre Mathiot (directeur de l’IEP de Lille, professeur de science politique et rédacteur d’un rapport sur le lycée en 2018), « père spirituel » de l’actuelle réforme du lycée et du bac menée par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, cherche à rassurer les élèves et les professeurs inquiets de ses possibles conséquences. Derrière un habile habillage pédagogique, cette réforme cache en effet un projet complexe, anxiogène et élitiste. Voilà pourquoi nous souhaitons ici répondre à Pierre Mathiot et revenir sur les enjeux pédagogiques de la réforme Blanquer.
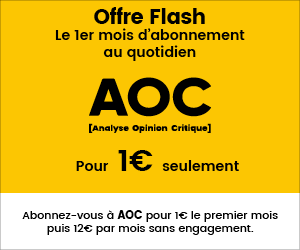
En France, actuellement, à la fin de l’année de seconde, les élèves qui poursuivent leur scolarité en filière générale choisissent la série et le type de bac qu’ils vont passer deux ans plus tard. Ils ont le choix entre trois séries qui correspondent au trois grandes « cultures » universitaires académiques : la série L correspond aux humanités littéraires (langue, philo, histoire-géographie, lettres), les série ES aux sciences sociales (économie, sociologie, histoire-géographie) et la série S aux sciences expérimentales (maths, physique-chimie, biologie). Ces séries comportent un tronc commun assez large et des renforcements horaires dans les disciplines majeures. Le lycée des séries repose donc sur une spécialisation équilibrée et progressive, il permet une articulation cohérente entre enseignement commun et enseignement spécialisé et ouvre des perspectives d’orientation bien identifiées pour les familles. Rappelons de plus que le lycée des séries a accompagné la démocratisation de l’enseignement secondaire général puisque la proportion d’une génération à obtenir un bac général a doublé en 40 ans ; elle est passée de 20 % dans les années 80 à 40% actuellement (80% d’une génération obtient un bac actuellement avec les bacs technologiques et professionnels).
La principale critique faite au lycée des séries
