Make Empathy Great Again : la contestation aux États-Unis
Le 4 mars 2025, le président des États-Unis a annoncé via le réseau Truth Social qu’il bloquerait les subsides fédéraux des universités qui autoriseraient des « manifestations illégales » — précisant que les participants seraient arrêtés, exclus de leurs institutions et, le cas échéant, déportés dans leurs pays d’origine.
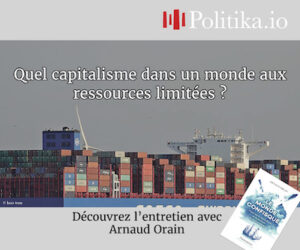
La mesure, parfaitement illégale, viole le principe de « liberté d’expression » dont J. D. Vance et Elon Musk ne cessent de se réclamer pourvu qu’elle corresponde à leur axiologie réactionnaire. Elle entend en premier lieu cibler les rassemblements similaires à ceux qui ont animé les campus l’an dernier en soutien au peuple palestinien. Mais le fait est surtout que les manifestations opposées au président et à ses actions commencent à prendre de l’ampleur. En Europe, la presse est submergée à la fois par la brutalité des décisions présidentielles et par la multiplication de provocations destinées à capter l’attention (entre saluts fascistes et exhibition de tronçonneuse) ; en donnant peu de place à ces formes d’opposition, elle entretient malgré elle l’illusion d’une adhésion massive des citoyens américains à ce qui est en train de se jouer.
Le 3 février, des dizaines de magasins et restaurants tenus par des personnes n’ayant pas la nationalité américaine ont fermé leurs portes, dans les États de Floride, Ohio, Oklahoma, Californie et Washington, à l’occasion d’une campagne intitulée « A Day Without Immigrants » pour mettre en lumière le rôle crucial de ces derniers dans l’économie et l’accès aux services. Le 5 février, dans le cadre du mouvement #50501 (50 protestations dans 50 États en un seul jour), on a pu voir devant les capitoles des différents États des rassemblements visant les déportations massives annoncées par l’administration Trump, la répression de l’immigration, l’abrogation des politiques « DEI » (diversité-équité-inclusion) entraînant licenciements et ruptures de financements, mais aussi le recul des droits des personnes t
