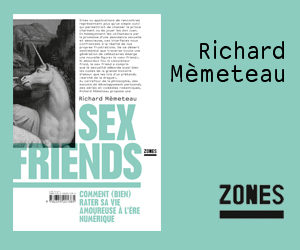Pourquoi avons-nous si peur des fake news ? (2/2)
Le bilan des incertitudes sur la force de l’effet fake news invite à faire un pas en avant, plus abstrait, pour essayer d’interpréter notre obsession pour la manipulation de l’information, telle qu’abordé dans le premier volet de cet article. Le procédé est toujours identique : s’inquiéter d’une information fausse, l’associer à un chiffre important (des centaines de milliers de clics, de vues ou de partages) et s’émouvoir des conséquences que cette diffusion massive exerce sur les esprits faibles.
Cet effet panique doit être analysé comme une conséquence de l’empire qu’exerce la grille d’interprétation individualisante que nous portons désormais sur tous les phénomènes relatifs à la société numérique. Là plus qu’ailleurs, s’est imposé l’idée d’une société en apesanteur d’individus atomisés ballottés en tous sens par des informations orphelines que le numérique auraient libérées du contrôle éditorial des médias.
Tout le monde peut dire n’importe quoi à n’importe qui. Internet aurait rendu parfaitement incontrôlable et imprévisible la rencontre des gens et des messages. Cette vision a deux conséquences. La première est que les informations ne sont plus accrochées à rien, sauf aux intentions idéologiques et aux intérêts de leurs producteurs. Nous n’avons jamais prêté autant d’intérêt à d’obscures officines politiques, aux relations de pouvoir de milliardaires conservateurs, à l’univers ténébreux des hackers russes ou aux élucubrations des activistes de l’ultra-droite. En revanche la manière dont les infox qu’ils fabriquent circulent et sont rendues visibles, la façon dont les médias les reprennent ou les commentent, les procédés par lesquels elles contribuent à nourrir les représentations et les thématiques structurantes de l’agenda politique disparaissent étrangement de l’analyse.
La seconde conséquence de cette représentation du marché dérégulé est la théorie implicite de la réception qui la sous-tend : chez les individus « forts » de la société connectée,