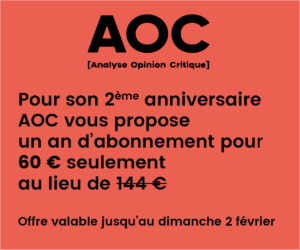La colère gronde et enfle dans les amphis et les labos
La colère gronde et enfle dans les amphis et les labos. Une colère qui, comme dans tout le pays, a des racines « profondes » (si l’on ose encore utiliser ce terme dont abuse le Président de la République et ses partisans pour tenter de masquer le vide sidéral de leurs argumentaires et qui ne révèle finalement rien d’autre que la profondeur de leurs a priori idéologiques).
Bien sûr la réforme des retraites agit comme un révélateur. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on sait qu’un sextuor infernal dessine ici des perspectives bien sombres pour les personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur ?
1 – En effet, comme tous les fonctionnaires, ils ont subi un gel presque complet du point d’indice depuis dix ans (soit une baisse estimée à 16% des pensions) que le gouvernement vient de prolonger jusqu’en 2022, comme s’il souhaitait jeter de l’huile sur le feu.
2 & 3 – Par ailleurs les difficultés financières des établissements et la crise de l’emploi scientifique qui en résulte se sont traduites par un recul marqué de l’âge de recrutement sur un poste stable (plus de 34 ans désormais) et par des promotions au compte-goutte.
4- Comme dans toute la fonction publique, les salaires sont ici nettement inférieurs à ceux auxquels les individus pourraient prétendre dans le secteur privé (un rapport de la Cour des comptes de 2011 donne une rémunération totale inférieure de plus de 21 000 euros par rapport à des postes équivalents de catégorie A+ de la fonction publique).
5 & 6 – En outre, comme pour quasiment tous les enseignants, ils ne profitent pas de primes importantes qui pourraient compenser partiellement la perte générée par le fait de prendre en compte l’ensemble des années professionnelles et non plus les 6 derniers mois pour calculer leur pension de retraite. Si le gouvernement ne reprend pas à son compte les chiffres donnés par plusieurs syndicats qui estiment la baisse de pension à plus de 30% par rapport au système actuel, il acte dans l’é