De l’inégalité parmi les savants
On sait que l’université et la recherche française sont en ébullition depuis deux mois, après la publication de rapports sur la nouvelle loi d’aménagement de la recherche en préparation dite LPPR (et en vote ce printemps), et surtout les déclarations subséquentes d’Emmanuel Macron et du PDG du CNRS Antoine Petit au sujet de la nécessité d’une « loi inégalitaire » dans la recherche.
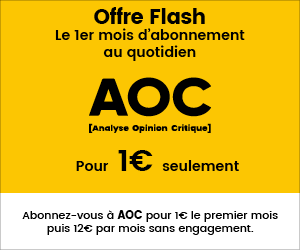
Pétitions, tribunes et actions symboliques plus ou moins inédites – comme une candidature de 500 personnes à l’agence nationale de l’évaluation de l’ESR – se sont succédées régulièrement depuis le 1er décembre. Contraint de dissiper des malentendus et de se défendre d’accusations plus ou moins graves dont celle de « darwinisme social », Antoine Petit a livré dans un entretien certains éléments essentiels de cette pensée du management qui entend réformer ou dynamiser la recherche et l’université (ESR pour les intimes). Il s’agit pour moi ici de déplier, à partir d’une réflexion sur une telle invocation de l’inégalité, la contradiction fondamentale entre le management dominant du monde universitaire et la nature de la recherche scientifique[1].
Car le terme clé, ici, est bien « inégalitaire ». Antoine Petit a raison d’y revenir, c’est bien là qu’est l’enjeu majeur de cette contestation. Bien entendu, notre PDG revendique pour lui l’éclat du bon sens, en multipliant les métaphores sportives. La recherche, comme le sport de haut niveau, est évidemment inégalitaire, dit-il. Au tennis, au football en effet certains gagnent et d’autres perdent, donc tout le monde ne gagne pas – on n’y est plus égal à l’issue d’une épreuve ou d’un tournoi, vous savez bien : au contraire on crée de l’inégalité par les matches. Les scientifiques, eux, envoient leurs articles à des revues académiques – c’est la base du métier –, et certains sont publiés, d’autres pas.
L’apparente évidence des propos d’Antoine Petit cache un sophisme majeur qu’il est crucial de déconstruire.
Ici encore, peu nombreux sont les élus (l
